[sommaire]

La télévision est « attentive aux besoins des enfants », elle aide « à une prise de conscience en montrant le monde tel qu’il est, pas toujours facile à accepter », elle est « un lubrifiant social (…) tant elle permet à des gens qui n’auraient rien eu à se dire de se parler entre eux ». Du moins, c’est ce que prétend Catherine Muller, docteur en psychologie et psychanalyste, et François Chemel, rédacteur adjoint de Télé 7 jours et ce que le professeur Michel Desmurget, docteur en neurosciences et directeur de recherche à l’INSERM, s’attelle à réfuter dans son ouvrage « TV lobotomie ».
Suivons son argumentation, et tirons-en les conclusions qui s’imposent à nous. Dans cette intention, nous suivrons le plan de l’ouvrage lui-même.
Par Benjamin Bak, militant S&P.
La Télévision, en tous lieux et à toute heure
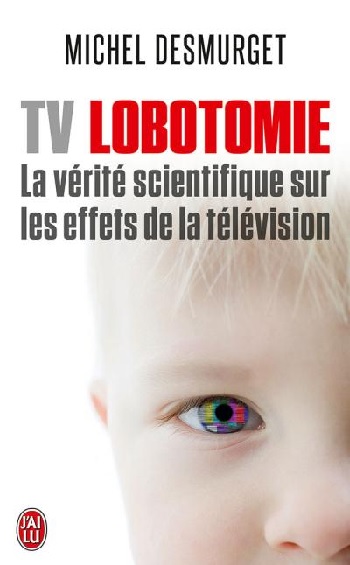
Combien de temps consacrons-nous à la télévision ? Les grands groupes ont depuis longtemps répondu à cette question. Mais ils s’avèrent bien peu partageux du fruit des données qu’ils ont collectées. Malgré le silence de ces groupes, tous les chercheurs contactés par Michel Desmurget lui ont répondu.
En 2009, la consommation télévisuelle mondiale en est à 3h12 par jour et par personne. Selon l’OMS, près de 60% des adolescents français de 15 ans ont une consommation télévisuelle supérieure à 2h par jour en semaine, avec des proportions similaires dans tous les pays occidentaux. Comme si cela ne suffisait pas, il est démontré que le volume de télévision absorbé pendant la petite enfance annonce la consommation adolescente et adulte.
Il est frappant de constater que les enfants ne vont pas d’eux-même au petit écran, mais que ce sont les adultes qui produisent la rencontre. Un rapport TNS-Sofres [1] montre que seuls 15% des enfants de 1 à 4 ans réclament la télévision régulièrement, et que 61% ne la réclament jamais. Pour nombre de parents, la télévision est un moyen d’obtenir du temps libre afin de satisfaire à divers loisirs ou aux taches ménagères.
De plus, il est inquiétant de constater que les « téléspectateurs » se fourvoient sur la qualité des programmes qu’ils regardent, et sur leur propre consommation. D’après les sondages, Arte est la chaîne la plus regardée, alors que c’est NRJ12 qui explose régulièrement les scores d’Audimat. Quand à la consommation infantile, elle est minimisée et sous-estimée par 80% des parents, dépassant de fait les évaluations des parents de 56%. Ce qui veut dire que 1h de télévision postulée correspond à 1h35 de télévision consommée.
Souvent, la question de la qualité des programmes se posent. Ce qui dévoile un vrai problème : il y a 600 chaînes TV sur toute l’Europe qui émettent à « plage restreinte » de 18h par jour, ce qui représente 4 millions d’heures de programme à assurer annuellement. Prenons la mesure de ce chiffre. Considérons « l’Odyssée de l’espèce », ce documentaire de 90 minutes diffusé par France 3. France TV pilota le travail pendant 2 ans aux côtés du Canada, de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Espagne, mais aussi des Américains, des Suisses, des Chinois, des Australiens, des Néo-Zélandais... Il nécessita 100 000 km de repérages, 150 acteurs et 200 figurants. En d’autres termes, la qualité est difficile à concevoir ! Remplir 4 millions d’heures avec de tels programmes devient donc impossible, et la médiocrité, elle, n’est pas chronophage, ce qui « permet » de meubler le temps de séries, de soap opéras, de TV réalité, de MTV et autres.
Une autre contrainte structurelle : le rythme. Sur le petit écran, la lenteur est prohibée. Le problème se pose souvent pour les documentaires animaliers : regarder un tigre dormir ou un lion bâiller n’a rien de très divertissant, donc, on diffuse surtout les scènes de chasse. Il est admis que les modifications rapides de l’univers audiovisuel (violence, explosion, effets spéciaux etc...) contribuent à scotcher le cerveau à l’écran via une sollicitation persistante de l’attention.
Les contenus simples délivrés sur la base de changements audiovisuels rapides se doivent d’être privilégiés afin de prévenir toute chute d’audience. Tout ce qui est lent et compliqué n’a pas sa place sur le petit écran. Prenons le cas du journal de 20h : on passe en un temps record de l’explosion d’une bombe à Bali, à l’ouverture d’une clinique psychiatrique pour chien en Floride en passant par les fêtes de Noël, les négociations israélo-palestinienne, le nouveau disque d’une actrice à la mode et le résultat d’un match de foot. Il en va de la télévision comme du scorpion de la fable, elle fabrique de la médiocrité par ce que c’est dans sa nature.
La télévision étouffe l’intelligence
Vanessa est étudiante de troisième année en psychologie. Elle a laissé un petit mot dans la boîte mail de Mr Desmurget : « Monsieur, aurié vous l’obligeance de me faire parvenir l’article que vous m’avez parlé ». Farida et Jean visent un master en biologie. La première se vante de n’avoir jamais lu un livre (« c’est trop chiant ») et pense que l’expression « géométrie cartésienne » a pour origine la ville de Carthage. Le second est capable de faire 11 fautes grossières en 4 lettres manuscrites et 31 mots, c’est à dire 35% d’erreurs. Madame Anonyme est professeur de français. Début 2005, elle fut sollicitée pour donner un cours de conjugaison à des étudiants préparant le CAPES de lettres.
Michel Matthieu-Colas, professeur d’université et linguiste de formation a pris l’habitude d’évaluer la compétence lexicale de ses étudiants. Citons les réponses les plus divertissantes : hexagone, « triangle qui a beaucoup de côtés » ; polygame « qui associe plusieurs jeux » ; hémicycle, « vélo à une seule roue » ; autochtone, « qui aime vivre la nuit » ; omnipotent, « qui a tout ses membres » ; sporadique, « drogué du sport » ; gérontologie, « science des fossiles » ; xénophobe, « qui a peur quand il est enfermé ».
Certains relativisent ce constat en disant que « la langue a toujours changé ». Mais avant de faire l’éloge de la nouvelle novlangue , demandons à Victor Klemperer, auteur du livre « la langue du 3e Reich » ce qu’il en pense. Ce professeur juif de l’université de Dresde y expose :
Le nazisme s’insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s’imposaient à des millions d’exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. (…) Le 3e Reich a assujetti la langue à son terrible système, gagné avec la langue son moyen de propagation le plus puissant, le plus public et le plus secret.
On retrouve la même idée chez Umberto Eco, fin connaisseur du totalitarisme mussolinien :
Tous les textes scolaires nazis ou fascistes se fondaient sur un lexique pauvre et une syntaxe élémentaire, afin de limiter les instruments de raisonnement complexes et critiques. « Cinq questions morales »
En ce sens, préserver la richesse de la langue, c’est défendre notre humanité et notre capacité à penser le monde. Plus la compétence lexicale s’érodera, et plus les citoyens auront du mal à décrypter les manipulations linguistiques dont les mondes médiatiques et publicitaires sont friands : « frappes chirurgicales » pour bombardements, par exemple.
Pour couronner le tout, on constate que les écrans sont une entrave majeur à la réussite scolaire. Expliquons-nous : le SAT-Verbal est un test standardisé de compétence langagière que passent la plupart des étudiants américains avant leur entrée dans l’enseignement supérieur. Entre 1965 et 1980, les résultats obtenus à ce test s’effondrèrent brutalement. Plusieurs explications furent avancées : baisse du financement du système scolaire, incompétence croissante des enseignants, arrivée en masse d’étudiants issus des minorités, complexification de l’épreuve, etc... Aucune ne se révéla satisfaisante.
Il fallut attendre Marie Winn et la réédition récente de son ouvrage « The Plug-in Drug » (la drogue à brancher) pour entrevoir une solution. Cet auteur observa l’effondrement du SAT-Verbal, avec une période d’incubation nécessaire, la courbe de pénétration de la télévision sur le territoire américain. Le décrochement langagier a commencé environ 17-18 ans après le début du processus d’universalisation du poste de télévision. Cette latence représente précisément le délai nécessaire aux enfants, nés avec la télévision pour arriver à l’examen du SAT.
Bien sûr, corrélation ne veut pas dire causalité. Le gros des évidences se trouve dans les sciences expérimentales. Remontons le temps jusqu’en 1973. Il existait à l’époque une ville canadienne de taille moyenne, que nous appellerons NoTel (pas de télévision). Cette ville, située au fond d’une vallée, ne pouvait pas recevoir la télévision à cause de ces contraintes géographiques. Un groupe de 13 chercheurs apprirent que l’implantation d’une antenne relais était prévue pour mettre fin à cette incongruité.
Une large étude fut mise en œuvre pour mesurer l’influence de la télévision sur des champs aussi divers que l’apprentissage de la lecture, l’agressivité, la créativité, les loisirs, etc. Adultes et enfants furent testés juste avant (Avant-TV) et deux ans après (Après-TV) l’arrivée du poste. Les tests prirent à la fois une forme longitudinale (mêmes sujets évalués avant TV et après TV) et instantanée (des sujets différents mais comparables, exemple des enfants de CE1 furent testés avant et après). Pour optimiser les résultats, le travail fut étendu à deux villes « témoins » dont les caractéristiques sociologiques et démographiques furent les mêmes que celle de NoTel. L’une de ces villes, UniTel, captait une seule chaîne, (Canadian Broadcasting Corporation-CBS). L’autre, MultiTel, en recevait quatre (CBS plus trois chaînes américaines majeures.) La compétence scolaire fut estimée dans sa dimension écrite la plus simple, à partir d’une tache de décodage symbolique. Les sujets devaient lire des mots et des phrases présentés pendant une durée variable, comprise entre 10 et 2000 millisecondes. Les résultats initiaux (avant-TV) montrèrent qu’à leur arrivée en CE1, les enfants de NoTel surpassaient significativement leurs compères de MultiTel et UniTel. Cette différence existait toujours après l’entrée de tout ces enfants en CM1, 2 ans plus tard.

Cette observation montre que l’introduction tardive de la télévision ne dégrade pas l’aptitude acquise au décodage des signes du langage. En revanche, lorsque l’on teste une nouvelle cohorte d’écoliers du CE1 en phase après-TV, les trois villes affichent des résultats équivalents ? Il a suffi de deux ans pour que NoTel perde son avantage originel ? Difficile de nier le rôle causale de la télévision.
Suite à cela, cinq études virent le jour aux États-Unis. Des centaines de milliers de sujets furent testés, du CM au master (bac + 4). La conclusion de l’ensemble de ces travaux fut sans appel : pour des enfants de 6e, le taux de réussite à un test standard chutait de près de 8% lorsque la consommation télévisuelle journalière passait de 1h et moins à 4h et plus. Pour des lycéens de Terminale, on obtenait, sur les mêmes bases, un décrochage sensiblement supérieur, de l’ordre de 13%. Les évaluations eurent des résultats semblables en mathématiques.
Ce tableau général s’avéra toutefois très sensible aux facteurs sociaux. En effet, l’action délétère du petit écran croissait avec l’aisance sociale et le niveau d’étude parental. Plus l’enfant venait d’un milieu favorisé (ou éduqué), plus la corrélation négative entre télévision et performances scolaires s’intensifiait. La télévision altère le développement cognitif en remplaçant des expériences intellectuellement formatrices par des pratiques fonctionnellement pauvres (nous avons vu plus haut que le principe même de la diffusion télévisuelle ne pouvait aboutir qu’à cela).
Dans la mesure où les expériences intellectuellement formatrices sont plus accessibles aux sujets socialement favorisés, il est cohérent qu’ils soient aussi les plus touchés. Il y a plusieurs explication causales au phénomène : au plan biologique, par exemple, il apparaît que la télévision agit négativement sur le temps et la qualité du sommeil, ce qui a pour effet de perturber le fonctionnement cognitif et donc en bout de chaîne la « performance » scolaire.
Quand l’exposition audiovisuelle est réduite expérimentalement, le sommeil se régularise ainsi que le fonctionnement cognitif. Regardons de plus près jusqu’à quel point : des enfants de 8 ans n’ayant pas de télévision dans leur chambre présentent, par rapport à ceux qui en sont équipés, après prise en compte de nombreuses variables potentielles (niveau d’éducation des parents, langue parlée à la maison, âge de l’enfant...) des performances supérieurs de 21% en lecture, 26% en compétence verbale et 34% en mathématiques.
Ceci étant dit, reconnaissons qu’il faudrait à nos enfants un cerveau passablement dérangé pour préférer le livre au poste, au moins durant les premières années de « formation ». En effet, la lecture demande un effort intellectuel plus intense que la télévision. Plusieurs études ont montré que l’écrit imposait par rapport à cette dernière une « taxation » accrue des ressources cérébrales, avec un sentiment exacerbé de pénibilité.
Un sondage effectué aux États-Unis montrait que ces derniers préféraient tous la télévision à la lecture, quelle que soit la nature des programmes proposés. Et pour cause : l’expression écrite regorge d’expressions peu familière à l’univers orale nécessitant souvent l’utilisation d’un dictionnaire.
Prenons un exemple : le roman « Fantômette contre le géant » destiné aux 8-9 ans, est rempli de termes que peu d ’entre nous utilisent à l’oral : « amateur de missel », « quintessence de leurs effluves subtils », « chasseurs néophytes », « cynocéphales au faciès prognathe », « cailloux qui parsèment les abords des ruines », « bestioles aériennes, dont seul un entomologiste aurait pu dire le nom ». Or, malheureusement, il est bien plus engageant, aux âges où l’on apprend à lire de s’avachir devant « Secret Story » que de suer sur Fantômette.
Or, sans apprentissage précoce, il n’existe pas d’accès au monde de l’écrit. Un rapport de l’INSEE a ainsi montré que :
La pratique de la lecture à l’âge adulte trouve sa racine dans l’enfance […] En outre, plus la pratique est régulière, plus il est probable d’en avoir conservé le goût.
Les termes d’un autre rapport rédigé par le Collectif Inter-associatif Enfance et Médias (CIEM) sont tout aussi édifiants. Après avoir stigmatisé l’incapacité du corps social à prendre « la mesure du rôle des médias dans le développement des jeunes et la construction de leur identité », ce rapport conclut sans détour :
La télévision fonctionne sur des valeurs souvent opposées à celles de l’école : promotion de la réussite spectaculaire sans efforts, promotion de l’exposition de l’intimité, fonctionnement dans l’instantané et la satisfaction immédiate.
Seule l’éducation peut faire entendre qu’une certaine dose de déplaisir peut conduire à un plaisir plus grand que ceux immédiatement accessibles. Or, un solide corpus expérimentale montre que le petit écran accroît l’impulsivité comportementale et cognitive des enfants, tout en diminuant leur propension à la persévérance, leur appétence pour les taches intellectuellement exigeantes et leur capacité de concentration. De fait, les élèves les plus télé-phages sont invariablement identifiés comme les plus impulsifs et inattentifs par le corps enseignant.
Depuis plus de 40 ans, nombre d’auteurs ont souligné le rôle central des formats audiovisuels rapides dans l’émergence de troubles attentionnels chez l’enfant et l’adolescent. D’un point de vue théorique, cette idée prend appui sur un large corpus expérimental montrant qu’il existe deux systèmes attentionnels distincts, portés par des circuits neuronaux différents : un système automatique-exogène et un système volontaire-endogène. L’exposition audiovisuelle aboutit à hypertrophier le premier de ces systèmes au détriment du second.
En étant soumis à une succession frénétique de séquence lapidaire, le cerveau en développement s’habitue à modifier continuellement ses focalisations cognitives et intellectuelles. D’autre part, en se trouvant confronté à une cascade ininterrompue de stimuli racoleurs, l’esprit naissant apprend à se reposer sur les sollicitations perceptives externes pour relancer sa vigilance et maintenir son intérêt.
La télévision est aussi lourdement préjudiciable au développement linguistique. Or, l’expression des réactions de l’adulte est impossible au sein de l’univers audiovisuelle. La télévision n’opine pas de la tête pour accompagner positivement une action de l’enfant. Elle ne s’adapte pas ses propos aux expressions d’incompréhension de ce dernier. Elle ne nomme pas les objets qu’il regarde. Elle n’imite pas les mots qu’il articule. Elle ne corrige pas les énoncés qu’il formule. Elle ne répond pas aux vocalises qu’il développe : un enfant de moins de 4 ans entend chaque jour, en moyenne, 13 500 mots. Si la télévision reste allumée 4 heures dans le foyer, ce chiffre tombe aux alentours de 10 000 mots, soit une chute de 25%, quantitativement équivalente à la totalité des mots prononcés quotidiennement par le père en présence de son enfant.
En d’autres termes, la télévision transforme, sur le plan du langage, une famille « normale » en une famille monoparentale. En conclusion, la petite lucarne ne rend pas les enfants débiles ou crétins, mais elle empêche le développement optimal des fonctions cérébrales. Tous les champs sont touchés, de l’intelligence à l’imagination, en passant par le langage, la lecture et l’attention.
La télévision menace la santé
Imaginez une substance récréative dont l’ingestion accroîtrait considérablement la prévalence de l’obésité, du tabagisme, de l’alcoolisme, des troubles du sommeil, des actes suicidaires, des conduites sexuelles à risques et des désordres alimentaires (anorexie/boulimie). Envisageriez-vous d’ouvrir les portes de votre foyer à cette substance ? Accepteriez-vous que vos enfants soient soumis à son influence ? Car la télévision n’est absolument pas un loisir anodin en termes sanitaires. Cette nocivité directe est divisée en cinq points traitant successivement de l’obésité, du tabagisme, de la sexualité et du sommeil. Ce n’est pas une liste exhaustive, mais elle rend compte de l’inquiétude de la communauté scientifique.
Manger plus, bouger moins
Près de 1,7 milliards d’êtres humains se retrouvent en surpoids. Aux États-Unis, 68% des adultes et 32% des enfants sont touchés. Plusieurs études épidémiologiques ont montré les dangers représentés par ces excès (diabètes, accidents vasculaires cérébraux, douleurs articulaires). En Termes de coûts pour la collectivité, il tend à dépasser le tabac et l’alcoolisme. Toujours aux États-Unis, cela représente un budget d’à peu près 500 dollars par habitant et par an.
Dans leur majorité, les études ont montré, que plus un individu regardait le petit écran, et plus il a de chance d’être pansu.
Une recherche impliquant des lycéens de 15 à 18 ans montre que le simple fait de passer plus de 2h par jour devant le poste augmente de 55 le risque de surpoids. Quelle est l’explication ? Au delà des sujets des aliments en eux-même, la question de l’obésité se résume à un vulgaire problème énergétique : si un individu grossit, c’est qu’il ingère plus de calories qu’il n’en brûle. Or, il s’avère que la petite lucarne présente l’inconvénient de ne solliciter que faiblement la machinerie métabolique tout en détournant le corps d’activités plus énergivores. Elle diminue le temps consacré aux activités sportives ou de plein air.
Mais elle influence également les comportements alimentaires. Plus un individu passe de temps devant le poste, plus il mange.
Par exemple, en moyenne, chez un enfant de 12 ans, chaque heure de télévision augmente la prise alimentaire quotidienne de 167 kcal. La nourriture ingérée comprend alors, par rapport aux repas cuisinés, moins de crudités, de légumes ou de fruits et plus de viande, de charcuterie, de pizzas, d’aliments frits, d’amuse-gueules salés et de douceurs sucrées. Lorsque la petite lucarne est allumée, l’individu mange moins sainement et en plus grande quantité. Par exemple, si au lieu de déguster tranquillement votre pizza à table, vous la mangez devant le journal télévisé, vous augmenterez votre prise alimentaire de 260 kcal (36% de pizza en plus). Cumulés sur une année, ces surplus représenteront 13kg de graisse.
Autre variable : les géants de l’industrie agroalimentaire sont les premiers annonceurs publicitaires.
Les adolescents de 13 à 17 ans voient en moyenne 6000 spots de publicité alimentaire par an. La publicité ignore presque totalement les produits frais et sains pour concentrer son énorme force de frappe financière sur les aliments « raffinés » dont raffole l’obésité : céréales, fast-food, sodas, biscuits, confiseries et affidés. Cette focalisation détériore profondément les préférences alimentaires des jeunes spectateurs, au sens où ceux-ci ont tendance à apprécier, réclamer, acheter et manger d’autant plus de junk-food qu’ils subissent une exposition publicitaire massive.
Par exemple : Thomas Robinson et ses collègues ont demandé à de jeunes enfants de 3 à 8 ans de comparer le goût d’aliments divers présentés par paires. Le même produit était utilisé mais emballé dans un papier neutre ou un papier McDonald. 59% des enfants déclarèrent préférer les nuggets McDonald. Pour les frites les scores s’établirent à 77%. Même les carottes furent jugées meilleurs lorsqu’elles apparaissaient dans un papier McDonald. L’effet observé s’avéra d’autant plus important que le nombre de télévisions présentes dans le foyer de l’enfant était grand...
Faire de l’enfant un fumeur...ou fermer boutique
La cigarette tue davantage que les maladies cérébro-vasculaires ou le sida. Chaque année, c’est un pays comme le Danemark (5,5 millions d’habitants) qui est rayé de la carte.
Jacques avait commencé à fumer à l’âge de 13 ans, âge charnière longtemps considéré comme une cible prioritaire pour les cigarettiers. Ce choix marketing aurait aujourd’hui été abandonné. Les fabricants de tabac seraient en effet devenus « responsables » comme le montre, entre autre exemple, la déclaration d’intention postée sur le site Internet de Philip Morris International :
Les enfants qui fument risquent de devenir dépendants et de continuer à fumer en grandissant. Ils s’exposent à des pathologies cardio-vasculaires, au cancer du poumon et à d’autres maladies graves qui risquent de se manifester plus tard dans leur vie. Personne ne souhaite que les jeunes fument. (…)
Les gouvernements peuvent contribuer à ces efforts par la législation, faisant de la vente de cigarettes aux enfants une infraction pénale et en la réprimant de manière stricte. (…) Nous pensons également que les fabricants de tabac ont la possibilité et le devoir de contribuer à la lutte contre le tabagisme chez les jeunes. (…)
Nous faisons campagne dans plusieurs pays du monde en faveur d’une réglementation qui contribue à prévenir le tabagisme chez les jeunes. (…) Nous ne faisons pas la promotion de nos produits auprès des enfants et nous n’utilisons pas d’images ou de contenus susceptibles de susciter un attrait chez les mineurs.
Ce dernier engagement s’avère strictement conforme à la réglementation en place dans la plupart des pays développés. Personne ne sera surpris d’apprendre que les belles déclarations de ce genre sont généralement considérées avec beaucoup de circonspection par les autorités sanitaires. Un rapport récent de l’OMS le montre clairement (rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, OMS, 2008). Selon les termes de ce rapport :
Il faut beaucoup d’astuce pour vendre un produit qui tue jusqu’à la moitié de ses consommateurs. Les fabricants de tabac comptent parmi les meilleurs professionnels du marketing du monde et déploient de plus en plus d’efforts pour contourner les interdictions de la publicité, de la promotion et du parrainage, destinées à faire baisser la consommation de tabac. L’industrie du tabac prétend que ses activités de publicité et de promotion n’ont pas pour but d’augmenter les ventes ou d’attirer de nouveaux consommateurs, mais simplement de répartir autrement le marché parmi les consommateurs existants.
Cela est faux. Le marketing et la promotion accroissent les ventes de tabac et contribuent donc à tuer davantage et en les dissuadant d’arrêter. Le marketing incite également les consommateurs potentiels, surtout les jeunes, à essayer la cigarette et à devenir des clients à long terme.
Cette publicité est particulièrement efficace. De fait, ils n’ont pas le choix : toute personne qui consomme du tabac peut devenir dépendante à la nicotine, mais celles qui ne commencent pas à fumer avant 21 ans ont peu de risque de commencer un jour.
Faire à l’adolescence l’expérience d’un produit très addictif vanté avec insistance par l’industrie du tabac peut facilement conduire à la dépendance à vie. Plus les enfants sont jeunes quand ils fument pour la première fois, plus ils risquent de fumer régulièrement par la suite et moins ils ont de chance d’arrêter.
Heureusement pour les cigarettiers, « Dame Providence » sait être bonne avec ses enfants. Elle a donc choisi d’apparaître aux cigarettiers sous les traits du noble septième art. Les studios cinématographiques américains reprirent avec zèle le flambeau propagandiste. Au nom de la sacro-sainte liberté d’expression, nos « amis » se firent un devoir d’inonder leurs films de scènes tabagiques. Sur la dernière décennie, celles-ci s’invitèrent dans 70 à 75% des films, avec un nombre moyen de présentation de 8 à 9 unités.
Le pire, c’est que l’expression tabagique ne semble avoir aucune base narrative dans l’écrasante majorité des cas. En général, c’est plutôt pour présenter un stéréotype du plus bel effet. Vous voulez montrer un ado en rébellion, un avocat stressé, un flic implacable ? Essayez la clope. Vous voulez transformer une superbe jeune femme (forcément blonde) en beauté fatale ? Tentez le fameux « vous avez du feu ? ». Vous désirez souligner le pouvoir d’un mafieux, d’un chef d’entreprise ou d’un homme politique ? Optez pour un havane bien ventru. Et ainsi de suite.
Est-ce vraiment surprenant ? Pire encore, ces scènes sont bien souvent profondément biaisées. En effet, les fumeurs du grand écran sont montrés comme des personnages positifs, sexuellement actifs, émotionnellement complexes, intellectuellement solides, physiquement séduisants, socialement privilégiés et professionnellement décisionnaires, d’ailleurs souvent joués par des stars. Sur un échantillon de 479 films produits sur la période 1999-2005, 2700 scènes tabagiques ont été identifiées, sans aucun message relatif aux effets potentiellement négatifs de la cigarette pour la santé.
Ces films étaient autorisés sans restriction aux spectateurs de 13 ans et plus. Un phénomène grave, quand on sait que plus un adolescent voit d’acteurs fumer à l’écran, plus il a de chance de devenir un client stable des débitants de tabac. Il apparaît en effet que le facteur « film » triple quasiment le risque de voir un adolescent succomber aux charmes de la cigarette.
Pour éviter tout malentendu, précisons que les études qui ont aboutit à ces résultats on été » publiées dans des journaux médicaux de tout premier plan (Lancet, Pediatrics), sous la plume d’équipes scientifiques internationalement reconnues, après évaluation méticuleuse opérée par plusieurs spécialistes du domaine de la santé et des statistiques.
Quel est, au vu de ces données, l’intérêt des mesures de prohibition ? Bien sûr, il est facile de parler de chasse aux sorcières et de tourner en ridicule les associations qui dénoncent ce genre d’exposition. Taper sur ces groupements de supposés bigots est plus aisé que de faire pression sur les producteurs de films pour obtenir une signalétique claire des caractéristiques tabagiques (alcooliques et sexuelles) d’une « œuvre ». Cela est d’autant plus nécessaire que l’imprégnation tabagique opère de manière inconsciente, à un niveau qu’il serait illusoire de prétendre toucher à travers je ne sais quel fumeux programme « d’éducation aux images ».
Le tabagisme représente un problème majeur de santé publique. Nombre d’études ont montré que ce problème prenait sa source durant l’enfance et l’adolescence. En effet, lorsqu’un individu gagne l’âge adulte sans avoir fumer, il a toutes les chances de ne jamais succomber aux sirènes de Dame Cigarette. Or, parmi tous les facteurs qui peuvent conduire un jeune à fumer, l’exposition à des images tabagiques dans les films, les séries et les clips musicaux est l’un des plus décisifs. Il ne s’agit pas d’un axiome réactionnaire, mais bien d’une observation établie à partir d’une masse impressionnante de travaux scientifiques dont l’OMS et l’Institut national américain du cancer ont récemment reconnu le caractère indiscutable.
« Le spectateur veut du sexe ! »
Contrairement à ce que l’ère du temps le pense, la sexualité n’est absolument pas une pratique anodine en matière de santé.
Chaque année, des dizaines de milliers d’avortements et de contaminations sexuelles infectieuses sont observés. Lors de l’année 2007, près de 13 500 mineures de moins de 18 ans et 1 % des jeunes filles de 15 à 17 ans ont subi un avortement.
Dans ce débat, il n’y a aucune solution satisfaisante. Il apparaît effectivement que l’avortement augmente les risques de souffrances psychologiques à long terme chez les adolescentes. Toutefois, les maternités précoces représentent un facteur de risque non négligeable pour le devenir des mères et de leurs enfants.
La seule issue valable serait de prévenir l’apparition des milliers de grossesses adolescentes non désirées qui frappent chaque année l’ensemble des nations développées. Une réduction de l’exposition audiovisuelle des plus jeunes pourrait s’avérer redoutablement efficace. En effet, la télévision contribue directement à propager des croyances et stéréotypes sexuels lourdement préjudiciables.
Par exemple, 10% des jeunes de 15 à 20 ans pensent que les contraceptifs oraux protègent des infections sexuellement transmissibles dont le sida. Plus de 60% des adultes affirment qu’il est possible d’avoir, sans risque de grossesse, des rapports sexuels non protégés à certains moments du cycle menstruel. C’est ainsi que Sophiane est née en 2008. La mère de cette charmante demoiselle pensait qu’une femme n’était fécondable qu’autour du 14e jour après le début des règles. A son arrivée, la preuve du ratage accusait 49 cm pour 3,2 kg.
Les quelques spots de prévention de-ci de-là et 3 séances annuelles d’éducations sexuelles (voulues par les textes officiels de l’éducation nationale) ne contrebalancent absolument pas l’effet des centaines d’heures de programmes audiovisuels ingurgités par les adolescents. Paradoxalement, nos amis adolescent s’estiment, dans une écrasante majorité, très bien informés en matière sexuelle et contraceptive.
Il pensent d’ailleurs à près de 80% que la télévision n’a pas d’influence sur leur comportements génésiques propres. Cette dernière perception change toutefois lorsque l’on passe du Moi au Toi. Dans ce cas, 72% des 15-17 ans dénoncent l’action incitatrice de la petite lucarne. Mis à part le « deux poids, deux mesures », la plupart des spécialistes et des sociétés médicales partagent ce point de vue. Pour comprendre son origine, interrogeons-nous sur la nature des programme présents à l’écran.
A la lumière d’un récent rapport publié par Médiamétrie et l’IMCA (International Médias Consultant Associés), les choses se résument à un credo très simple : « du sexe, du sexe, et encore du sexe ». Publicité, films divertissement, séries, aucun champ n’échappe au déluge. 70% des programmes « tout public » contiennent des références sexuelles, avec en moyennes 5 incidents par heure, sans parler des scènes « d’amour »(77% des programmes de cette plage-horaire en contiennent).
On aurait pu espérer une atténuation de ces tendances au sein de programmes à forte audience juvénile. Les chiffres rapportés ici se révèlent parfaitement représentatifs de ceux des émissions favorites des adolescents. L’omniprésence des références sexuelles sur le petit écran n’est pas sans conséquence sur le spectateur. A force d’être martelés, les stéréotypes audiovisuels finissent irrémédiablement par altérer les représentations les plus intimes de ce dernier. Les images finissent littéralement, à force de répétition, par inscrire leur « vérité » au fond de notre inconscient. Essayez, par exemple, de convaincre une jeune fille anorexique qu’elle n’est pas grosse et vous verrez à quel point le réel a peu de prise sur nos perceptions intimes.
Le travail déjà évoqué plus haut concernant les résultats scolaires montre également toute la pertinence de ce propos pour le champ des rôles sexuels : Trois villes étudiées deux recevant la Télévision (UniTel et MultiTel), la troisième la recevant à échéance de 24 mois (NoTel). Les « représentations » de deux groupes d’écoliers furent étudiées. Les sujets NoTel, en première phase (sans télévision), avaient une perception plus égalitaire des rôles sexuels que leurs compères des villes connectées. Une différence qui ne survécut pas à l’apparition du poste de télévision à NoTel.
Pour revenir au problème des grossesses, une étude a suivi 1500 adolescentes de 12 ans à 17 ans pendant 3 ans. Les résultats montrèrent que les 10 % de jeunes filles ayant vu le plus de contenus sexuels à la télévision présentaient, par rapport aux 10% les moins exposées, 2 à 3 fois plus de risques de tomber enceinte durant le suivi. En d’autres termes, le petit écran avance de presque 4 ans l’âge de la première grossesse précoce dans le groupe concerné. La probabilité de tomber enceinte était la même (12%) parmi les adolescentes de 16 ans les plus téléphages que parmi les jeunes adultes de 20 ans les moins exposés.
Pour revenir à la question des « représentations », il a été montré que les médias avaient de plus en plus tendance, depuis 30-40 ans, à faire figurer des personnages atypiques, avec des physiques excessivement filiformes pour les femmes et anormalement musculeux pour les hommes. Ces physiques, totalement inaccessibles à l’écrasante majorité des spectateurs, sont associés à des stéréotypes de normalité, de succès, de domination et d’intelligence. Sans surprise, il a été établi que ces messages affectaient profondément la façon dont les spectateurs jugeaient leur propre apparence corporelle. Par exemple, l’exposition médiatique est liée à l’insatisfaction généralisée des femmes vis-à-vis de leur corps, à l’accroissement de l’investissement consacré à l’apparence et à une augmentation de l’acceptation des comportements alimentaires déréglés.
A terme, cela favorise l’émergence non seulement de détresses psychologiques (dépression, mésestime de soi, anxiété), mais aussi de pathologies alimentaires (anorexie, boulimie, conduites de purges...). Les comportements alimentaires des adolescentes fidjiennes de la province de Nadroga furent comparés juste avant, et 3 ans après l’ arrivée de la télévision. L’idée de ce travail séduisait beaucoup les chercheurs, car la communauté de Nadroga privilégiait, dans sa condition originelle, les types corporels « généreux », synonymes de prospérité et d’affluence. Par la grâce de notre petite lucarne, 74% des jeunes fidjiennes se découvrirent soudain trop grosse, et le pourcentage de celles suivant un régime passa du néant à 69%.
La télévision cultive la peur et la violence
Après 60 ans d’études sur l’effet des programmes audiovisuels violents sur le psychisme, le débat est terminé. En conclusion, il y a trois classes principales d’effets : agression, désensibilisation et peur. Le vrai problème, c’est que, contre vents et marées, l’industrie du divertissement et certains critiques choisis continuent de nier l’évidence.
Plus les scientifiques empilent les confirmations et plus le vulgum pecus médiatique affiche son scepticisme. Et malheureusement, la position exprimée par la gent journalistique et son armée de pipeaulogues complaisants restent parole d’évangile, parfois même dans les allées du pouvoir (Catherine Tasca,anciennement ministre de la culture). La pression devient telle que la communauté scientifique n’a d’autres choix que de monter au créneau pour défendre sa probité.
Selon l’Académie américaine de Pédiatrie, plus de 3500 travaux de recherche ont examiné l’association liant violence médiatique et comportements violents, tous à l’exception de 8, ont montré une relation positive (la violence médiatique causant le comportement violent). 8 sur plus de 3500, ça représente près de 99,8% de corroboration.
L’un des pipeaux régulièrement ressorti est que cela n’affecterait qu’un public prédisposé, alors qu’en réalité, les processus cérébraux qui mènent des images violentes aux comportements agressifs sont immuables et universels. L’ennui, c’est qu’en statistiques, un effet peut être à la fois significatif et désespérément faible. Une influence localement minime peut avoir des conséquences majeurs si elle s’applique à une large population et/ou de manière récurrente.
Supposons que la violence contenue dans un film affecte un spectateur sur 1000. Si 10 millions de sujets voient ce film, lors de sa diffusion télévisuelle, on se retrouve avec 10 000 actes agressifs ou violents sur les bras. Brandon Centerwall a évalué, au début des années 90, le nombre de délits imputables à la télévision. Selon ses conclusions, présentées dans le réputé Journal of The American Medical Association :
Les évidences épidémiologiques indiquent que si, hypothétiquement, la technologie télévisuelle n’avait jamais été développée, il y aurait aujourd’hui, aux États-Unis, chaque année, 10 000 homicides de moins, 70 000 viols de moins et 700 000 agressions avec blessures de moins.
Le lecteur trouvera peut-être étonnant de ne pas voir développé ici le concept de catharsis selon lequel les spectateurs se purgeraient de leurs pulsions violentes en voyant ces dernières mises en scène à la télévision. Cette idée, très populaire chez les défenseurs du droit à la violence audiovisuelle et vidéo-ludique, ne jouit d’aucun support expérimentale.
« la violence appelle la violence »
Dire ce qui précède n’implique pas que la télévision soit une machine infernale à fabriquer des tueurs psychopathes. Cela signifie « juste », si l’on peut dire, que quand un spectateur est exposé à des images violentes, il devient plus agressif. Une agressivité qui peut « s’apprécier » à long terme en inventoriant les condamnations pour homicides, vols à main armée ou coups et blessures volontaires d’adultes qui furent, lorsqu’ils étaient enfants, des gros consommateurs de contenus télévisuels.
Au plan philosophique, nous chérissons l’idée de libre arbitre. Il est rassurant de penser que toutes nos actions résultent de décisions conscientes de réfléchies. Malheureusement, cela n’est que rarement le cas. Il est maintenant clairement établi que notre cerveau passe son temps à « traiter des informations » (si l’on ose s’exprimer ainsi) sans nous le « dire ». Et pour être franc, il s’agit plutôt d’une bonne nouvelle : si tout ce qui transite au cœur de nos neurones devait atteindre la conscience, l’esprit serait vite saturé et incapable de fonctionner. Pour s’en sortir, le cerveau n’a donc pas le choix : il faut restreindre le volume d’information livré à la conscience. Cela implique schématiquement que la plupart de nos décisions sont prise sans que notre « Moi » soit informé.
Cela ouvre le champ tout à fait spécifique des « primings » (ou amorçage) conceptuels. L’idée de base est simple : des stimuli environnementaux spécifiques activent des représentations cérébrales singulières qui elles-même activent des comportements particuliers. A partir de ces bases, la capacité des images violentes à générer des comportements agressifs ne devraient plus apparaître comme une curiosité improbable, mais plutôt comme l’expression d’un processus neurophysiologique universel. On pourrait d’ailleurs penser qu’il est plutôt prudent de mobiliser un certain potentiel agressif en réponse à des contextes violent. Il n’est pas exclu qu’il puisse s’agir d’un trait évolutif propice à la survie.
Dans un travail intéressant, Jacques-Philippe Leyens et ses collègues révélèrent une augmentation très significative du nombre d’agression physiques dans un contexte d’exposition à des images violentes dans un contexte délinquant. Le même phénomène fut observé avec une population étudiant non délinquante. Celle-ci fut aléatoirement répartie en deux groupes, exposés quatre jours consécutifs à quatre films, soit violents, soit neutres . Le lendemain de la dernière projection tout ce beau monde se retrouva engagé dans une étude comportementale n’ayant, en apparence, aucun rapport avec l’expérience cinématographique originelle. Lorsque les sujets furent placés en situation de nuire à l’expérimentateur, les étudiants qui avaient visionné les films violents se montrèrent substantiellement plus hostiles et agressifs que leurs collègues du groupe neutre. Ce résultat fut observé indépendamment du comportement de l’expérimentateur, qu’il soit amicale ou attentatoire. Conclusion :
Ces résultats montrent qu’une exposition prolongée à des films gratuitement violents est susceptible d’entraîner une escalade de violence chez des hommes et des femmes ayant été provoqués, et, ce qui est peut-être plus important, de susciter ce genre de comportement chez des hommes et des femmes n’ayant subi aucune provocation.
Ces exemples comme celui-ci existent par centaines dans la littérature scientifique. Il apparaît également que la fréquence des conduites agressives diminue lorsque le temps passé face à l’écran s’affaisse. Cela a été démontré notamment par Thomas Anderson et ses collègues chez des écoliers de 9 ans. En diminuant le temps d’usage audiovisuel, ces auteurs ont enregistré, à échéance de 6 mois, une diminution significative des conduites agressives perpétrées par les enfants durant les récréations. En général, le spectateur finit par intérioriser et reproduire les schémas agressifs que sont écran lui envoie sans en avoir conscience.
Bien sûr, ce phénomène serait menacé s’il ne s’accompagnait pas d’un double sentiment d’acceptabilité et de normalité. C’est là qu’intervient un second processus majeur de l’influence audiovisuelle à long terme : l’habituation.
La violence repousse les frontières de l’inacceptable
L’habituation est définie en tant que « diminution d’une réponse comportementale résultant d’une stimulation répétée et ne reposant pas sur une adaptation sensorielle, une fatigue sensorielle ou une fatigue motrice ». Ce phénomène rend compte, par exemple, de l’étonnante métamorphose de Nadja, jeune infirmière stagiaire prise d’un profond haut-le-cœur lors de son premier passage en neurochirurgie, et qui finit au bout d’un mois par dévorer un tartare saignant à la sortie du bloc opératoire.
Durant les 50 dernières années, nombre d’auteurs se sont demandé s’il serait légitime d’ajouter à cette définition la progressive désensibilisation à la violence des individus télé-phages. La réponse est aujourd’hui positive. Il est maintenant établi que plus un sujet voit d’images violentes, moins il présente de réaction émotionnelle à ces images et moins il sera enclin (même s’il ne risque rien) à porter secours à une personne inconnue victime de violence. De plus, il se montrera également de moins en moins empathique vis-à-vis des victimes d’agressions brutales. L’accumulation de stimuli violents génère un double mouvement cognitif : premièrement, les sujets prennent de plus en plus de plaisir à voir les images présentées ; deuxièmement, ils ressentent de moins en moins d’empathie envers les victimes.
Un travail de Charles Muller et Daniel Linz est à ce titre particulièrement édifiant. Des étudiants de faculté furent exposés à un film d’horreur tous les deux jours, pendant 6 jours, soit 3 films au total. Ceux-ci contenaient une charge particulièrement importante de violences sadiques dirigées contre des femmes. Trois jours après la dernière projection, les sujets furent exposés à des vidéos dans lesquelles des victimes féminines d’agression violentes réelles racontaient en détail leur calvaire. Les résultats montrèrent, en comparaison d’un groupe de contrôle qui n’avait pas participé aux projections initiales, que les étudiants ayant été exposés aux films d’horreur ressentaient moins d’empathie pour les victimes, qui étaient volontiers présentées comme responsables de leurs malheurs.
En clair, la télévision ne se contente pas de nous rendre stupides, malades et violents, elle nous conduit aussi à raisonner comme de bien tristes beaufs. Comment cela fonctionne-t-il ?
Christopher Kelly, de l’université de Columbia, spécialiste en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), enregistrèrent l’activité cérébrale de sujets adultes alors que ceux-ci visionnaient des clips vidéo soit non-violents soit violents. Dans ce dernier cas, les données révélèrent une diminution graduelle d’activité au sein de certaines régions frontales impliquées dans le contrôle des conduites agressives. En d’autres termes, la répétition d’image violentes finit par inhiber partiellement les structures qui permettent au cerveau de réguler ses élans belliqueux. Le fait d’être exposé à des images violentes crée un état progressif de désensibilisation. L’acte violent devient à la fois plus facile à contempler et plus simple à perpétrer. Ce double processus ne peut que contribuer à rendre nos sociétés substantiellement plus violentes et brutales.
La violence nourrit la peur
Mme T. habite un petit village perdu au fin fond de l’Auvergne. Cette affable retraitée de 67 ans ne va jamais en ville, explique-t-elle :
Parce qu’avec tous ces jeunes et tout ce qu’on entend... J’y allais bien avant, mais maintenant, vous comprenez, avec ces bandes qui traînent partout, on n’est plus tranquille.
Pourtant, Mme T . n’a jamais été agressée, elle ne connaît personne qui l’ait été, elle n’a jamais vu une bande de sa vie et la ville du Puy-en-Velay qu’elle craint de fouler est loin d’être un coupe-gorge. Chaque jour notre sexagénaire passe le plus clair de son temps à regarder la télévision. Le journal télévisé est de loin son programme favori.
En novembre 2005, de violentes émeutes se déclarèrent en banlieue parisienne. Michel Desmurget (l’auteur) l’a appris à la télévision, alors qu’il était dans un bar aux États-Unis. On pouvait voir des images de désolation, de bâtiments incendiés et de hordes cagoulées. Interloqué, il entreprit d’appeler ses proches, qui se révélèrent très surpris de son extrême inquiétude. La télévision étasunienne s’était visiblement laissée aller. Une étude montre, à ce propos que la peur d’être agressé augmentait en proportion du temps passé à regarder les journaux d’information locales. Ce sentiment était parfaitement irrationnel, c’est à dire indépendant du niveau effectif de délinquance locale.
Nombre de recherches se sont penchées sur la capacité des images violentes à produire chez les spectateurs des réactions de peur à court et à long terme. Dans les cas extrêmes, ce mode aigu d’intoxication peut se traduire par un véritable stress post-traumatique relevant d’une prise en charge psychiatrique. Ceci dit, l’effet anxiogène de la télévision opère en général selon une logique plus diffuse. Il se construit par accumulation, pour aboutir à ce que George Gebner appelle le « syndrome du grand méchant monde ».
A force de baigner dans un cloaque d’images violentes, faites d’enlèvements, de meurtres, de bagarres, de braquages, de tortures, de viols et de vols, le spectateur finit par se persuader que le monde est infiniment plus dangereux, perfide et brutal qu’il ne l’est en réalité. Cela pousse notre quidam cathodique à prendre des mesures de protection, à clamer sa foi en la peine capitale, à acheter des armes et à afficher des opinions politiques plutôt conservatrices. Nombre d’élus ont d’ailleurs bien compris la règle du jeu. Quand pointe une élection ou une difficulté, il n’est pas rare de voir réapparaître sur le devant de la scène médiatique les questions d’insécurité.
Récemment, dans une émission de radio, un auditeur courroucé affirmait que nos dirigeant ne pouvaient tout de même pas être aussi cyniques. On peut pensé à Cherie Blair, racontant dans un livre comment sa fausse couche avait été jetée en pâture à la presse par son mari Tony, pour des raisons de stratégie politique. « Je ne pouvais pas y croire », écrit-elle à ce sujet.
J’étais là, je perdais du sang, et ils parlaient (Tony Blair et Alastair Campbell, son conseiller en communication) de ce qui allait faire les gros titres de la presse. J’ai posé le combiné et je suis restée là, allongée, fixant le plafond, alors que la douleur commençait à me saisir.
Des individus capables de s’asseoir ainsi sur la douleur de leur femme, et la mort de son fœtus, n’ont en général guère de scrupules à agiter le chiffon sécuritaire lorsque cela peut servir leurs intérêts.
La campagne électorale de 2004 aux États-Unis, qui se conclut par la réélection de George W. Bush, le démontra amplement. Durant les mois qui précédèrent le vote, chaque frémissement contraire fut contré par une opportune alerte terroriste. Lorsque le chef de la mission de recherche sur les armes de destruction massive déclara n’avoir rien trouvé en Irak, l’administration Bush répondit sous 3 jours en annonçant un possible attentat à l’arme chimique contre les réseaux de bus et de trains. Lorsque la convention démocrate fut lancée à Boston, l’administration Bush répondit immédiatement en déclarant l’état d’alerte, au motif que des terroristes s’apprêtaient à faire sauter plusieurs cibles dans les États de New York et du New Jersey, ainsi qu’à Washington DC. Toutes les télévisions du pays relayèrent bien sûr l’ensemble de ces communiqués inquiétants, qui cessèrent soudainement le lendemain de la réélection de George W. Bush.
Le même type de phénomène frappa la France juste avant l’élection présidentielle de 2002 lorsque Jacques Chirac parvint à imposer le thème de l’insécurité comme un enjeu centrale de campagne. Dans ce cas toutefois, la télévision ne fit pas que relayer le mouvement, elle l’accompagna et l’amplifia avec une ardeur telle que certains observateurs n’hésitèrent pas à évoquer une véritable folie sécuritaire, ne pouvant que créer l’alarmisme et une impression quasi paranoïaque d’être entouré de dangers, y compris dans les campagnes les plus paisibles et reculées, dès lors qu’elles étaient desservies par la télévision. Sur les six semaines qui précédèrent le premier tour du scrutin, la proportion de sujets liés à l’insécurité s’élève aux trois-quart, soit en moyenne soixante-deux reportages par semaine (38 au minimum, 89 au maximum). Durant la première semaine de l’entre-deux tour, cette prévalence tomba à trois. Un décrochage prodigieux qui ne semble être relié à aucune évolution de la criminalité réelle. Malheureusement, les derniers développements de notre vie politique suggèrent que le filon électoraliste de l’insécurité a encore de beaux jours devant lui.
Il nous apparaît, avec tout ces éléments, que l’effet délétère de la télévision sur l’agressivité est solidement établi d’un point de vue scientifique. Globalement, trois effets majeurs des contenus audiovisuels violents ont été démontrés :
- Désensibilisation :le spectateur apprend progressivement à tolérer sans sourciller des niveaux de violence de plus en plus marqués ;
- Syndrome du grand méchant monde : le spectateur s’imprègne graduellement de la conviction selon laquelle le monde l’environnant est hostile et dangereux ;
- Agressivité : le spectateur se comporte de manière plus violente et agressive, aussi bien à court qu’à long terme. Aucun argument n’a pu être apporté en faveur de la thèse cathartique selon laquelle les spectateurs se purgeraient de leurs pulsions violentes.
Bien sûr, d’autres facteurs jouent un rôle décisif (pauvreté, maltraitance, éducation...). Pourtant, le fait est là, incontournable : en diminuant notre exposition aux contenus violents, nous contribuerons à créer un monde significativement moins violent. Dire le contraire relève, au choix, du déni de réalité, au pire de l’escroquerie intellectuelle.
En conclusion
Tous les éléments qui devaient être mis en discussion ont été déposés sur la table. La télévision exerce une action fortement nocive sur le développement cognitif, le sommeil, la réussite scolaire, la santé, l’agressivité, la sociabilité intra-familiale et extra-familiale. Elle est également un facteur d’isolement social. Remercions le professeur Michel Desmurget d’avoir tirer le signal d’alarme.

