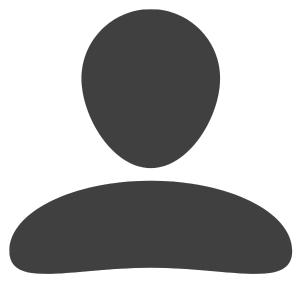[sommaire]
Primaires aidant, les grands ténors politiques de notre pays, au lieu d’ouvrir un vrai débat sur les causes de la crise et les solutions qu’il faudrait y apporter, nous offrent les scènes les moins drôles de La guerre des boutons.
A l’opposé, la vie de Georges Boris nous montre que la vraie grandeur n’est pas d’avoir raison seul contre tous, mais de travailler d’arrache-pied avec d’autres pour défendre la vérité et la justice afin d’impulser une véritable dynamique transformatrice.

Trop souvent des vérités d’importance décisive pour des peuples entiers sont emportées au tombeau avec ceux qui en gardent le secret.
Tel ne fut pas le cas, fort heureusement, du récit poignant publié, en 2010, par le résistant français Jean-Louis Crémieux-Brilhac (1917-2015 - JLCB par la suite dans cet article) sur Georges Boris (1888-1960), de trente ans son aîné, dont il fut le compagnon d’armes au service du général de Gaulle à Londres. Si les historiens de la Résistance connaissent bien ce nom, la majorité des Français ignorent son existence.
Pourtant, comme nous allons le démontrer, c’est grâce au combat qu’a mené toute sa vie ce socialiste rooseveltien, successivement journaliste, grand défenseur en France du New Deal de Roosevelt, chef de cabinet de Léon Blum, fidèle compagnon et conseiller économique du général de Gaulle et enfin tuteur de Pierre Mendès France et inspirateur du programme du Conseil national de la Résistance, que la France a pu devenir une « République moderne ».
Bach et Beethoven
Né en 1888 dans une famille de marchands lorrains, Boris boucle à l’âge de vingt ans ses études de physique générale, de chimie et d’allemand à la Sorbonne. Ses parents l’envoient alors à Fortaleza pour y gérer la filiale brésilienne de leur entreprise d’import-export. Boris se passionne rapidement pour le fonctionnement de l’économie mondiale et apprend le Portugais.
Boris est un homme complet. Peu avant son départ au Brésil, son ami Pierre Weil rapporte que hormis sa passion pour l’économie, la poésie, la philosophie et les sciences, Boris était un violoniste de talent :
Épris de musique, c’est lui qui m’aida – un peu trop wagnérien que j’étais – à aimer Bach qu’il interprétait au violon, ainsi que les quatuors de Beethoven.

Si Boris est juif agnostique, il est avant tout Français. Comme pour tant d’intellectuels juifs de sa génération, marquée par l’affaire Dreyfus, pour lui la France est le pays par excellence de la liberté, porteuse de l’évangile des droits de l’homme et enseignante des nations. Elle est inséparable de la République.
En 1911, Boris se marie avec une catholique, passionnée de peinture, et deux ans plus tard, le couple tente sa chance à Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka) à la tête d’une exploitation d’hévéas. Le pays est pour lui une révélation. Il y découvre la porcelaine chinoise dont il deviendra un fin connaisseur et surtout, il fait la connaissance d’un personnage historique : le poète indien Rabindranath Tagore, prix Nobel 1913, futur ami d’Einstein, compagnon de route de Gandhi et pionnier de l’indépendance de l’Inde. Au contact du peuple Tamoul, dont Boris apprend la langue, il découvre, comme Tagore, la grande misère des hommes et ceux qui en sont directement responsables : les administrateurs de l’Empire britannique. « Il en gardera un sentiment d’horreur toute sa vie », précise JLCB.
Après la Première Guerre mondiale, déclinant l’offre d’entrer au Quai d’Orsay, Boris se consacre au journalisme. Visionnaire, il condamne dès 1921, dans le journal Le Progrès civique, la logique folle du Traité de Versailles (humiliations et dettes impayables imposées aux perdants) qui ne peut qu’engendrer de nouvelles crises.
Car pour Boris, « seule une notion mondiale de la production et de la consommation eut pu prévenir la formation des nationalismes économiques qui mènent l’univers vers la faillite ».
Faire La Lumière
Face à une presse, que sa dépendance envers les annonceurs met à la merci des grands intérêts industriels et financiers qui verrouillent l’opinion, Boris, en prélevant sur ses deniers personnels, lance en 1927, avec des enseignants et quelques belles plumes de la Ligue des droits de l’homme dont il est membre, l’hebdomadaire politico-littéraire La Lumière. Fort de 180 000 membres et soutenue par la franc-maçonnerie à laquelle Boris refusera de s’initier, la LDH défend l’éducation pour tous, les droits syndicaux, la laïcité, l’antifascisme et la paix et participe activement aux grands rassemblements qui conduisent en 1936 à la victoire électorale du Front populaire.
Rappelons qu’en 1933, on découvrit que le journal Le Temps (ancêtre du Monde) avait été secrètement vendu en 1929, pour 25 millions de francs, à un consortium composé du Comité des Forges, du Comité des houillères et du Consortium des Assurances. Pendant trois ans, la ligne politique du quotidien, qui passait pour l’organe officieux de la IIIe République, a ainsi été dictée, à l’insu du public, par le « marchand de canons » François de Wendel, en un temps où l’enjeu majeur de la politique étrangère française était de choisir entre conciliation ou usage de la force à l’égard de l’Allemagne de Weimar. Comme quoi le monde de la presse a peu évolué dans ce domaine…
Au sommaire du premier numéro de La Lumière (14 mai 1927), un article de Boris intitulé : « L’oligarchie de l’argent à l’assaut des monopoles d’État », ainsi qu’un éditorial d’Alphonse Aulard expliquant le pourquoi de la publication :
« Notre Lumière se doit de combattre, en ne cessant de la dénoncer, cette politique de mensonge qui, sournoise ou effrontée, fasciste avouée ou fasciste honteuse, met la paix en danger dans presque toute l’Europe orientale et méridionale.
Le mensonge est l’outil de la dictature : il la prépare, il l’installe, il la soutient, comme on le voit par l’exemple de Mussolini qui a pu ainsi mettre en esclavage un noble peuple trompé.
En bâillonnant la presse, ou plutôt en la faisant parler comme il voulait qu’elle parlât, le dictateur a fait croire à l’Italie qu’elle était menacée dans sa sécurité ou (ce qui lui est plus sensible) dans son honneur (…)
Certes, dans notre démocratie française, le mensonge n’est pas encore roi, mais il rôde autour et dedans, il s’insinue, il conspire, il tâche de miner d’abord l’école laïque, afin d’ôter à la République son âme.
« Pourquoi nous fondons La Lumière ? » s’interroge Boris dans le numéro suivant :
Parce que nous avons la foi (…) Notre programme social ? La lutte contre le régime inique qui donne à l’un un palais, à l’autre un taudis ; la lutte contre l’organisation ploutocratique qui fait de la politique la servante des intérêts financiers ; la lutte contre la misère, l’ignorance, la prostitution, le jeu ; la lutte pour une cité meilleure où l’exploitation de l’homme par l’homme fera place à un travail fraternel ; la défense du patrimoine national contre l’emprise capitaliste ; le respect des droits de la femme.
On y trouve ensuite des thèmes qui deviendront les revendications programmatiques de la gauche réformiste, dont certains trouveront plus tard un écho chez les défenseurs du New Deal du Président américain Franklin Delano Roosevelt : nationalisation de l’électricité, des chemins de fer et des industries d’armement, prélèvements occasionnels sur le capital à condition qu’ils soient justifiés par leur emploi, réforme d’une Banque de France aux mains des « 200 familles » qui, au lieu de servir le progrès de la nation, se sont érigées en véritable « mur de l’argent ».
Au-delà de la LDH, La Lumière rayonne bientôt sur toute la gauche non-communiste qui apporte sa collaboration et se montre sensible à ses critiques : Léon Blum, Jules Moch, Ramadier, Pierre Mendès France, Alfred Sauvy, Maurice Schumann, Jean Zay, sans oublier les milieux scientifiques autour de Jean Perrin et d’Henri Langevin.
Boris économiste
Après le krach de 1929, la crise boursière américaine entraîne le reste du monde dans la Grande Dépression. En juillet 1931, le krach bancaire et financier en Allemagne, suivi, le 20 septembre de la même année (comme Boris l’avait anticipé) par la suspension de la convertibilité de la livre sterling en or, entraînant une chute de la devise anglaise qui atteint 30 % par rapport au franc, étend la crise au monde entier. La France, assise sur un tas d’or gonflé depuis la stabilisation Poincaré, se flatte de ne courir aucun risque. Cependant, pour que le pays reste compétitif, Boris plaide pour que la France suspende elle aussi la parité, car un système rigidement lié à l’or et laissant libre cours aux fluctuations économiques ne pouvait conduire qu’à la ruine et au chômage. Pour lui, c’est le problème des changes qui est capital. Ainsi, il estime que :
C’est en dirigeant la monnaie et non en se laissant diriger par elle que, sous le règne social où nous vivons, un remède peut être apporté aux grands maux dont nous souffrons.
Lorsqu’en octobre 1931, Laval et Hoover se rencontrent pour affirmer leur attachement à l’étalon-or, Boris est le seul économiste à avoir compris que cette position est intenable. En cas de nouvelle baisse, écrit-il, « les États-Unis devront abandonner l’étalon-or pour sauver leur système bancaire et social ».

Pour stabiliser la situation, Boris propose que les grandes puissances s’accordent sur une nouvelle architecture financière globale lors d’une conférence internationale. Comme alternative à l’étalon-or, Boris avance l’idée d’un « étalon-or matières premières », contrôlé par une Banque internationale des matières premières. Le projet, tourné en dérision à l’époque, sera repris quinze ans plus tard par Pierre Mendès France comme base d’un plan de stabilisation des cours des matières premières.
En défense du New Deal
Élu président en avril 1933, Roosevelt abandonne l’étalon-or comme l’avait prévu Boris. Cette mesure prélude à un foisonnement de réformes économiques et sociales et à une dévaluation pilotée qui amorceront le redressement du pays. Le volontarisme du New Deal fascine Boris à tel point qu’il se rend sur place pour voir ce qu’il en est. De retour en France, il publie en avril 1934 La Révolution Roosevelt, un livre qui connaît cinq éditions en trois mois ! (texte complet ICI)
Alors que la grande presse rivalise dans les attaques et les sarcasmes contre la politique rooseveltienne, présentée comme « une bouffonnerie sinistre qui peut avoir des conséquences terribles », Boris enchaîne dans La Lumière des articles comme « Bravo Roosevelt ». Et rien que le titre d’un autre article, relatant comment les industriels de l’acier américain ont été obligés par Roosevelt d’accepter l’existence de syndicats dans leurs usines, a valeur de manifeste :
Aux États-Unis s’accomplit un 89 économique. La Nuit du 4 août du patronat américain. Vers la reconnaissance du droit à la vie et du droit au travail. La réforme monétaire, condition de la réforme sociale.
Sans surprise, Boris applaudira l’arrivée au pouvoir du Front populaire et surtout les accords de Matignon du 7 juin 1936 qui reconnaissent les droits syndicaux, instaurent les congés payés et la semaine de quarante heures, calquée sur la législation de Roosevelt et depuis longtemps promise au monde ouvrier.

Il y voit un début de New Deal à la française, tout en avertissant que « les ouvriers doivent veiller à ce que le rythme de la production soit non pas ralenti, mais accéléré. Ils doivent, dans chaque usine, exiger que l’application de la loi soit immédiatement suivie d’embauchages nouveaux ».
Le lieutenant-colonel Émile Mayer
Contrairement à la quasi-totalité de la presse de gauche, La Lumière, bien que pacifiste, n’a jamais péché par aveuglement antimilitariste. Sur le besoin de doter la France d’une force de dissuasion, Boris fait appel à un expert militaire auquel il restera fidèle toute sa vie : le lieutenant-colonel Émile Mayer.
Écarté de l’armée pour ses vues non-conformistes et son dreyfusisme militant, Mayer a conseillé Jaurès pour la rédaction de L’armée nouvelle.
Pour ce vieux polytechnicien, la ligne Maginot est une dangereuse illusion, car la prochaine guerre ne sera pas une guerre de positions mais une guerre de bombardements chimiques.
Chaque dimanche, à Paris, Mayer reçoit dans le salon de sa fille, cousine et confidente de Léon Blum. Or, les biographes de De Gaulle ont mis en évidence que dès 1925, Mayer était en relation avec ce dernier.
C’est d’ailleurs par l’intercession du gendre de Mayer, le juriste Paul Grunebaum-Ballin, que de Gaulle obtient en 1936 un entretien avec Léon Blum, président du Conseil.
Avec Léon Blum
Lorsqu’en mars 1938, Blum est appelé à former un nouveau cabinet, la guerre mondiale gronde. Blum forme alors un gouvernement de « salut public » ; il ne durera que vingt-six jours.

Sur l’avis de Georges Boris, Blum proposera à la France une économie de guerre. Président du Conseil, Blum assume personnellement la charge du ministère « le plus exposé », celui du Trésor.
Pour diriger son cabinet, il choisit Boris, et pour le seconder, il prend pour sous-secrétaire d’État le jeune député radical de l’Eure, Pierre Mendès France, économiste déjà reconnu et antifasciste avéré.
De vingt ans plus âgé que PMF, Boris en sera le tuteur. Tous deux s’installent au ministère des Finances où Blum les retrouve chaque matin pendant une heure pour faire le point.
C’est dans ces conditions que PMF et Georges Boris élaborent un programme de redressement économique, défini dans un projet de loi déposé par Léon Blum le 5 avril 1938. [1]
Mobilisation de guerre
Il s’agit de donner au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour mettre la nation en état de faire face aux charges qui lui incombent, en particulier aux besoins de sa défense.
Face au danger de guerre, Boris pense qu’une « monnaie dirigée » ne suffit plus. Désormais, c’est à une économie dirigée que l’on doit faire appel, articulée autour d’une politique de la monnaie, des investissements, du crédit et de la fiscalité. Dès le milieu de l’année 1937, Boris considère le contrôle de changes comme une mesure incontournable en un temps où la France doit se « surarmer pour empêcher la guerre », c’est-à-dire se doter d’une force de dissuasion.
« L’expérience du libéralisme financier était justifié il y a quelques mois quand existait encore l’espoir d’un règlement européen (…) Nous n’en sommes plus là », dira Boris trois mois plus tard. Le projet, comme le rappellera PMF, est en effet inspiré d’une vision globale de la gestion de l’économie qui ne s’accommode plus du capitalisme libéral.
En premier lieu, chacun doit faire sa part. Si des mesures visent à protéger l’épargne, à alléger les charges fiscales et à faciliter la trésorerie des entreprises, d’autres mesures ont de quoi fâcher les spéculateurs et les grandes fortunes : la mise au nominatif des valeurs boursières au porteur, la création d’un impôt exceptionnel sur le capital frappant les patrimoines évalués à plus de 150 000 francs, ainsi que la taxation des superbénéfices résultant de l’extension des nouveaux programmes de guerre, sans parler du contrôle des changes.
Il faut donc tout d’abord protéger l’économie par une politique d’échanges internationaux ; ensuite organiser la production afin d’améliorer son rendement. Il faut aussi, ce qui n’est pas moins essentiel, assurer la stabilité du niveau des prix. A cet effet, il est nécessaire que les monopoles de fait et les groupements industriels soient soumis à une surveillance vigilante. Si des mesures partielles peuvent résoudre des difficultés particulières, l’organisation de la production exige une politique cohérente.
S’appuyant sur les groupements professionnels, elle tendra à favoriser la rationalisation industrielle, à coordonner les achats et les ventes de matières premières, à développer la production d’énergie, à rechercher des ouvriers qualifiés…
Sur le plan industriel, plusieurs aspects du plan de Boris et de PMF précèdent ceux de la mobilisation de guerre, c’est-à-dire le fameux Victory Program lancé en 1939 par Roosevelt, notamment la construction de barrages et la production d’essence synthétique :
Il est également urgent d’accroître la production de forces motrices, afin que les importations de charbon cessent de peser aussi lourdement sur notre balance commerciale. A cet effet, de nouvelles centrales hydro-électriques seront construites, éventuellement grâce à la collaboration financière des entreprises existantes, et un système de bonification permettra d’encourager l’amélioration des procédés industriels destinés à économiser le combustible. De même, afin d’assurer le ravitaillement de notre armée de l’air, nous nous proposons de construire de nouvelles usines d’essence synthétique.
Le programme d’équipement industriel et les fabrications d’armement nécessiteront la mise en œuvre d’un outillage important et, par conséquent, l’utilisation d’ouvriers spécialisés. Une meilleure liaison des services de l’enseignement technique et des entreprises industrielles permettra de former des travailleurs qualifiés ; dans certaines branches d’industrie, notamment dans les mines, il sera en outre fait appel à la main d’œuvre étrangère…
En clair, à la place d’une politique de grands travaux civils, c’est « autour de la manufacture d’armements, qu’une économie coordonnée sera la base d’une production plus importante dans tous les domaines ».
Sur le plan social :
L’effort imposé à la fortune acquise, pour le redressement des finances et de l’économie, aura sa place dans un effort plus général de solidarité nationale, dont la classe ouvrière ne saurait être exclue. A la discipline de la production devra répondre la discipline du travail ; à l’effort financier, l’effort productif des classes laborieuses (…) Par ailleurs, l’ensemble des mesures de réorganisation économique envisagées se traduira par la mise en marche d’un certain nombre d’entreprises.
Il n’est pas téméraire de prévoir, dans ces conditions, la résorption progressive du chômage partiel, la diminution du nombre de chômeurs complets, peut-être même le manque de main d’œuvre et, notamment, de main d’œuvre qualifiée.
En accord avec la classe ouvrière, une extension du temps de travail est sur le point d’être réalisée dans les industries de la défense nationale, en vue de répondre, par la pleine utilisation de l’outillage, à la nécessité vitale d’accroître la production (…)
Pour conclure, le projet, sans peser sur la production, prévoit d’accorder une retraite aux vieux travailleurs grâce à des recettes fiscales en hausse. Mesure reprise, une fois de plus, de Roosevelt, qui considérait le Social Security Act de 1936 comme l’œuvre de sa vie.
Afin de lancer cette mobilisation de guerre, le gouvernement Blum demande les pleins pouvoirs pour trois mois (cent jours). Si la Chambre vote le projet, le 8 avril 1938 le Sénat bloque tout. Il ne veut ni du dirigisme économique, ni de la remise en question de la répartition de la fortune nationale, ni de lui, Léon Blum, accusé par la droite d’être, avec Boris et Mendès France, « un des trois juifs qui contrôlent le Trésor ». « Vous n’avez pas assez de terre française à la semelle de vos souliers », lui lance, haineux, le vieux sénateur Caillaux.
Voilà donc un de ces moments historiques où la France, en se mobilisant elle-même, aurait pu peser sur le cours des événements tragiques qui allaient s’abattre sur le monde entier. La cupidité, la misère morale et la stupidité de nos élus, dont la vérole antisémite, depuis l’affaire Dreyfus, n’était que l’expression la plus crade, a coûté très cher au monde.
Avec de Gaulle à Londres

Lorsque la guerre éclate, Boris, âgé de 51 ans, est dispensé de ses obligations militaires. Patriote, il s’engage néanmoins comme volontaire et sera affecté dans le Nord comme officier de liaison avec les Britanniques. Évacué de Dunkerque en mai 1940, il se retrouve dans un camp en Angleterre début juin.
La capitulation de son pays, la France, aux mains de Pétain, lui inspire une telle honte face aux Anglais qu’il abandonne son uniforme pour un costume civil. Il le reprendra en apprenant que de Gaulle a « ramassé le tronçon du glaive », et prend la tête de la Résistance.
Brusquement, le rideau opaque se déchirait. L’espoir que nous avions cru mort renaissait. Et nous pensions que, même si tout devait demeurer perdu, du moins l’honneur était sauf et que, l’instant après, nous allions pouvoir de nouveau regarder en face les passants dans la rue.

Au lendemain de l’Appel du 18 juin, après avoir arraché le numéro de De Gaulle à une standardiste, il le joint par téléphone. Celui-ci le reçoit le jour même et fait de lui un des responsables des liaisons de la France libre avec la BBC.
C’est là qu’il rencontre Jean-Louis Crémieux-Brilhac, chef du service de la division clandestine, avec qui il va travailler. L’auteur s’étend longuement sur les divisions ridicules mais dangereuses qui gangrenaient parfois la Résistance. Alors que des antisémites demandent à De Gaulle d’écarter Boris, ce dernier coupe court aux attaques en disant que lui, De Gaulle, ne fait pas de distinction de race, de classe ou de religion. Il ne connaît que deux sortes de Français, « ceux qui font leur devoir et ceux qui ne le font pas ! »
L’auteur relate également que les Anglais ne voyaient pas d’un mauvais œil l’action du groupe Jean Jaurès, une poignée de socialistes français installés à Londres, pour qui de Gaulle n’était qu’un dictateur en herbe et les militants de gauche qui l’avaient rejoint, comme Boris, « des fascistes »…
L’adhésion de Boris à la démarche de De Gaulle s’affirme puissamment dans la lettre qu’il adresse en juin 1942 à Léon Blum pour le convaincre d’engager toute la mouvance socialiste derrière « l’homme de Londres » :
Je considérais qu’il n’y avait pas d’autre solution que d’adhérer au mouvement, même s’il devait être dominé par des éléments politiques hostiles. Il représentait la France, et je n’ai jamais songé à renier ma nationalité du temps que les gouvernements ne me plaisaient pas. Il faut, ai-je toujours dit, faire de l’opposition du dedans, mais non du dehors.
Mais mon raisonnement allait plus loin. J’avais la conviction déjà à cette époque qu’avec le temps le mouvement devrait s’orienter vers le peuple, ou qu’il périrait. Le jugement que j’avais pu porter sur le Général me poussait à penser que ce non conformiste, animé par le mépris et sa rancœur contre les milieux dirigeants, l’état-major, la haute bourgeoisie, etc., cet homme qui n’avait pas hésité à faire acte de rebelle, n’hésiterait pas non plus à aller de ce coté, même si ses origines, son éducation, ses premiers préjugés, devaient le prédisposer à une attitude contraire.
En tout cas, pensais-je, le devoir de tout le monde est de se grouper autour de lui parce qu’il accomplit une mission historique : il faut qu’aux yeux du monde tout entier il apparaisse comme la France qui continue et qui n’a pas démérité. Même si cela ne devait être qu’une fiction, ce serait notre devoir de proclamer que c’est une réalité jusqu’à ce que d’autres mains, qui en soient dignes, prennent la charge de la France. Jusque-là, c’est de Gaulle qui représente les intérêts permanents du pays.
En novembre 1942, Blum, qui eut très tôt des échanges épistolaires directs avec Roosevelt, rédige, à la demande de De Gaulle, une note destinée à Roosevelt et à Churchill : il s’y porte personnellement « garant » du général de Gaulle comme futur chef du gouvernement intérimaire de la France, et appelle les Alliés à ne pas traiter, en Afrique du Nord, avec les hommes de Vichy, discrédités.
L’après-Roosevelt
Si Boris s’était enthousiasmé pour le New Deal, il n’a aucune illusion sur les États-Unis qui, après-guerre, « exerceront une influence prépondérante en Europe occidentale ». Ils auront besoin de l’Europe « comme d’un débouché et ne pourront par conséquent pas lui refuser ses crédits et ses fournitures (…) Il est donc indéniable qu’ils pourront exercer une influence sur la politique intérieure, voire déterminer le choix des gouvernements à l’intérieur de chaque pays ». Boris pense que cette évolution sera probable, « dès l’instant où Roosevelt aura disparu de la scène politique ou aura passé au second plan, et où les démons du business, et singulièrement du big business seront débarrassés de leur plus redoutable exorciseur. »
Boris y voit une source de tensions : d’un côté les États-Unis chercheront à imposer les « panacées du libéralisme sous leur forme la plus imprécise (développement des échanges, expansion du commerce international, libre circulation des marchandises et des capitaux », alors que de l’autre, les pays européens, « ayant déjà parcouru certaines étapes vers un tout autre ordre économique et social », seraient déjà, espère-t-il, sous le régime d’une économie planifiée.
<quoteL’Europe ne pourra sauvegarder son indépendance à condition de présenter un front uni. On peut concevoir que le rôle de la France sera de diriger et de représenter cette coalition d’intérêts européens. Il est dans la logique des choses qu’elle soit le porte-parole du continent.
Le Conseil national de la Résistance
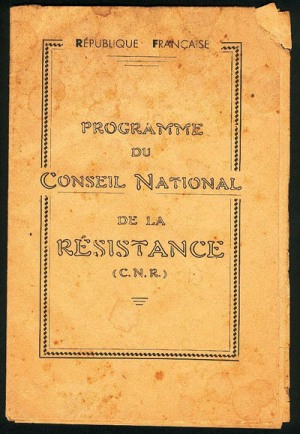
C’est dans cette perspective qu’au printemps 1944, avant que ne soit connu le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), Boris esquisse pour de Gaulle un programme, en partie politique mais essentiellement économique et social. « Ce programme est le plus audacieux qui ait été alors conçu dans les cercles de pensée de la France libre », affirme JLCB. Son titre en dit long : « La révolution nécessaire. La machine, facteur essentiel de la révolution, dans la paix comme dans la guerre ».
Pour Boris, « si les esprits attardés n’ont pas vu que la machine révolutionnerait la guerre, ils n’ont pas davantage compris qu’elle va tout aussi bien révolutionner la paix ».
Dans l’esprit de Roosevelt, Boris y propose à de Gaulle, sur la base d’une synthèse entre l’ancien régime libéral (au double sens politique et économique) et le dirigisme économique, une « libération sociale », ce que Roosevelt avait défini comme le « freedom from want » (affranchissement de l’homme des besoins matérielles primaires). Si elle n’est pas mise en œuvre dès les premiers jours de la Libération, prévient Boris, l’on assistera à une restauration des privilèges qui la rendra impossible.
Ce plan, suivant une organisation rationnelle que les alliés ont appliquée à l’économie de guerre, doit organiser en temps de paix la reconstruction grâce à un effort maximum de production. Sans porter atteinte aux libertés politiques, il s’agit de faire en sorte « que nul n’ait droit au superflu aussi longtemps que tous n’ont pas le nécessaire », ce que la machine permet désormais. Pour y arriver, le programme préconise :
l’élimination radicale des grands intérêts privés (trusts) qui exerçaient à leur profit et sans souci de l’intérêt général une hégémonie véritable sur le plan économique et une influence exorbitante sur le plan politique : en conséquence, les grandes industries monopolisatrices et les banques distributrices de crédit et de capitaux d’investissements ainsi que les compagnies d’assurance doivent être reprises par la nation.
C’est en effet ce que sera fait par la loi bancaire du 2 décembre 1945, imposant en France, à l’instar du Glass-Steagall Act de Roosevelt aux États-Unis, une séparation stricte entre banques de dépôts, banques commerciales et banques d’affaires.
Si ces réformes ont pu se faire, c’est également que Boris a largement contribué à l’élaboration de ce qui sera adopté le 15 mars 1944 comme le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), dont le volet économique (5a) préconise :
- l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie ;
- une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l’image des États fascistes ;
- l’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production ;
- le retour à la nation des grands moyens de production monopolisée, fruits du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques ;
- le développement et le soutien des coopératives de production, d’achats et de ventes, agricoles et artisanales ;
- le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et d’administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et
- la participation des travailleurs à la direction de l’économie.
Depuis le passage à Londres de Daniel Mayer, le grand patron du Parti socialiste SFIO de l’époque, Boris ressasse l’idée d’un programme commun à faire adopter par toutes les formations résistantes. Si Pierre Laroque, futur père de la Sécurité sociale, est venu les rejoindre à Londres, c’est également avec Emile Laffon (alias Guizot) que Boris en discute et élabore un projet que Laffon emportera en France à la mi-juillet.
La deuxième partie du projet, intitulé « Charte économique et sociale », porte la griffe de Boris et les historiens du programme commun de la Résistance n’auront pas à s’étonner des similitudes entre le programme apporté par Daniel Mayer et le « projet Guizot ». Alors que le projet socialiste préconisait la nationalisation de toutes les banques, elle se limite aux seules grandes banques de dépôt chez Boris.
Le plan

Dans sa lettre adressée à de Gaulle en 1944, Boris précise que l’outil idéal pour mettre en œuvre cette politique de « libération sociale » sera « le plan », projet inclus dans le programme du CNR. Pour Boris, cette planification sera d’inspiration jaurésienne, c’est-à-dire basée non pas sur la lutte des classes mais sur une harmonie d’intérêts bien compris : « Les profits du capital seront strictement limités. Sur la masse de richesses produites, une part sera réservée aux œuvres sociales (assurances sociales, etc.), une autre au développement productif de la nation des richesses produites. La politique des œuvres sociales et celle des investissements seront prévues par le Plan : ainsi dans la nouvelle démocratie sociale, les organismes directeurs du plan auront pour tâche de régler le rythme du progrès matériel et social ».
Il est clair que de Gaulle n’était pas loin de penser la même chose lorsqu’il disait : « Nous voulons donc la mise en commun de tout ce que nous possédons sur cette terre, et pour y réussir il n’y a pas d’autre moyen que ce que l’on appelle l’économie dirigée. » (Discours prononcé à Lille, le 1er octobre 1944.)
Pour lui, cependant, « dirigisme » ne veut pas dire suivre une direction prédéterminée suivant une logique préétablie : « Les grandes affaires humaines ne se règlent point uniquement par la logique, il y faut l’atmosphère que seule peut créer l’adhésion des sentiments ».
En 1962, Pierre Mendès France, dans La République moderne, ne dit rien d’autre :
Parce que nous appartenons à un pays de juristes, nous sommes enclins à rechercher ce que serait la meilleure organisation de l’Etat, de ses services, de ses ministères, de ses administrations, pour faire respecter la suprématie du Plan. Or ce n’est point l’essentiel. L’essentiel concerne l’esprit même qui doit dominer toute la politique économique et la conception même du Plan. Aucun organigramme ne sera efficace si ne règne pas chez tous les hommes responsables, depuis le chef du gouvernement jusqu’à son subordonné le plus lointain, la volonté acharnée et sans cesse en éveil de faire respecter le Plan à propos de chacune des décisions gouvernementales. Tant que l’équipe dirigeante et son chef, en premier lieu, ne feront pas du Plan leur objectif commun et prioritaire, qu’ils ne sentiront pas pleinement que le Plan en voie d’exécution est « leur » Plan, leur engagement, que c’est là-dessus qu’ils seront jugés, tant qu’ils ne feront pas corps avec l’entreprise, on n’évitera pas la faiblesse, quelle que soit l’organisation retenue.
Bien qu’ « instrument du salut », aussi bien pour Georges Boris que pour Charles de Gaulle et Pierre Mendès France, avec le plan, il ne s’agit donc nullement d’imposer une économie administrée à la soviétique.
Créé le 3 janvier 1946 par le général de Gaulle, le Commissariat au Plan, qui a largement élaboré et accompagné les choix stratégiques de la France tout au long des Trente Glorieuses, fut supprimé en 2006 par Dominique de Villepin.
Jacques Cheminade, reprenant le flambeau du combat que nous venons d’esquisser, estime qu’il est grand temps de le rétablir, dans sa forme autant que dans sa mission.
Bibliographie :
- Georges Boris. Trente ans d’influence. Blum, de Gaulle, Mendès France. Par Jean-Louis Crémieux-Brilhac. Gallimard, 468 p., 25 €.
- Georges Boris : Servir la République. Textes et témoignages. Préface de Pierre Mendès France, Julliard, 1963.


 COMMENTAIRES
COMMENTAIRES