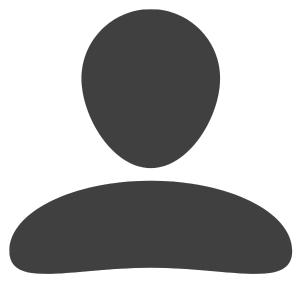[sommaire]

Introduction
Est-ce qu’on sait bien ce qu’est l’âme humaine ? […] Elle n’est pas un modèle en carton sur lequel le musicien viendrait broder des points d’or ; elle n’est même pas explorée tout entière. Et dans tous les cas, il se produit souvent en elle, pour nous servir du langage musical, des changements de clef qui transforment les sentiments et les états les plus connus. Or, cette vie flottante de l’âme n’est pas d’un côté et la musique de l’autre. La musique ne la traduit pas seulement, elle la crée. »
Jean Jaurès, De la réalité du monde sensible.
Nous vivons un moment crucial de l’histoire, une crise qui nécessite une capacité souveraine à se hisser à un niveau supérieur d’existence, sans quoi nous nous effondrerons à coup sûr. Or ni Benjamin Biolay ni Yann Tiersen, ni même Boulez ou Debussy, ne nous permettront de puiser l’inspiration, la force de caractère, la concentration et la créativité nécessaires à cette épreuve collective.
Et cette citation de Jean Jaurès, qui fut confronté en son temps à la même nécessité d’un sursaut collectif – malheureusement sans succès, comme l’a confirmé l’arrivée de la Première Guerre mondiale – montre qu’il avait, si ce n’est compris, du moins senti, le rôle fondamental que doit revêtir la musique, ou plutôt un certain type de musique. Selon lui, l’art en question ne doit en aucun cas se suffire à refléter un état d’âme, qu’il soit nostalgique, rageur, cynique ou même gai : car ce serait réduire l’âme, qui « s’ignore elle-même plus qu’à moitié ». Ajoutons que l’âme humaine – et c’est ce qui fait sa singularité – est en devenir, et qu’elle doit se nourrir de tout ce qui peut l’aider à imaginer ce qui n’existe pas encore, afin de s’assurer, en le créant, un futur.
Afin de plonger dans la découverte de ce que peut ou doit être la musique, au sens où l’entendrait un Jaurès, nous avons décidé de pénétrer dans l’univers de Wilhelm Furtwängler (1886-1954), grand chef d’orchestre allemand du XXe siècle. Grâce aux écrits qu’il a laissés et aux nombreux entretiens, notamment retransmis dans l’ouvrage Musique et Verbe, nous avons pu en faire un guide pour commencer à découvrir la musique dite « classique » et ses vertus pour l’esprit humain. Vous verrez au long des différents articles que nous allons vous faire partager, tant sur le combat devenu « politique » de Furtwängler que sur sa conception de ce qu’est véritablement l’art qu’il dirige, que tout comme pour Jaurès, chez lui musique et préoccupation pour l’âme humaine – et son sort – ne font qu’un.
I. Le principe de Furtwängler
Défier l’esclavage de la certitude des sens
Extrait de l’émission « Weekly report » du LPAC (LaRouche Political Action Committee) du 23 mai 2012, avec l’économiste américain Lyndon LaRouche et deux de ses jeunes collaborateurs, Matthew Odgen et Jason Ross.
Lyndon LaRouche : Aujourd’hui, nous allons inaugurer quelque chose de plutôt inhabituel, mais qui est relativement pertinent avec ce que nous faisons habituellement ici. Le sujet en lui-même représente l’un des plus grands accomplissements scientifiques du siècle dernier. Il s’agit de comprendre les conceptions du grand savant russe Vladimir Vernadski, entre autres, à partir de la question suivante : qu’est-ce que la composition musicale, quels en sont les principes, quelle relation a-t-elle avec la science physique ?
Matthew Ogden : Eh bien, je pense que le sujet de notre discussion pourrait s’intituler « se libérer de la prison de la perception sensorielle ». Comme tu l’as souvent dit, le meilleur moyen de se libérer de cette prison est l’art classique, en particulier la musique classique telle que la comprenait Wilhelm Furtwängler. Furtwängler est un chef d’orchestre de la première moitié du XXe siècle, et il faut préciser que son approche n’a rien à voir avec la façon dont nous concevons la musique classique aujourd’hui, c’est-à-dire comme un simple divertissement. Son approche est rigoureusement scientifique, chose qui a malheureusement disparu dans notre culture. Après deux ou trois générations d’une véritable dé-génération, la plupart des gens ne comprennent plus et n’ont plus un sens vivant de ce qu’on peut appeler le principe de Furtwängler.
Ce principe, qu’il a constamment exprimé, non seulement dans ses interprétations mais également dans ses écrits, ne se borne pas à nous informer de la manière dont la musique devrait être interprétée et comprise ; c’est un principe physique universel, qui doit nous amener à repenser et redéfinir notre conception ontologique de l’univers physique.
Entre les notes
Qu’est-ce qui rend les interprétations de Furtwängler aussi uniques ? M. LaRouche évoque souvent sa première écoute d’une œuvre dirigée par Furtwängler, en l’occurrence une symphonie de Tchaïkovski. C’était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il se trouvait dans une base militaire près de Calcutta : ce fut pour lui un véritable choc, quelque chose qui ne ressemblait en rien à tout ce qu’il avait expérimenté jusqu’alors. Il décrit un sentiment de suspense, maintenu sans relâche du début à la fin, qui le fit presque littéralement tomber de sa chaise – une cohérence remarquable du tout, en tant qu’unité, du début jusqu’à la fin. C’est ce qu’un autre chef d’orchestre [1] a décrit, ayant eu l’occasion d’assister à des répétitions de Furtwängler à Milan, comme une « tension électrique » imprégnant tout l’orchestre, dès le moment où Furtwängler entrait dans la salle. Omniprésente, cette tension imprégnait non seulement les notes en tant que telles, mais également les silences entre les notes audibles, là où il n’y a aucun son. Récemment, Lyndon a décrit cela comme « la pré-note » et « l’après-note » que l’on entend dans notre esprit, tandis que les notes audibles sont entendues par l’oreille.

Le prédécesseur et mentor de Furtwängler fut le chef d’orchestre Arthur Nikisch. C’est principalement grâce à lui, en l’entendant diriger, qu’il a développé un sens vivant de ce principe. On disait de Nikisch qu’il était capable de donner un sentiment ineffable, indéfinissable, de quelque chose « entre les notes ». Et je pense que cette idée de ce qui se passe « entre les notes » est exactement le genre de phénomène qui a lieu quand on écoute la musique de Furtwängler. Toute personne sensible, pourvu qu’elle ne soit pas devenue mentalement sourde et que son âme n’ait pas été asséchée par la musique populaire et la culture généralement cynique dans laquelle nous baignons aujourd’hui, serait immédiatement saisie en écoutant un enregistrement d’une interprétation de Wilhelm Furtwängler – et vous le seriez aussi !
C’est ce « mystère » qui nous rend capables de jeter un œil sur ce monde au-delà des murs de la prison où nous enferme notre expérience sensorielle.
Voici ce qu’était le secret de Furtwängler : si l’esprit peut expérimenter quelque chose de différent et d’indépendant des sensations en tant que telles, quelque chose qui les précède, alors cela signifie qu’il ne dépend pas de l’expérience sensorielle. L’esprit n’est pas la somme de toutes les expériences sensorielles qu’il a connues jusqu’à ce moment. Au contraire, du fait qu’elle appartient à un domaine chimique ou physique inférieur, l’expérience sensorielle devient subordonnée à la nature plus substantielle de l’esprit, dont elle dépend. Cette idée nous permet d’inverser cette conception de l’univers partant du bas vers le haut, et d’établir une hiérarchie ontologique d’un univers créateur engendrant de haut en bas tout ce qui est.
Furtwängler comprenait cette idée, avec toutes ses implications universelles. Il l’a découverte de l’intérieur du monde de la musique, tout en comprenant qu’il s’agissait d’un principe universel de l’esprit humain créateur, et de l’univers créateur.
Afin d’étayer cette affirmation, voici un court passage d’un écrit de Furtwängler où il traite de la façon dont l’interprète doit s’élever des multiples notes d’une partition vers l’unicité initiale de l’œuvre conçue par le compositeur :
Considérons l’acte de création artistique. Lorsque l’on regarde ce processus de plus près, on remarque que deux niveaux se distinguent. A un premier niveau, la combinaison de chaque élément avec ceux qui lui sont proches forme des éléments plus grands. Puis ces éléments plus grands se combinent avec d’autres, et ainsi de suite, dans une croissance logique en expansion, des parties vers le Tout. Mais à un autre niveau, la situation est inversée. L’unité donnée par le Tout contrôle le comportement des éléments qu’il contient, jusqu’au moindre petit détail. Le fait essentiel notable est que dans toute œuvre d’art authentique, ces deux niveaux se complètent l’un l’autre, de telle sorte que l’un ne devient effectif que lorsqu’il est associé à l’autre. » [2]
Musique Classique et science physique
Cette citation constitue l’affirmation ontologique [d’un processus unique ayant donné naissance à ce qui est, ndlr] la plus précise faite au cours du XXe siècle. Le fait qu’elle fasse écho aux préoccupations de certains des plus grands scientifiques de l’époque n’est pas une coïncidence – plus spécifiquement Albert Einstein et Max Planck. Ce n’est pas non plus un hasard que durant leurs loisirs – moment où, en réalité, ils réalisaient leurs plus grandes découvertes, comme le disait Einstein à sa manière – ces deux scientifiques aient pratiqué l’interprétation musicale classique. Planck était un pianiste et organiste très doué, Einstein un violoniste talentueux qui joua dans des quatuors à cordes.

Vernadski lui-même, contemporain également, disait que certaines des conceptions les plus profondes concernant le caractère vivant de l’univers lui étaient venues alors qu’il écoutait de la grande musique classique.
Ainsi, le musicien Furtwängler s’avère être un grand scientifique. Car le véritable domaine où l’esprit humain découvre sa propre identité en tant que substance créatrice, et où il en voit le reflet dans l’univers, est la science physique. C’est ce à quoi l’on prend part lorsque l’on interprète et que l’on comprend le grand art classique.
Il n’est pas étonnant non plus que Furtwängler, dans le passage que je viens de citer – l’unité du Tout animant le processus de transformation de chacune de ses parties – fasse écho à celui qui est certainement le plus grand philosophe des trois derniers siècles,
Gottfried Leibniz, qui a exprimé à plusieurs reprises exactement la même idée dans des écrits tels que le Discours de métaphysique (1686), La monadologie (1714), ou encore son De l’origine radicale des choses (1697) : il n’existe nulle part d’entité finie en tant que telle, ou de somme d’entités finies, pour laquelle on ne puisse trouver de raison suffisante à son existence. Au contraire, c’est dans le domaine de la substance supérieure, le Un, lequel se situe nécessairement au-delà de l’entité finie ou de la somme d’entités finies, qu’on peut trouver la raison suffisante à l’existence de cette entité finie ou de cette somme d’entités finies.
Ce n’est donc absolument pas un hasard que Furtwängler ait découvert un principe ne se cantonnant pas au domaine de la musique en soi, un principe physique universel, contenant en son sein l’ontologie de l’univers tout entier. Et ceci renvoie à l’importance de la pensée de Leibniz, ainsi que de LaRouche. C’est en partant de l’existence d’un processus créateur, en tant que substance nécessaire ayant engendré toutes les choses d’ordre fini, et d’un homme créateur à son image, et seulement ainsi, que l’on peut comprendre la puissance de ce que l’on expérimente en découvrant une composition musicale réellement classique.
Maintenant, j’aimerais m’amuser un peu en regardant comment le principe de Furtwängler nous permet de nous débarrasser des conceptions linéaires et tenaces concernant le temps, qui nous le font voir comme une horloge chronologique. S’il est vrai, comme l’affirme Furtwängler dans le passage que j’ai cité, qu’il y a une réciprocité mutuelle, dynamique et simultanée, entre le Tout et les parties, le Tout animant l’ensemble, alors où (et quand) ce Tout existe-t-il dans un morceau de musique ? Si la raison (ou la cause) de l’existence de chacune des parties ne peut se trouver dans les parties finies elles-mêmes, et si ce Tout anime le processus de transformation de chacune de ces parties, alors où ce Tout existe-t-il, s’il ne peut exister dans aucun des moments de l’expérience, c’est-à-dire dans ce que l’on considère comme le temps ?
Nous parlons donc de quelque chose qui n’existe nulle part dans l’expérience sensorielle, nulle part dans les parties de cette simple succession de notes en tant que telles ; l’existence du Tout ne peut être perçue à aucun moment par les sens. Cependant, si ce Tout doit exister en tout temps, animant tout au long du processus la transformation des parties, la question se pose alors de savoir où et quand ce Tout « unité » existe-t-il.
Si vous vous mettez un instant à la place d’un interprète, et si vous comprenez qu’à tout moment du processus vous devez nécessairement avoir à l’esprit le Tout-en-devenir, alors vous vous rendez compte que cela contredit toutes les notions linéaires du temps ! Il s’agit de quelque chose se situant complètement au-delà de l’idée d’une simple séquence temporelle ; comme si le chef d’orchestre lui-même – et Furtwängler décrivait cela avec passion – entendait le futur, comme s’il entendait ce Tout en devenir, alors qu’il n’existe pas encore dans l’expérience sensorielle. Vous n’avez pas encore atteint la fin du processus, du point de vue de l’expérience sensorielle, mais vous entendez à rebours, du point de vue du Tout à venir.
Le fait d’entendre « depuis le futur » ce Tout conduire le développement de chacune des parties dans le temps présent, est ce qu’expérimente l’interprète ; c’est ce qu’expérimentait Furtwängler, en tant que chef d’orchestre. Et c’est ce que LaRouche, en de nombreuses occasions, a appelé « la mémoire du futur » : un écho du futur se faisant entendre dans « l’oreille » du présent.
Et cela ne peut pas exister isolément ; le tout-en-devenir est quelque chose qui se développe en suivant le cours du temps, alors que l’autre directionalité procède à rebours depuis le futur – le Tout terminé – et interagit avec le processus des parties dans le déroulement temporel : le « temps au-dessus » interagit avec le « temps en dedans » – il s’agit là de l’expérience mentale de l’interprète.
Son « proche » et son « lointain »
Furtwängler exprime cela par ce que j’appellerais une « qualité dynamique de l’espace-temps musical ». Il utilise pour cela deux termes : le Nahören, que l’on pourrait traduire par « la perception aveugle du son dans le moment présent », et le Fernhören, qui est le « son entendu de loin », la « perception clairvoyante du son lointain du Tout », la perception du futur en devenir de la totalité. [3]
A noter que le Fernhören de Furtwängler a également été décrit par Wolfgang Amadeus Mozart, dans une lettre à sa sœur où il explique ce que signifie être dans l’esprit d’un compositeur. Comme Furtwängler à propos du Fernhören, Mozart décrit une « rumeur planant » sur le morceau, « comme venant d’au-delà » et qui n’est ni une succession de parties, ni une suite de notes, ni une simple succession de phrases, mais qui nous parvient d’un coup, instantanément, en un seul instant, en un seul souffle. Mozart utilise l’exemple d’un beau visage : ce ne sont pas les parties que nous voyons mais le visage, instantanément.
Où Mozart localise-t-il cette expérience ? Nulle part dans les perceptions sensorielles, nulle part dans la succession de simples sensations chimiques ou physiques en tant que telles : il la localise dans l’imagination. On comprend que le jeu d’ombres de l’expérience sensorielle n’est que le pâle reflet projeté – comme s’il s’agissait de mélodies inaudibles – depuis l’imagination. Afin de resituer cela par rapport à la question ontologique : si le Tout est plus réel, en termes de ce qu’il engendre, que les parties qui lui sont subordonnées et en dépendent, alors l’imagination – le seul domaine dans lequel ce Tout supra-temporel peut exister dans son entièreté – ne doit-elle pas être nécessairement plus réelle, en termes de ce qu’elle engendre, que le monde que l’on perçoit, ce monde que nous pensons toucher, voir, entendre, et que nous considérons comme réel ?
Le futur façonne le présent

LaRouche : Il existe un complément à ce que Matt vient de présenter dans mes propres travaux de prévision économique. Tous les prévisionnistes que j’ai eu l’occasion de connaître (dans le secteur académique de la prévision économique) se sont avérés intrinsèquement incompétents. La raison en est tout simplement que, comme nous l’avons étudié ici ou dans d’autres circonstances concernant les cycles du processus du vivant au sein de l’univers, c’est le futur qui façonne le présent et non l’inverse.
La plupart des gens, vis-à-vis de l’économie, ont été conditionnés à croire que la méthode déductive est celle qui détermine l’économie présente, une méthode soi-disant « réaliste ». La caractéristique des processus vivants en général, comme de l’esprit humain ou d’un prévisionniste économique compétent – ce que je proclame être – est, au contraire, d’anticiper le futur.
La question du futur en économie prend une forme très spécifique : on ne déduit pas à partir de ce que l’on sait, on crée quelque chose de nouveau nous permettant d’aller plus loin. Tous les artistes et scientifiques créatifs pensent ainsi, contrairement aux économistes, la plupart du temps. Il arrive à certains économistes d’avoir un éclair de génie, mais ce n’est pas ainsi qu’ils ont été formés à penser. Ces exceptions s’expliquent généralement par le fait qu’ils ont quitté leur domaine professionnel pour s’aventurer dans celui de la créativité. La créativité consiste simplement à découvrir un futur situé au-delà de l’expérience sensorielle. Elle implique de chercher un développement futur, n’existant ni dans le présent ni dans le passé.
Qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, considérons l’introduction d’une innovation d’une certaine qualité dans l’économie. La façon la plus simple d’expliquer ce genre de processus est de se placer du point de vue de la science physique, lorsque l’on découvre un nouveau principe. La créativité en mathématiques ou en physique consiste toujours à découvrir un nouveau principe inconnu jusque-là, un principe que l’autre gars ne connaît pas, car il a adopté l’approche déductive, il s’y tient et la défend déductivement.
Ce gars est un raté ! Il est dans le faux car il n’a pas réussi à reconnaître en quoi la découverte d’un principe est quelque chose de fondamental. Comment y parvient-on ? On met en évidence un problème, une erreur dans le système. On essaye de se figurer quel peut bien être le secret de cette erreur. Et c’est la même chose en musique.
L’humanité se distingue des animaux essentiellement par sa créativité. Toujours à chercher dans le futur, à découvrir un principe qui n’existait pas encore. Et lorsque l’on fait une découverte de ce type, on expérimente un état d’anticipation, un moment de suspension – un moment de tension où l’on se demande si l’on va réussir à faire le saut vers la prochaine étape.
Le problème est que dans notre société, très peu de gens sont capables de penser de manière créative. Brahms est quasiment le dernier musicien scientifique. Avec sa disparition, la musique est pratiquement morte, à l’exception de quelques échos dans le passé récent.
Ce fut un long processus : Bach a représenté la découverte d’un grand progrès, il est en lui-même une découverte à part entière ! Découverte après découverte, après découverte ! C’est la même chose que le principe de prévision. La différence entre l’homme et la bête est donc que la bête pense comme un comptable. Et les comptables pensent souvent comme les bêtes. On comprend cela dès que l’on a affaire à l’un d’entre eux.
On éprouve un sentiment de honte quand on réalise que l’on n’est pas créatif, que l’on fait toujours la même chose, alors qu’il faudrait quelque chose de nouveau, de frais, quelque chose qui résolve les problèmes et qui ouvre les portes à des choses que l’on n’avait jamais faites auparavant. Se rendre sur de nouvelles planètes, n’est-ce pas ? Aller dans l’espace. Faire face aux problèmes de défense de l’humanité au sein du système solaire. Quelque chose de nouveau, de frais ! Se sortir du processus de détérioration et de stagnation.
L’art comme acte d’amour
« Faire de la musique, comme compositeur ou comme interprète, est avant tout un acte d’amour. Un acte d’amour vis-à-vis de la musique qu’on porte en soi quand on compose ; quand on joue du Bach ou du Beethoven, on a affaire à l’amour qui animait Bach et Beethoven quand ils créaient leur musique. Amour de l’univers ou de l’humanité. Il y a aussi l’acte d’amour vis-à-vis de l’auditeur à qui on s’adresse, et avec qui on voudrait partager l’émotion musicale. On oublie trop l’unité de tout cela ; on a terriblement compartimenté la musique ; on en a fait une affaire de spécialistes ; des spécialistes qui ne s’aiment pas et refusent d’entrer en contact. »
Entretien donné par Furtwängler à Fred Goldbeck, de l’ORTF (en français, 1953)
II. Wilhelm Furtwängler : un combat culturel contre le fascisme
Par Benjamin Bak

Il est des hommes, dans la longue lignée de l’histoire humaine, dont la beauté et la justesse du combat peuvent se mesurer à l’aune de l’opprobre et de la calomnie qu’ils ont subies. Il en est ainsi du grand chef d’orchestre allemand Wilhelm Furtwängler. Cet homme souffrit d’avoir courageusement tenté de protéger la véritable culture classique allemande de la destruction orchestrée par les nazis, puis par l’oligarchie financière.
Pour comprendre son combat, il faut comprendre dans quel milieu il baigna, et ce dès son enfance. Sa famille fut en effet un terrain propice à la réflexion, à l’art et à la philosophie. Sa mère, Adelheid Wendt, dont le père avait été ami de Johannes Brahms, était peintre et son père, Adolf Furtwängler, cousin du mathématicien Philipp Furtwängler (professeur de mathématiques de Kurt Godël), fut un éminent archéologue, qui dirigea les fouilles allemandes à Egine, Mycènes et Olympie, et dont certains ouvrages sur la céramique grecque font encore autorité.
Furtwängler était des voyages de son père, et Elizabeth Furtwängler, sa future épouse, témoigne de son intérêt pour Beethoven déjà à cette époque : « Wilhelm m’a raconté qu’adolescent il avait accompagné son père à Egine, en 1901. Là, le jeune Furtwängler montait dès le matin dans les forêts de pins et les collines, et lisait les quatuors de Beethoven dans l’immensité solitaire de la nature. »
Genèse d’un chef d’orchestre d’exception
De fait, la manière dont Furtwängler concevra sa vocation d’artiste est imprégnée de l’idéalisme de la Grèce antique. Elizabeth Furtwängler témoignera de l’importance de la pensée de Schenker pour son mari, même bien après la guerre : « Wilhelm se passionnait pour le concept du fernhören que le musicologue juif viennois Heinrich Schenker situe au cœur de toutes ses considérations. L’écoute à distance, c’est-à-dire le fait d’entendre ou de percevoir sur une longue distance une grande continuité, est, pour Schenker, le signe distinctif de la grande musique classique. » Sa collaboration avec Schenker durera jusqu’en 1935, année de disparition du musicologue.
Furtwängler fut retiré très tôt du système scolaire. Il eut alors pour précepteurs l’archéologue Ludwig Curtis, les compositeurs Anton Beer-Walbrunn, Josef Rheinberger et Max von Schillings, ainsi que Conrad Ansorge, ami de Franz Liszt, pour le piano. Il devint chef d’orchestre à l’âge de vingt ans. Son premier concert eut lieu le 19 février 1906 à Munich, lors duquel il dirigea la Consécration de la maison de Beethoven, un poème symphonique en si mineur de sa propre composition et la Neuvième symphonie d’Anton Bruckner. En février 1912, il rencontra le chef d’orchestre Arthur Nikisch. Elizabeth Furtwängler dira plus tard : « Furtwängler affirmait qu’il n’avait appris que d’Arthur Nikisch. (…). A ses yeux, parmi les chefs d’orchestre, nul autre qu’Arthur Nikisch n’était digne de considération. » En 1922, il prit sa succession à la tête des orchestres du Gewandhaus de Leipzig et de la Philarmonique de Berlin.
Furtwängler s’affirmera donc comme le plus grand représentant de l’héritage classique allemand. Bien que ne refusant pas de jouer des œuvres de musique moderne (atonale) comme celles d’Arnold Schoenberg, Béla Bartok ou Igor Stravinsky, il défendra toute sa vie durant, et surtout vers la fin, la musique tonale comme seul moyen d’exprimer des Idées en musique.
Furtwängler milita aussi pour la paix entre les nations à travers les relations artistiques et culturelles. Par exemple, il continua à diriger de la musique française en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, dont la Carmen de Bizet. Il joua également un rôle de premier plan dans le rapprochement culturel avec la France, suite aux accords de Locarno.
Or c’est à cette époque que les attaques commencent. Lors de sa première représentation à New York en 1925, il dirige la Cinquième symphonie de Brahms, qui fut accueillie par quinze minutes de standing ovation. Les membres de l’orchestre, ainsi que d’autres musiciens, le proposent alors comme chef d’orchestre régulier à NewYork, ou à la Philharmonique de la ville. Or cette initiative n’est pas du goût d’un certain Olin Downes, correspondant du New York Times, qui, par ses critiques calomnieuses, réussit à saboter l’initiative. Rappelons que c’est le New York Times qui louera la politique d’apaisement de Neville Chamberlain vis-à-vis d’Hitler... C’est donc bel et bien l’establishment de la côte Est qui contrôle les institutions musicales de New York, et son but est clair, comme nous le verrons plus tard : remplacer l’héritage classique de Beethoven par de la « musique moderne ». A la place de Furtwängler est affecté l’« antifasciste » autoproclamé Arturo Toscanini, pur produit de la culture vénitienne et ancien candidat du parti fasciste italien à Milan aux élections parlementaires de 1919...
Un humaniste classique contre le IIIème Reich...
Mais le combat de Furtwängler prend un tour plus dramatique en 1933. Le régime nazi arrive au pouvoir, et les relations amicales du musicien avec de nombreuses personnalités juives comme Heinrich Schenker et surtout Paul Hindemith, sont sujet de querelle avec le régime. On reprochera plusieurs fois à Furtwängler d’être resté en Allemagne pendant cette période. Mais c’est précisément durant cette période que son combat en défense de l’héritage classique allemand s’affirme véritablement. En effet, bien que les nazis prétendent défendre l’art allemand en interdisant totalement la musique atonale, leur volonté de destruction de tout produit culturel remettant en cause leur hégémonie, les pousse à attaquer la culture classique allemande elle-même, de par son amour « dérangeant » pour le vrai. Le poète Heinrich Heine subit les autodafés de 1933, le Guillaume Tell de Schiller est interdit par Hitler lui-même le 3 juin 1941 en tant que « drame de la liberté », et la politique d’aryanisation du répertoire aboutit à l’interdiction des œuvres de Jean-Sébastien Bach à Königsberg en 1944, à cause de ses soi-disant « textes infestés par les Juifs ».
C’est en 1934 que s’amorce le véritable affrontement entre Furtwängler et le régime, et il ne cessera de s’intensifier. En effet, le maître persiste à diriger les œuvres de Félix Mendelssohn, comme le 12 et 13 février 1934 où il présente le Songe d’une nuit d’été à Berlin, alors que la musique du compositeur juif a été totalement interdite par le régime. La tension atteint un point critique lorsqu’il dirige Mathis le peintre de Paul Hindemith le 11 mars 1934, alors qu’Hitler veut interdire les compositions de ce dernier. Excédé par les attaques de la presse nazie, Furtwängler publie un article dans le Deutsche Allgemeine Zeitung le 25 novembre 1934, intitulé « Le cas Hindemith ». L’affaire prend alors une tournure politique, et les attaques venant de partout, aussi bien d’Heinrich Himmler que d’Alfred Rosenberg (principal théoricien du nazisme), Furtwängler démissionne le 4 décembre 1934 de ses postes de chef de la Philharmonie de Berlin, directeur du Staatsoper de Berlin, vice-président de la Chambre de la musique du Reich et Conseiller d’Etat de Prusse.
En 1936, le cours de sa vie est sur le point d’être bouleversé : la direction de l’Orchestre philharmonique de New York lui propose en effet de succéder à Toscanini. Furtwängler accepte, mais une mystérieuse dépêche de l’agence berlinoise de l’Associated Press annonce que le chef d’orchestre est rétabli dans ses fonctions de directeur de l’opéra de Berlin. Les milieux de l’establishment hostiles à Furtwängler utiliseront plus tard cet événement pour donner de lui l’image d’un nazi camouflé... Devant l’intense polémique déclenchée outre-Atlantique, il renonce à la proposition new-yorkaise, par un câble rendu public le 15 mars 1936.
En 1937, le chef d’orchestre se rend au festival de Salzbourg, devenu centre des musiciens antinazis, Hitler ayant interdit aux musiciens allemands de s’y produire, pour diriger la Neuvième symphonie de Beethoven. Toscanini, présent à ce festival, se rachète une virginité en attaquant violemment Furtwängler en raison de sa présence en Allemagne. Par la suite, les relations avec le régime ne font qu’empirer, pour atteindre un point de non-retour en 1938, quand Hermann Göring sort de son chapeau un chef d’orchestre dont le style fanfare n’a d’égal que sa capacité à faire des compromis avec le régime : il s’agit d’Herbert von Karajan, que le ministre de la propagande Josef Goebbels fait tout pour placer à la tête de l’Orchestre philharmonique de Berlin, à la place de Furtwängler. Cette période devient de fait une source de profond désespoir pour notre chef d’orchestre. Cette année-là, qui voit la sanglante « Nuit de cristal », il sauve la vie de plusieurs musiciens juifs comme Carl Flesch et son épouse, ou Heinrich Wollheim, musicien de l’opéra de Berlin.
En 1942, il apparaît dans le concert qui lui sera le plus reproché après-guerre, dirigeant la Neuvième symphonie de Beethoven, jouée dans le cadre de l’anniversaire d’Adolf Hitler. Il faut savoir que notre chef d’orchestre avait justement planifié une série de concerts à Vienne en Autriche pour éviter de se produire lors de cet anniversaire.
Mais Goebbels annule les concerts pour faire revenir Furtwängler de force à Berlin. Traumatisé par sa participation à cet événement, il va multiplier les certificats médicaux en avril 1943 pour pouvoir disparaître ; celui qu’il obtient lui vient du docteur Johannes Ludwig Schmitt, résistant membre du Cercle de Kreisau. Cela lui permet d’éviter non seulement l’anniversaire d’Hitler de 1943 mais aussi un congrès gigantesque organisé par Goebbels en Turquie pour manifester une « force culturelle antijuive ».
En janvier de cette année-là, Heinrich Himmler obtient ce qu’il cherchait depuis 1933 : l’autorisation de faire arrêter Furtwängler par ses Waffen SS. Mais Furtwängler parvient à rejoindre sa femme en Suisse. D’après Elizabeth, c’est là que va débuter le second combat culturel de Wilhelm Furtwängler, qui se confond avec celui de sa réhabilitation.
...et contre l’oligarchie financière !
Ainsi en 1946, il passe en procès devant le Tribunal de dénazification. Trois personnes d’origine juive viennent témoigner en sa faveur et certifient, le 17 décembre 1946, que le chef d’orchestre a risqué sa vie pour les protéger. L’un d’entre eux est Paul Heizberg, ancien directeur d’opéra. Furtwängler est innocenté le jour même.
Maintenant, pour comprendre la seconde phase du combat politique de Furtwängler, il faut nous attarder sur le sinistre John McCloy. Né en 1895 à Philadelphie, McCloy est juriste et banquier au service des « Sept Sœurs », compagnies pétrolières les plus puissantes au monde, comptant la Royal Dutch Shell, la British Petroleum ou encore la Standard Oil (John D. Rockefeller). McCloy est assistant du secrétaire d’Etat à la Guerre de 1941 à 1945, et il occupera aussi le poste de Haut commissaire américain pour l’Allemagne d’après-guerre.
En 1948, les ennuis recommencent. Furtwängler est invité à diriger l’Orchestre symphonique de Chicago, avec une tournée prévue pour 1949. Mais un groupe de musiciens de premier plan, incluant les principaux chefs d’orchestre actifs en Amérique du Nord comme Arturo Toscanini, George Szell, Eugene Ormandy et les musiciens Jascha Heifetz, Isaac Stern, Vladimir Horowitz, Gregor Piatigosky et Arthur Rubinstein, organisent une campagne diffamatoire envers Furtwängler, le faisant passer pour un nazi. Nous n’apprendrons que bien plus tard, lors d’une interview donnée par son épouse à l’Executive Intelligence Review (EIR), le 24 janvier 1986, le rôle de John McCloy dans les actions de ce groupe.
John McCloy était-il anti-nazi ? En 1950, il fera relâcher les industriels nazis Alfried Krupp et Friedrich Flick, qui avaient utilisé la main d’œuvre des camps de concentration pour leurs usines, en vue de doper la production d’acier allemand pour fabriquer les armes de la guerre de Corée.
Et dans le domaine intellectuel, il fera partie, avec Bertrand Russel et Théodore Adorno, entre autres, et via les fondations Ford et Rockefeller, des instigateurs du Congrès pour la liberté de la culture. Contrôlé par la CIA, ce dernier, promouvant l’art contemporain ainsi que la culture sexe-drogue-rock’n roll, aura, à l’époque de la guerre froide et du maccarthysme, et sous prétexte de « liberté culturelle », pour but d’exercer sur les peuples un véritable contrôle social.
Wilhelm Furtwängler ne sera pas cependant la victime expiatrice des crimes nazis. Atteint d’une surdité partielle, il se laissera mourir d’une pneumonie à l’hôpital de Baden-Baden le 30 novembre 1954, dans une profonde sérénité. Sur sa pierre tombale, toujours visible au cimetière de Heidelberg, il a fait graver une citation de la première épître de saint Paul aux Corinthiens, Chapitre13 : « Nun aber bleibt Glaube Hoffnung Liebe diese drei aber die Liebe ist die grôsste unter ihnen », c’est-à-dire : « Et maintenant demeurent la foi, l’espoir et l’amour. Mais parmi les trois, c’est l’amour qui est le plus grand. »


Quand Furtwängler parle de la musique comme étant située entre les notes, quand il exige que la conception de l’ensemble de l’oeuvre guide chacun de ses développements, et qu’il demande aux interprètes de remonter du cahier noirci par les notes, à la totalité de l’oeuvre telle qu’elle a été conçue par l’intelligence de son auteur, il se situe dans la droite ligne de deux grands penseurs de la musique, Platon et Saint Augustin qui dans La République et De Musica respectivement, disent que les sons ne constituent que l’empreinte sonore, tant de l’ordre harmonique de l’univers que de la pensée des compositeurs.
III. Faire jaillir l’étincelle créatrice de l’homme
Premier entretien de Wilhelm Furtwängler avec Walter Abendroth
Extrait de Musique et Verbe
Abendroth : Je vous ai aperçu hier, au concert de l’Orchestre philharmonique, à une place qui ne vous est pas habituelle : dans la salle. Vous étiez venu écouter votre confrère X.
Furtwängler : En effet, je m’intéresse à présent à des questions que pendant longtemps, faute de loisirs, il m’a fallu écarter. J’ai grand plaisir à aller au concert, à écouter de la musique. Et j’en tire avantage : cela me permet d’observer objectivement, et comme du dehors, ma propre activité d’interprète, et de me rendre compte de pas mal de choses auxquelles je ne pense guère lorsque j’y suis mêlé comme acteur. Et ne serait-ce que pour apprendre ce qu’il ne faut pas faire…
Comme hier soir, par exemple… car je ne pense pas que vous ayez approuvé l’enthousiasme du public.
Évidemment non. Et pourtant j’ai compris ce succès : le concert d’hier soir faisait indubitablement « de l’effet » ; - un effet, il est vrai, sans rapport avec le caractère et la valeur de ce qui fut joué. Effet tout extérieur, d’un genre que j’appelle « illicite »… C’est que le public ne se rend pas compte si un effet est au fond – au niveau de l’art – valable ou non. Tous les publics – même, et surtout, notre public berlinois qui est typiquement un « public de grande ville » – commencent par être des foules passablement amorphes qui réagissent sans discrimination, et comme automatiquement, à tout ce qui les frappe. Leur réaction première peut être la bonne ; mais elle peut aussi être absolument mal fondée. Ajoutez à cela que telles premières impressions dépendent de circonstances particulières et fortuites – à tel point que, souvent, ceux-là mêmes qui les ont les plus vivement ressenties ne sont pas longs à ne plus comprendre qu’ils aient pu ainsi réagir. Comment se fait-il, par exemple, que non seulement des musiques de concert, mais même des opéras comme Carmen, Aïda ou La bohème, soient « tombés » à leur réaction – pour rencontrer par la suite le succès le plus complet et le plus durable ?
C’est une question à laquelle on n’a jamais, que je sache, répondu de façon tout à fait satisfaisante.
Je crois bien que non… Mais c’est parce que tout ce qui se passe en public se passe dans un domaine où règnent des forces instinctives, inconscientes et imprévisibles. Dans la vie musicale, ce que l’on nomme « le public » est une entité qui est loin de voir clair en soi-même – loin de connaître son propre goût. Pour savoir ce qu’il aime et ce qu’il désapprouve, il faut au public (de même qu’à l’auditeur isolé) avant tout une chose : il lui faut un certain temps. Le temps est indispensable pour faire vraiment connaissance avec une œuvre, surtout lorsqu’il s’agit de musiques sans texte ni « programme ». Or, il est difficile de prédire combien de temps il faudra pour connaître, pour comprendre telle musique ou tel musicien. Parfois il y faut des dizaines d’années, voire plusieurs générations : pensez à Jean-Sébastien Bach, aux dernières œuvres de Beethoven, à des cas comme celui de Bruckner.
Cependant – il ne faut pas l’oublier – dans un grand nombre de ces cas, ce sont les mauvaises exécutions qui retardent ou empêchent la compréhension ; car, outre la qualité de la musique et la réceptivité de l’auditoire, il faut toujours compter avec un troisième facteur (très souvent inconnu) : la qualité de l’exécution. C’est que la musique dépend de ses intermédiaires. Elle ne peut pas, comme les arts plastiques, s’extérioriser elle-même ; il est évident que c’est de l’exécutant (chanteur, chef d’orchestre, etc.) que dépend (en premier lieu et pour une bonne part) le sort d’une musique inconnue de l’auditeur. Si, dans ces cas-là, il arrive rarement qu’un interprète rende un morceau meilleur qu’il n’est, il est au contraire fréquent que de la bonne musique soit mal interprétée. Mais, à l’auditeur qui ne connaît pas, ou pas assez, l’œuvre qui le laisse froid, il est absolument impossible de discerner si c’est à l’ouvrage ou à l’interprète que ce manque d’effet doit être imputé.
La direction de l’Orchestre philharmonique a publié récemment une liste des ouvrages favoris du public de Berlin, un catalogue des morceaux qui « font recette ». On en peut tirer d’intéressantes conclusions sur la psychologie du public.
Je sais ce que vous voulez dire ; c’est la vieille histoire du public « paresseux » qui veut toujours réentendre les mêmes « succès » et ne veut (ou même ne peut) affronter les œuvres nouvelles, etc. Mais à mon tour, je demanderai d’où vient que les belles œuvres finissent, à la longue, par percer – par s’imposer sans réplique, avec une logique tranquille et mystérieusement infaillible. Sur quoi repose le jugement rendu par la « postérité » que nous avons pris l’habitude de considérer comme la dernière instance ?
D’ailleurs, quant aux célèbres « favoris » du public – d’après la statistique de l’Orchestre philharmonique, ce seraient notamment les symphonies « impaires » de Beethoven, l’Inachevée de Schubert, certaines œuvres de Tchaïkovski, etc. – cette préférence pourrait avoir, en partie, des raisons pratiques.
Ces œuvres se distinguent en effet par une grande clarté, par un dessin dont on suit aisément les lignes, par le relief des idées musicales ; ainsi elles résistent même à une exécution faible ou confuse. Elles sont moins dépendantes de la valeur de l’exécution. A être maniées par des interprètes incapables, elles souffrent moins que d’autres œuvres, moins populaires, mais non de moindre valeur. Mais au lieu de nous demander la raison de la popularité actuelle de telle œuvre, il serait bien plus intéressant, me semble-t-il, de savoir comment certaines partitions s’y prennent pour conserver leur place si longtemps et avec tant de continuité – et pourquoi leur efficacité, pourtant si évidente qu’elle risque de manquer de mystère, s’use si peu avec le temps. Il y a un grand nombre d’œuvres qui ont « fait de l’effet » (peut-être, sur le moment, plus d’effet que celles que j’ai citées), mais qui, par la suite, se sont étiolées, et dont quelques-unes ont même complètement disparu. Et il semble que parmi ces œuvres-là, figurent justement celles qui ont visé à l’effet avec le moins de vergogne.
Telles œuvres du grand virtuose Liszt, une partie de celles de Berlioz, Wagner, Strauss, Tchaïkovski, et autres. C’est que « l’effet immédiat » est une chose et « l’effet à la longue », une autre. On pourrait même dire qu’un effet trop grand, trop voulu, trop pressé de réussir, contrarie l’action profonde et durable ; il l’a souvent même tout à fait empêchée.
N’avez-vous pas remarqué que, dans la vie courante, vous pouvez être « impressionné » par quelque chose et que pourtant, à l’instant même, vous vous rendiez compte que cette impression était peu valable ? La réaction du public, étant inconsciente, sera toujours adéquate, d’une manière ou d’une autre, à l’effet qui la suscite. Aussi y a-t-il des œuvres qui déchaînent des applaudissements en quelque sorte vides et insignifiants, pour bruyants et tumultueux qu’ils soient.
Et c’est là exactement le genre de succès qu’elles méritent. Il en est d’autres qui font réagir le public d’une façon moins éclatante, et dont non seulement la valeur est incomparablement plus grande, mais encore l’effet incomparablement plus profond. C’est une erreur certaine que de conclure de l’action sur le public, c’est-à-dire du succès extérieur, à la qualité véritable de l’effet produit. Il est évidemment encore plus trompeur d’en conclure à la valeur d’une œuvre d’art. Le public lui-même – cet être bizarre – ignore comment et pourquoi il réagit ; il réagit inconsciemment, automatiquement, à peu près comme un baromètre. Il importe de savoir bien lire ce baromètre.
Le public lui-même en est incapable. A tel point que l’individu, fût-il des plus intelligents – j’en ai fait cent fois l’expérience –, est incapable de voir clair dans son propre jugement. Si on le questionne, sa réponse, c’est-à-dire son jugement conscient, reflète toute sorte de préjugés, toute sorte d’associations d’idées qui encombrent sa conscience, plutôt que l’impression réelle qu’il a reçue. C’est seulement avec celle-ci (et non pas avec les idées et préjugés qui font partie de son individualité limitée) qu’il contribue à former l’authentique « opinion publique » ; laquelle se forme inconsciemment, et selon certaines lois. Aussi Dingelstedt, vieux routier du théâtre, disait-il, à peu près, et non sans raison : « Mille spectateurs, parmi lesquels chacun juge de travers, font, tous ensemble, un public fichtrement intelligent… »
Ne serait-ce pas le devoir de la critique que d’expliquer l’idée que se fait le public, et de soi-même, et de ses propres jugements ?
Elle ne le peut pas – quand bien même elle le voudrait et s’imaginerait le pouvoir. Car elle-même fait partie du public.
Si la réaction immédiate du public est souvent injuste, son jugement définitif est pourtant fondé. J’ai donné déjà la raison de ce paradoxe : c’est qu’il faut du temps pour entendre un artiste et répondre à son œuvre. Et il en faut d’autant plus que l’artiste sera plus original et l’œuvre profonde. Il est tout naturel que, de prime abord, le public oppose de la résistance à ce qu’il ignore. Et pourtant, il est absolument certain qu’à la longue, il sera vaincu par la nouveauté – si toutefois elle est vraiment de qualité.
Tâchons donc de nous rendre compte de ce qui se passe entre l’artiste et le public. D’abord, l’un et l’autre ne deviennent vraiment « eux-mêmes » que dans leur rencontre, et par cette rencontre. Tant que l’artiste n’a pas dompté son public, tant qu’il n’a su en réveiller et aiguiller les inconscientes aspirations vers l’œuvre d’art, ce public (et au lieu de dire : « le public », on dirait aussi bien « le peuple ») ne prend ni conscience de soi-même, ni de sa qualité de public, mais reste ce qu’il était tout d’abord : une foule quelconque indéfinie.
Qu’en serait-il, par exemple, de toute notre « Vie musicale » si – supposition paradoxale – Beethoven n’avait pas écrit ses symphonies ? Prédécesseurs et successeurs de Beethoven, et surtout Beethoven lui-même, ont, en fait, créé, par l’action de leurs œuvres, ce que nous avons depuis appelé « le public de concert ». Ce public-là est sans doute autre chose qu’une foule amorphe et passive. Depuis que des maîtres l’ont formé, il porte en lui une échelle de valeurs. Il a des exigences ; l’artiste devra y pouvoir. Et l’artiste, à son tour, a des exigences envers le public, exigences auxquelles le public ne demande qu’à répondre : car c’est d’elles qu’il tire sa véritable dignité. C’est qu’il y a public et public : il y a une grande différence selon qu’une foule « devient un public » à l’occasion d’une course de chevaux ou d’un combat de boxe, ou à l’occasion d’une symphonie de Beethoven. La qualité – qui seule importe – de son « unanimité de public » ne sera pas, dans le cas sportif, la même que dans le cas musical.
Mais encore : même lorsqu’il s’agit du seul domaine des événements artistiques, nous constatons des différences de cette sorte. Wagner appelle « Effekte » (effets extérieurs) les effets qui ne visent qu’à « frapper » la foule et qui peut-être l’emballeront momentanément, mais n’en feront pas une véritable communauté. L’Effekt, disait-il, est par définition « effet sans cause », et c’était précisément à l’époque de Wagner, à l’époque de l’avènement des grands virtuoses, que les musiciens se mirent à rechercher ces « effets sans cause » et à s’en servir. Mais ainsi, pour la première fois, les rapports du public avec l’artiste devinrent le problème qu’ils sont aujourd’hui : c’est alors que commença, de l’un à l’autre, cette progressive aliénation qui, à présent, met en question toute notre « vie musicale ». Vouloir faire de l’effet à tout prix : ce fut là, dès l’époque de Wagner et de Liszt, le signe que l’on allait vers la désaffection. Et, par la surenchère de l’effet, on cherchait éperdument à garder un contact qui menaçait rupture, et à maintenir entre les musiciens sur l’estrade et les auditeurs la « vraie communauté ».
Mais voilà : transformer un public en « vraie communauté », ne fût-ce que momentanément, il faut pour cela des œuvres qui sachent empoigner l’individu, non pas en tant qu’individu isolé, mais comme faisant partie d’un peuple, comme faisant partie de l’humanité, comme créature habitée par une étincelle divine. C’est seulement grâce à de telles œuvres qu’un public prend pleine conscience des forces latentes qu’il porte en lui ; et ce n’est que de ces œuvres-là qu’au plus profond d’eux-mêmes les hommes ont vraiment besoin, en dépit de leurs réactions superficielles, de leurs arbitraires entraînements et de leurs prédilections momentanées. Ce qui n’empêche pas que, dans la vie musicale de tous les jours, toutes les fois qu’il les rencontre, le public oppose la plus vive résistance à de telles œuvres, et ne s’abandonne que de mauvaise grâce. En quoi le public ressemble à une femme qui ne trouve son bonheur qu’à céder à la contrainte.
Voulez-vous dire par là que l’effet produit sur le public serait plutôt un argument contre une œuvre ?
Ce serait raisonner de façon hâtive et simpliste. Qui nierait, par exemple, la valeur des œuvres d’un Beethoven à cause de leur effet sur le public ? Au contraire, c’est précisément « le fait Beethoven » qui nous permet le mieux de comprendre ce qu’est l’effet authentique et « légitime ». C’est que les œuvres de Beethoven produisent leur effet absolument et exclusivement par ce qu’elles sont – par leur essence, non par leur façade. Et encore : si Beethoven a cette efficacité, c’est grâce à la clarté avec laquelle il exprime ce qu’il a à dire. Le maximum de clarté dans l’expression est, pour l’artiste, la manière – la seule bonne manière – de tenir compte de son public. Goethe l’a bien dit : « Si quelqu’un a quelque chose à dire, qu’il me le dise clair et net. Pour ce qui est des choses problématiques, celles que je porte en moi me suffisent. »
Mais pour répondre à cette exigence, il faut que tout d’abord on ait vraiment quelque chose à dire ; et que l’on puisse oser se montrer sans apprêt ni voile, tel que l’on est – et cela n’est évidemment pas donné à tout le monde. Et tous ceux qui dans la vie, et même (et surtout) dans leur art, s’expriment de façon tarabiscotée, j’ai peur qu’ils n’aient, le plus souvent, de bonnes raisons pour éviter la manière simple et directe.
Il y a des œuvres qui font de l’effet parce qu’elles visent à en faire et s’y efforcent. Il en est d’autres qui, pour faire de l’effet, n’ont qu’à exister. Et c’est pourquoi l’action des unes à la longue s’exténue, alors que le temps ne semble point entamer l’efficacité des autres.
 COMMENTAIRES
COMMENTAIRES