[sommaire]

Bien que dans le domaine de la santé certaines données et appellations aient pu évoluer, les dangers qui la menacent demeurent.
Ainsi, notre livre Tous centenaires et bien portants, pour une politique de santé publique sans exclusion, écrit par Agnès Farkas, Christophe Lavernhe en collaboration avec Jacques Cheminade et publié par Solidarité & Progrès en mars 2000, reste d’une très grande actualité.
Extraits.
Avant-propos
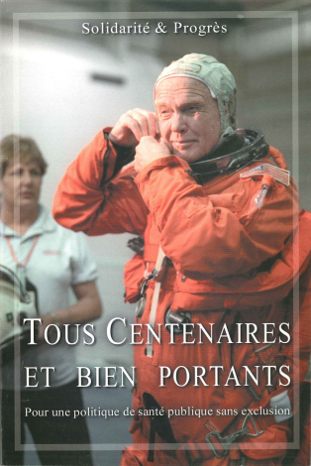
Contrairement à des préjugés hélas trop répandus, l’avancée en âge n’est pas synonyme de gâtisme. L’allongement de la vie jusqu’à la centaine et au-delà dans les pays développés marque une véritable révolution : pour nous-mêmes et pour les quatre milliards d’êtres humains qui manquent encore de tout en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Mais il y a un obstacle, de taille. Soumise à la pression d’une bulle financière spéculative avide d’argent frais, la protection sociale se voit imposer des critères de rentabilité immédiate incompatible avec le maintien de bonnes conditions sanitaires. Le rationnement des prestations, la privatisation des activités médicales et sociales les plus immédiatement lucratives opèrent un triage — voulu — des plus faibles et des plus démunis. A terme, c’est un retour massif en arrière qui se traduira fatalement par une régression de l’espérance de vie.
L’amélioration générale de notre protection sociale, avec une médecine de haut niveau, est une nécessité absolue si l’on veut une société dans laquelle la contribution de chaque être humain est considérée comme le bien le plus précieux. Il faut pour cela investir à grande échelle dans la recherche sur les mécanismes encore très mal connus de la vie, dans la densification du réseau d’équipements intégrant les dernières technologies, et dans une politique de prévention basée sur un dépistage sélectif, de masse. De tels investissements, lourds au départ mais rentabilisés ensuite par leur plus grande efficacité et l’amélioration de la santé publique, impliquent à leur tour une réforme en profondeur du système de rente financière mis en place dans les années 70, incapable désormais d’assurer un avenir à toute la société.
Le choix fondamental est ainsi immédiatement devant nous : régression de l’espérance de vie dans le contexte de contraction économique actuel ou "révolution du grand âge" dans le contexte d’un retour à une véritable politique de croissance et de développement mutuel.
Ce livre-programme a été écrit pour tous ceux qui combattent pour la vie, combat sans lequel il ne peut y avoir d’espérance collective.
Ce que nous voulons
Principes
- Tous ceux qui habitent notre pays ont le droit de vivre mieux, plus longtemps et bien portants.
- Au-delà même de la santé individuelle de chacun des résidents en France, la santé publique et la protection sociale font partie du patrimoine productif de la nation. Il ne s’agit donc pas de dépenses à couper mais d’investissements à accroître.
- Il faut revenir à l’esprit de la Sécurité sociale de 1945 et mobiliser la santé publique à la frontière des nouvelles découvertes scientifiques sur la vie. Nous réclamons une rupture fondamentale avec l’ordre financier ultralibéral et sa logique de profit immédiat, qui donne priorité à la rente financière et non à la vie. On lui substituera une logique de responsabilité publique et d’investissement à moyen et long terme. C’est seulement en levant cette hypothèque qu’une défense de la vie deviendra possible.
- Mesurés en terme d’économie physique, le social et l’économique ne sont pas deux catégories distinctes, mais des éléments complémentaires d’un même pouvoir transformateur de l’Homme, la raison d’être de sa vie.
Domaines d’action
Vivre plus longtemps en bonne santé n’est possible que dans une économie de haute valeur ajoutée, où il y a de moins en moins de postes à travail répétitif et de plus en plus d’emplois liés à la recherche, la technologie et l’organisation.
- L’effort immédiat doit porter sur l’amélioration de ce qui existe : fonctionnement des urgences hospitalières, soins et hébergement du « troisième âge », revalorisation des salaires et des statuts du personnel soignant ...
- Les hôpitaux de référence doivent être dotés en permanence des dernières technologies (appareils d’imagerie médicale, de télémédecine, de microchirurgie ...), ce qui est incompatible avec le système actuel « d’enveloppe globale », véritable carcan budgétaire. La Résonance magnétique nucléaire (RMN), par exemple, était vue à ses débuts comme un coûteux appareil de laboratoire, jusqu’au jour où l’on s’est aperçu des possibilités fantastiques de l’imagerie médicale par résonance pour établir des diagnostics.
- Il faut pousser en même temps les feux de la recherche publique dans les nouveaux domaines des sciences de la vie (biophysique optique), notamment pour enrayer l’épidémie du sida, qui touche à 95% les pays sous-développés (70% des cas de sida dans le monde sont concentrés en Afrique sub-saharienne, où l’on annonce 23 millions de morts d’ici dix ans). Le principe doit être de travailler à ce qui paraît être aujourd’hui la frontière de la vie, pour en étendre demain le champ.
- Dans ce contexte, la « Sécu » sera chargée de mettre le progrès et les équipements à la portée de tous, pas de faire du rationnement. Comme souvent, ce qui coûte cher au premier abord engendre des économies par la suite.
- L’hôpital sera de plus en plus réservé aux soins lourds et/ou urgents. Le développement d’une hospitalisation à domicile de qualité, de centres de vie pour les convalescents et pour les personnes âgées allégera la charge de l’hôpital tout en offrant un environnement propice à leur rétablissement.
- Une médecine de qualité n’est pas incompatible avec l’existence de cliniques privées, à condition de leur donner des missions de service public. Actuellement, les fonds financiers qui ont investi dans la santé écrèment les maladies ou les opérations « rentables » et multiplient les actes pour faire du profit.
- Il en est de même pour les médecins libéraux dont le statut, qui remonte à un siècle, doit être revu en fonction des impératifs actuels de santé publique. La nation doit leur dire ce qu’elle attend d’eux et leur donner les moyens qui en découlent ; le choix de l’implantation géographique et éventuellement de la spécialité doit se faire en fonction des besoins par région. Pour soulager l’hôpital, la médecine libérale doit assurer une garde effective et faire de la prévention.
- Seuls se recyclent aujourd’hui les médecins qui le veulent, et à leurs frais. La formation permanente des médecins doit être gratuite, obligatoire et systématique, en fonction des besoins.
- Une véritable prévention passe par un dépistage sélectif systématique. Avec des technologies qui restent à développer (spectroscopie de masse), on pourra évaluer et prévenir les risques individuels (prédisposition au cancer, à la maladie d’Alzheimer, etc.) et établir des cartes épidémiologiques par affection.
- Il faut aussi une éducation de masse à la prévention sanitaire, avec des médecins scolaires plus axés sur la prévention et du travail en plus grand nombre.
L’enjeu du XXIe siècle est ainsi de prolonger la vie humaine en la comprenant mieux, de faire de l’hôpital un lieu où chacun puisse bénéficier des meilleurs soins de son temps et de mettre en place, en Afrique et dans toute l’Eurasie, une infrastructure médicale et hospitalière moderne, ayant accès à de bons médicaments. Il s’agit d’un changement complet de mentalité ; mettre l’économie au service de l’Homme, surtout lorsqu’il est pauvre, vieux et malade, pour créer une société de solidarité et de progrès mutuel.
Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie, sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? Erasme.
Introduction
L’humanité vit une révolution silencieuse, entamée il y a trois siècles et en accélération depuis la dernière guerre. Elle pourrait se résumer ainsi : plus nous vieillissons, moins nous avons des chances de mourir. Sur le seul XXe siècle, un pays comme la France a gagné plus de vingt cinq ans en espérance de vie, soit autant que sur les 5 000 années précédentes. Si aujourd’hui l’espérance de vie à 60 ans est de vingt ans, elle pourrait doubler au cours du prochain siècle.
Alors qu’au début du siècle quatre Français sur dix atteignaient l’âge de 65 ans, ils sont aujourd’hui quatre sur cinq. Nous gagnons un an tous les quatre ans et rien ne permet de voir les limites de cette progression. A l’échelle de la planète cette fois, l’espérance de vie moyenne de la population mondiale s’est accrue de dix-neuf ans entre le début des années 50 et 1996 (de 47 à 66 ans) [1].

Cette révolution se trouve aujourd’hui remise en question. Suite à l’effondrement du niveau de vie, l’espérance de vie a commencé à décroître dans un certain nombre de pays depuis le début des années 90. Les politiques de coupes budgétaires et de privatisations mises en œuvre par le Fonds monétaire international (FMI) et par la Banque mondiale font perdre en ce moment à la Russie un million d’habitants par an.
L’Afrique, dont on pille les matières premières, subit en même temps un holocauste démographique : 70% des cas de sida dans le monde se trouvent en Afrique sub-saharienne, et l’on y prédit 23 millions de morts d’ici dix ans.
En Europe même, la concurrence acharnée entre entreprises et pays qui caractérise la « globalisation » est incompatible avec une politique de santé publique. Les investissements à l’échelle d’une génération sont considérés de fait comme des dépenses qu’il faut réduire. Les explications données au « trou de la Sécu » et au déficit des retraites - « trop de vieux », des hôpitaux inefficaces ou une Sécu mal gérée - ne sont que le prétexte à des « réformes » qui soumettent le secteur de la santé à la privatisation et au gain immédiat.
De fait, nous n’avons pas eu en France de réflexion globale sur la santé publique depuis le choc pétrolier de 1973, lorsque la gestion de crise a prévalu sur le reste [2].
Aujourd’hui, 20 à 25% de la population vit dans la précarité (soit 12 à 15 millions de personnes), ce qui constitue selon le Haut Comité de la santé publique « un problème social, économique, politique et de santé publique, majeur ». Globalement, plus d’un Français sur quatre n’arrive pas à se soigner correctement faute de moyens.
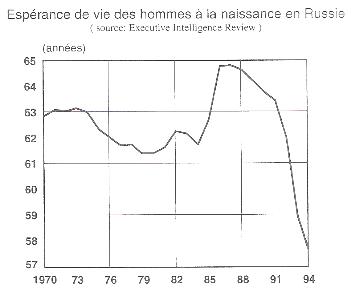
Les intérêts financiers occidentaux qui ont pillé la Russie, provoquant l’effondrement des conditions de vie et la chute de l’espérance de vie, sont aussi intéressés à la privatisation de notre système de santé. La longévité n’est jamais un fait acquis.
Il faut se battre pour arrêter la dérive. Nous ne pouvons plus tolérer que l’on brade les biens nationaux - système de santé et de retraite - à des intérêts financiers qui s’intéressent au malade uniquement s’il est rentable. La crise systémique qui menace actuellement l’ensemble du système monétaire offre aux États une occasion rêvée pour reprendre les rênes de l’économie d’entre les mains des financiers peu scrupuleux qui la contrôlent aujourd’hui.
Au cours d’une nouvelle conférence de Bretton Woods, les principaux États du monde pourraient rétablir les politiques de contrôle de crédit et de change nécessaires à la stabilité du système et à l’élimination de toute marge de manœuvre pour les spéculateurs.
Surtout, en réorientant l’argent vers les investissements productifs à grande échelle grâce à des mécanismes du type plan Marshall, les chefs d’Etats des principaux pays du monde pourraient rapidement organiser une relance en profondeur des capacités productives de l’économie mondiale. C’est l’arrière-plan nécessaire pour rétablir et financer une politique de santé digne de ce nom.
Nous devons nous inspirer des politiques qui ont été à l’origine des Trente Glorieuses et aller plus loin. La plupart des percées technologiques et économiques grâce auxquelles nous vivons bien mieux en moyenne aujourd’hui ont été initiées à cette époque, avant la dérive monétaire entamée lors des années 70.
L’intérêt porté au vieillissement remonte également à ces années. Il faut repartir de là en se posant à nouveau la question essentielle : qu’est-ce que la vie, en économie, en science, en médecine ?
Le choix fondamental s’offre immédiatement à nous : régression de l’espérance de vie sur fond de krach systémique ou « révolution du grand âge » dans le contexte d’un nouvel ordre économique mondial juste. Ce dossier a été écrit pour servir tous ceux qui combattent pour la vie, combat sans lequel il ne peut y avoir d’espérance collective.
Quoi que dise la presse sur le déficit de la Sécurité sociale ou sur l’hôpital public (voir en particulier le magazine Science & Avenir de septembre 1998 établissant le hit parade des « hôpitaux où l’on meurt le plus »), la santé publique et la protection sociale de notre pays restent encore parmi les meilleures au monde.
Cependant, un vrai danger menace notre système de protection sociale : c’est de vouloir en faire une activité « rentable » au sens financier, dans une perspective de court terme. Ce à quoi appelle Denis Kessler, porte-parole des compagnies d’assurance et étoile montante du Medef. Sous couvert de « refondation sociale », il affirme dans la revue Commentaire :
Il faut inventer d’autres institutions de droit privé, comme les fonds de pension ou les réseaux de soins, et créer une assurance maladie qui deviendrait une fonction d’entreprise.
En ne considérant que les coûts et les gains immédiats, rapportés au Produit intérieur brut, Denis Kessler exclut les bénéfices à long terme de l’investissement social, comme la contribution d’une population vivant mieux et plus longtemps, au bien-être commun.
Non au triage et à la privatisation de notre système social
I. Santé, retraite : on cherche à nous faire peur
1. Le chômage à l’origine du déficit de la Sécurité sociale
Le déficit chronique des comptes de la Sécurité sociale serait dû, à en croire les uns et les autres, à ce que nous dépensons trop. C’est faux. Si aujourd’hui il n’y avait pas de chômage en France, il n’y aurait pas de trou de la Sécurité sociale.
Mais, partant du principe qu’on ne sait pas réduire durablement et d’une façon importante le chômage qui est à l’origine des déficits, les élites en place s’orientent vers des mesures de restriction budgétaire.
Les propos de Jean de Kervasdoué, ancien patron de la direction des hôpitaux du ministère de la Santé au moment de la mise en place du plan Juppé, reflètent cet état d’esprit hélas largement partagé :
Il eût été préférable, en effet, que le chômage diminue de manière significative et que les salaires augmentent, ce qui aurait eu pour effet d’accroître les recettes de la Sécurité sociale. Mais cette occurrence était peu probable et elle ne s’est pas réalisée ...
Calculette en main, on considère que « toutes choses égales par ailleurs », les dépenses de santé ne peuvent continuer à augmenter comme par le passé, elles doivent même être réduites. Il faudrait selon Raymond Soubie, rédacteur du rapport commandé par Edouard Balladur, devenu la bible de la réforme du système de santé, couper encore bien plus.
Les premiers visés sont les personnes âgées de plus de 70 ans, responsables du quart de la consommation médicale. Cependant, il faut bien souligner que ce chiffre est relativement stable ; le vieillissement de la population justifie moins de 10% de la croissance des dépenses médicales constatées au cours des vingt dernières années. Cela signifie que toute « économie » entraîne bel et bien une réduction des prestations à l’encontre des plus âgés, et non un simple coup de frein à la croissance des dépenses.
Ce « sacrifice » serait non seulement moralement inacceptable mais de surcroît économiquement absurde car, en cas de plein emploi, l’argent pour combler le trou de la Sécu serait collecté en six mois.
Si en effet les trois millions de chômeurs enregistrés officiellement avaient aujourd’hui un emploi, représentant un revenu mensuel moyen de 9000 francs par personne, les recettes de la protection sociale augmenteraient d’environ 178 milliards de francs par an [3].
En même temps, les dépenses liées au chômage et au sous-emploi (194 milliards de francs en 1995), baisseraient considérablement. Supposons que l’on économise 150 milliards sur ces dépenses, ajoutés aux 178 milliards de recettes, nous voilà chaque année avec 328 milliards de francs supplémentaires.
La dette cumulée des comptes sociaux étant estimée entre 150 milliards et 200 milliards de francs suivant les calculs, le « trou » qui terrifie tant serait résorbé en moins de six mois ...
De plus, même si en valeur absolue elle représente des sommes conséquentes, la dette sociale doit être relativisée : elle représente moins de 4% des dépenses totales de protection sociale.
Raymond Soubie, comme le font de multiples rapports officiels, fait porter la responsabilité de cette situation sur les professionnels de la santé. Jean-Claude Mallet, président de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (qui gère près de 80% des dépenses de santé en France), lui répondait en substance en 1995 :
Le financement étant assis sur des cotisations prélevées sur les salaires, plus le nombre de chômeurs augmente, plus les recettes diminuent. 100 000 chômeurs en plus, c’est 8 milliards de recettes en moins [4].
Il y a eu 520 000 chômeurs en plus ces deux dernières années, ce qui représente 40 milliards de cotisations en moins (dont un bon tiers manque à l’assurance maladie).
Les déficits se creusent avec la crise économique
Apparu à partir de 1975, le « trou » proprement dit coïncide en fait avec les débuts du processus de décroissance physique de l’économie. L’augmentation des dépenses de santé dans le sillage des Trente Glorieuses n’a pas été accompagnée d’une augmentation suffisante de la production physique.
Jusqu’en 1978, le système est globalement équilibré (toutes branches confondues : maladie, vieillesse et famille). Cependant, les branches maladie et vieillesse connaissent un déficit depuis 1968, compensé jusqu’en 1978 par les excédents de la branche famille. Le rythme de croissance des rentrées devient inférieur au rythme de croissance des dépenses de santé (lui-même lié au rythme général de l’amélioration des droits à prestations).
La première inflexion dans la croissance constatée dès la fin des armées 60 se traduit par le déficit des branches maladie et vieillesse. La profonde crise qui s’installe à partir du premier choc pétrolier annonce un déficit structurel de l’ensemble de la protection sociale.
Voyons le détail de la détérioration des comptes sociaux. Entre 1970 et 1993, les prestations chômage - même si elles ne représentent que 8,5% de l’ensemble des dépenses de protection sociale - ont été multipliées par 14,6, malgré toutes les mesures prises pour les réduire.
Pendant le même temps, les prestations santé et familiales ont doublé et les prestations vieillesse ont triplé. Les rentrées, elles, ralentissaient avec le gel des salaires, la non cotisation correspondant aux emplois supprimés et les exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises sans contrepartie financière.
Le coup d’Etat de l’oligarchie financière internationale sur l’économie mondiale, cause plus profonde des déficits
En augmentant toujours plus les cotisations et diminuant toujours plus les paiements, les gouvernements successifs ont agi sur le symptôme, le déficit des régimes sociaux, plutôt que sur la maladie, à savoir le pillage exercé par les flibustiers des marchés financiers au cours des deux dernières décennies de déréglementation.
Les intérêts financiers basés à la City de Londres et à Wall Street ont créé une immense pyramide financière dont ils occupent le sommet.
C’est de là que sont venus les coups violents assénés à l’économie mondiale : en 1971, avec le découplage décidé par Nixon entre le dollar et l’étalon-or, suite à la multiplication anarchique des eurodollars sur le marché déréglementé de la City de Londres ; en 1973, avec l’orchestration du choc pétrolier (les prix du pétrole ont été multipliés par six), créant les conditions d’une expansion de la bulle financière des eurodollars ; et en 1979, avec l’augmentation des taux d’intérêt imposée par le président de la Réserve fédérale américaine, Paul Volcker, qui donna priorité à la rente sur l’investissement industriel.
Affaiblis, les Etats cèdent toujours plus.
De Kennedy à de Gaulle, de Gandhi à Nkrumah, la plupart des dirigeants pouvant faire obstacle à la montée en puissance des marchés financiers privés et à la déréglementation sont écartés, voire éliminés. Les personnalités qui leur succèdent ne sont pas à la hauteur. Peu à peu, puis à un rythme toujours accéléré, les économies nationales abandonnent la création de richesses physiques au profit d’activités non productives, spéculatives.
Le chômage de masse s’installe dans les années 70, avec une baisse constante du niveau de vie moyen. L’état collecte moins d’impôts alors que ses obligations liées au chômage et à la pauvreté s’alourdissent, le déficit budgétaire s’installe définitivement et, avec lui, le "trou" de la Sécu.
Le contribuable paie, le gouvernement rationne
Le système de retraite et le système de Sécurité sociale étaient à l’ origine des systèmes paritaires (patronat et salariés) qui se finançaient exclusivement avec les cotisations des assurés, sans aide financière de l’État. Par contre, les pouvoirs publics avaient établi les règles, basées sur la solidarité inter-générations (les actifs paient pour les inactifs), la solidarité entre les plus riches et les moins riches et la solidarité entre les régions. Nous avions affaire à un régime global, couvrant de la même façon tout Français cotisant.
En 1990, le régime de la Sécurité sociale ne peut donc plus subvenir à lui-même. Pour la première fois et en dérogation au principe de base du système social, il a été demandé au contribuable de combler le trou avec la création de la Contribution sociale généralisée (CSG) et du prélèvement temporaire de 0,5% baptisé Remboursement de la dette sociale (RDS). Le financement public de la protection sociale à travers la CSG et le RDS a ainsi atteint 20,4%.
Du coup, dans la mesure où l’État intervenait par financement budgétaire, il a décidé de prendre lui-même en main le dossier santé avec les ordonnances Juppé de 1995, court-circuitant les acteurs du système paritaire.
La fuite en avant des coupes budgétaires
Il n’y a pas eu moins de quatorze plans [5] en vingt années pour redresser les comptes sociaux, chaque plan étant supposé être le dernier dans l’attente d’une reprise qui n’est jamais venue.
On n’a pas cessé de diminuer les remboursements et d’augmenter les cotisations, ce qui a renvoyé de plus en plus les Français vers des mutuelles complémentaires, d’où une protection sociale à deux vitesses. Les principes de base de notre système social (solidarité nationale, non sélection des risques, égalité d’accès aux soins) sont ainsi battus en brèche. Les assurances complémentaires privées, du type Axa, qui font actuellement pression pour éliminer les mutuelles, suivent en effet la démarche inverse : aucune solidarité, sélection des risques, accès aux soins suivant les moyens.
A intervalles réguliers, on a augmenté le ticket modérateur, le forfait hospitalier, les cotisations maladie et la toute nouvelle CSG. Les dépenses ont, quant à elles, été revues à la baisse par une succession de déremboursements et de blocages budgétaires (encadré 1).
Encadré 1 :
Un credo inchangé depuis plus de 25 ans
Limiter les dépenses …
- 1977 : remboursement à 40% (au lieu de 70%) des médicaments de « confort »
- 1979 : blocage du budget des hôpitaux
- 1982 : extension du forfait hospitalier, instauration du budget global des hôpitaux
- 1986 : déremboursement de la plupart des vitamines, le remboursement à 100% est limité à la seule maladie exonérant
- 1988 : déremboursement des antiasthéniques
- 1993 : baisse de 5% du taux de remboursement des médicaments, normalisation des prescriptions (références médicales opposables)
- 94 à 99 : plusieurs vagues de déremboursement
… et augmenter les cotisations.
- 1976 : instauration de la vignette auto dont la recette est affectée à la couverture sociale
- 1978 : hausse des cotisations vieillesse et maladie, mise en place d’une cotisation maladie pour les retraités, création du forfait hospitalier
- 1979 : majoration de la cotisation maladie
- 1981 : cotisation de 1 % pour les chômeurs touchant plus du SMIC
- 1983 : prélèvement exceptionnel de 1 % sur les revenus imposables, relèvement de la cotisation vieillesse
- 1985 : hausse du ticket modérateur
- 1986 : prélèvement exceptionnel de 0,4% sur deux ans
- 1987 : hausse des cotisations maladie et vieillesse
- 1990 : instauration de la Contribution sociale généralisée (CSG)
- 1991 : hausse de la cotisation maladie et du forfait hospitalier
- 1993 : hausse du forfait hospitalier et de la CSG
- 1998 : élargissement des prélèvements sur le patrimoine
Globalement, les taux de cotisations sociales sont du coup passés de 47,7% à 56% du salaire au niveau du plafond. Cette hausse a pesé pour l’essentiel sur les cotisations salariés (de 12% à 18,9%) alors que les cotisations employeurs passaient de 35,7% à 37,1%.
Au total, le malade français est celui qui paie de sa poche la plus grande partie des frais médicaux (18% contre 6 à 8% en Allemagne par exemple). La part des dépenses non remboursées par la Sécurité sociale était de 26,1% en 1995, selon la revue Alternatives économiques.
Le résultat pour la santé nationale est inscrit dans une enquête du CREDES de 1998, selon laquelle un Français sur quatre n’arrive pas à se soigner faute de moyens, même s’il est assuré social, ce qui est de toute façon le cas avec l’instauration de la Couverture maladie universelle (CMU) [6].
Les personnes âgées sont les plus vulnérables. Si, disposant de maigres ressources, elles vivent isolées, elles se retrouvent souvent victimes d’une sorte de triage qui ne dit pas son nom. Le débat sur l’euthanasie qui a repris de plus belle depuis quelques mois dans notre pays vise en priorité ces victimes désignées. « L’accompagnement de fin de vie » [7], pour reprendre l’expression de Bernard Kouchner, est pour certains l’occasion d’accélérer le départ des plus âgés, parce qu’ « ils coûtent trop cher ».
On l’a vu, les médecins ne sont pas épargnés non plus, accusés de sur-prescrire (Encadré 2). Dernier présumé coupable, on y reviendra, le progrès technologique est parfois accusé à tort de creuser les déficits sous forme d’équipements jugés coûteux et d’examens plus complexes.
Encadré 2 :
Le rationnement du nombre de médecins
Plus les médecins sont nombreux, plus le volume des prescriptions est important, selon l’assurance maladie. Dans cette logique, le médecin ne guérit pas, il « coûte » ; 1,8 millions de francs par an, dont 1,5 en prescriptions. Les caisses sont prêtes à investir la même somme cumulée sur plusieurs années pour pousser vers la retraite anticipée plusieurs milliers de médecins libéraux. Un projet de décret pourrait convaincre 2 000 médecins par an de rendre leur ordonnancier. On raisonne comme si l’offre de soins créait la maladie.
Ce que cherchent les pouvoirs publics, c’est à limiter le nombre de médecins voués à partager un budget administrativement limité.
Or une étude du ministère de la Santé conclut que même dans l’hypothèse où la population ne consommerait pas plus qu’actuellement, l’offre serait insuffisante à partir de 2007, avant d’ajouter que l’allongement de la durée de vie entraîne inexorablement une augmentation de la demande de soins.
De fait, la densité médicale française n’a rien d’excessif par rapport aux voisins (elle reste légèrement inférieure à la moyenne des pays européens) et surtout si l’on prend en compte les nouveaux besoins liés à l’allongement de la durée de vie.
(Sources : magazine Viva et mensuel Alternative économique)
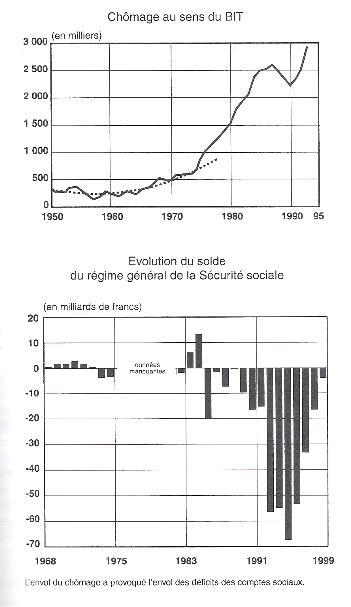
2. Le lourd impact du chômage sur les retraites
La « révolution grise » accusée d’être responsable de la surconsommation médicale mettrait également en danger le système de retraite [8] (Encadré 3). Une fois de plus, c’est faux. Jusqu’à présent, le vieillissement n’a été qu’un facteur annexe dans l’évolution des dépenses de retraite.
Le doublement des dépenses de retraite au cours des années 70 est avant tout dû à ce que les pensions ont été augmentées. Qui s’en plaindra ? Souvenons-nous du temps où les retraités étaient pour ainsi dire une catégorie de pauvres. Un rattrapage s’imposait et il a eu lieu. Sans la chute du rythme des recettes provoquée par le chômage, le régime vieillesse aurait « tenu le coup » jusqu’à ce jour.
C’est donc encore et toujours le chômage, en particulier celui déguisé en préretraite, qu’il faut éliminer.
Le chômage pèse doublement sur les retraites : chaque chômeur représente un cotisant de moins et un coût supplémentaire pour le travailleur en activité. Or, si depuis 1970 le nombre de personnes en âge de travailler a augmenté de 4 millions (+ 18,7%), la population au travail, n’a augmenté, elle, que de 1,4 million (+6,7%).
Le problème - si problème il y a - de l’accroissement des dépenses liées au vieillissement de la population tient surtout au fait que la durée de vie s’allonge tandis que la durée d’activité professionnelle diminue.
Avec le développement de la préretraite comme moyen de baisser les chiffres du chômage, tout est fait pour pousser les travailleurs à faire valoir leurs droits à la retraite de plus en plus tôt. En 1971, les deux tiers des hommes de 60 à 64 ans étaient au travail ; au début des années 80, ils étaient seulement 40%, ils ne sont plus que 10% aujourd’hui. Quant aux 55-59 ans, la proportion est tombée à 60%.
Le raisonnement « mieux vaut un retraité qu’un chômeur » traduit cette réalité. Après avoir encouragé le départ en préretraite dans les entreprises publiques depuis les années 70, en créant ou en finançant des préretraites sous différentes formes, les pouvoirs publics encouragent maintenant de nouvelles catégories professionnelles à avancer leur départ : camionneurs, médecins, chercheurs.
Le modèle actuel de concentration de l’activité sur une période de plus en plus brève - entre quinze et soixante-cinq ans, puis entre vingt et soixante, bientôt entre vingt-cinq et cinquante-cinq - ne peut donc continuer bien longtemps.
En attendant, comme dans le cas de la santé, le déficit de la branche vieillesse n’a amené que des mesures restrictives ; les économies dans ce secteur ont consisté à freiner la croissance du montant des retraites depuis 1991 (gouvernement Rocard). La revalorisation des pensions ne peut plus désormais dépasser l’évolution des prix ; on prend en compte les 25 meilleures années de carrière contre 10 auparavant (ce qui permet d’économiser environ 15%). On a également allongé la durée des cotisations (depuis 1994, on demande aux salariés du secteur privé de travailler quarante ans, contre trente-sept ans et demi pour la fonction publique).
Encadré 3 :
Des scénarios pour faire peur
Retraites, suivi médical des plus âgés : les défis immédiats liés au vieillissement de la population sont généralement l’occasion de manchettes catastrophistes, d’où il ressort que l’on n’a pas assez d’argent pour payer et soigner les futurs retraités.
En prenant le pire des scénarios envisagés, l’augmentation des dépenses liées au vieillissement ne dépasserait pas 0,5 point par an au début du XXIe siècle, pour s’atténuer ensuite.
Ce type de prévisions n’est de toute façon qu’une extrapolation linéaire des données actuelles. Il ne tient pas compte de l’essentiel : les progrès dans la prévention et les soins vont faire baisser le coût des traitements liés à l’âge alors que l’allongement de la durée de vie s’accompagne d’un rajeunissement biologique, que l’on évalue à cinq ans sur la dernière décennie (une personne aujourd’hui âgée de 70 ans n’est pas biologiquement plus vieille qu’une personne de 65 ans il y a dix ans).
Pour ce qui concerne les retraites, le manque à gagner cumulé des régimes de retraite venant de la non cotisation des 8 millions de personnes actuellement au chômage, en préretraite ou sous-employées est la vraie raison des déficits qu’on entrevoit. Les scénarios catastrophes (*) sont surtout un moyen de justifier les réformes qui remettent en cause les principes de base de notre système social (retraite par répartition, accès de tous aux meilleurs soins, quel que soit l’âge).
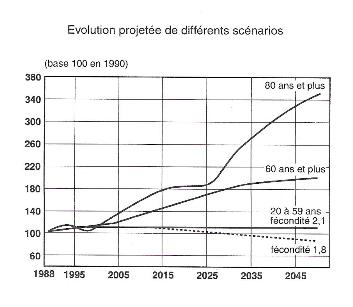
Note :
(*) En l’an 2045, dit-on, il n’y aura qu’un actif par retraité alors qu’aujourd’hui il y a 2,7 actifs pour chaque retraité. La charge par actif dans le cadre du système actuel de répartition (où les actifs paient pour les inactifs) serait ainsi multipliée - toutes choses égales par ailleurs - par 2,7. Ceux qui ont 30 ans aujourd’hui n’auront donc pratiquement pas de retraite, affirme-t-on.
II. Les intérêts privés à l’assaut de la protection sociale
1. La fuite en avant de la privatisation
La bulle de la spéculation financière a besoin de toujours plus d’argent frais pour continuer d’exister. Le secteur de la santé est un morceau de choix. Ce sont des dizaines de millions de clients potentiels sur un marché en pleine expansion. A condition de pouvoir choisir les maladies qui rapportent et de réduire les dépenses qui grèvent le bénéfice.
Il n’est pas question pour nous de remettre en cause l’existence d’un secteur privé, même hospitalier, mais plutôt d’arrêter la dérive générale - dans le public aussi la concurrence entre hôpitaux fait des dégâts - qui consiste à privilégier les activités « rentables » au sens du court terme financier (Encadré 4).
Nous nous opposons donc absolument à la rétrocession d’une partie des activités hospitalières, qu’elles soient publiques ou privées, aux grands groupes financiers (ou industriels à logique financière) comme Vivendi-Générale des eaux ou Suez-Lyonnaise des eaux.
Ces groupes sont intéressés aux actes « qui paient » : chirurgie vasculaire, viscérale, urologie, explorations diverses, traitement des cancers, c’est-à-dire les actes techniques, ceux que l’on facture à la Sécurité sociale, qui sont pris en charge à 100% et qui rapportent. Les autres continuent à relever de l’hôpital public, qui court le risque de devenir une sorte de voiture balai. Le privé réalise ainsi 47% des journées de chirurgie, mais 14% seulement des journées de médecine.
Les actes médicaux doivent être « rentables », mais encore faut-il que les clients paient, d’où un second tri : les secteurs médicaux ou géographiques moins intéressants ne sont pas pris d’assaut.
A la question : « Irez-vous implanter une maternité à La Mûre », Evelyne Bondet (Pdg de la SA Monticelli, clinique d’ophtalmologie de la Générale de Santé à Marseille) a répondu dans une conférence de presse donnée le 6 septembre 1996 :
Je ne crois pas que le privé puisse y aller. La tarification à l’acte demande une certaine rentabilité, pour une maternité comme La Mûre, il faut avoir un budget répondant à une mission de service public. Dans la région de Bordeaux, nous avons ainsi dû nous débarrasser d’une maternité nécessaire à la population mais non rentable.
Encadré 4 :
La mise en coupe réglée
des secteurs rentables de l’économie
Les grands groupes financiers qui se sont notamment formés outre-Atlantique et outre-Mache ont établi depuis une dizaine d’années une stratégie de conquête sur le territoire européen. Secteur par secteur, ils pillent les entreprises. Le secteur de la santé est une cible de choix.
La démarche est à peu près toujours la même : les entreprises ou les activités qui vont pouvoir assurer la rentabilité désirée par les actionnaires sont ciblées, avec une stratégie adaptée à chaque cas. Dans le secteur de l’informatique d’entreprise par exemple, le marché a été récupéré par le groupe anglais Sage qui a racheté Saari et Sybel, deux sociétés françaises qui étaient devenues la référence en matière de logistique de gestion. Toute PME française qui veut s’informatiser n’a pas vraiment d’autre choix actuellement en dehors du groupe Sage. Dans des secteurs industriels très ciblés comme ceux de la chimie, les grands groupes anglo-saxons visent les entreprises qui les intéressent, se livrent à une guerre des prix le temps qu’il faut pour mettre à genoux les entreprises du secteur, les rachètent et gardent les activités qui rentrent dans les objectifs de rentabilité.
Les méthodes employées dans les entreprises qui ont été rachetées sont dignes des feuilletons américains. Le repreneur laisse généralement la situation pourrir en faisant courir le bruit de licenciements massifs mais sans donner de véritables directions à l’entreprise. Les personnels se démotivent et en prévision d’une licenciement éventuel cherchent ailleurs et démissionnent, autant de gagné sur les indemnités de licenciement. Les dirigeants de l’ancienne équipe sont souvent assez brutalement débarqués, de préférence pour faute, toujours afin d’éviter les frais de licenciement. Quant à ceux qui restent une fois la période de réorganisation passée, ils se voient fixer des objectifs de rentabilité financière draconiens, dont leur poste dépend. Si en dix-huit mois vous n’avez pas fait vos preuves, c’est la porte.
Le Pr Emile Papiernik, chef du service de gynécologie obstétrique du groupe Cochin Port Royal résume bien l’opinion de nombre de ses collègues du public lorsqu’il s’insurge :
La contrainte du budget global pour l’hôpital public et une beaucoup plus grande liberté pour le privé ont créé un grave déséquilibre entre les deux. On laisse au public les tâches les plus lourdes, tandis que s’organise le transfert vers le privé de tous les actes opératoires bien cotés par l’assurance maladie (…) On est en train de tuer tranquillement l’hôpital public. Et on ouvre grand la porte à ceux qui savent mieux gagner de l’argent.
La différence de rémunération et des conditions de travail de plus en plus difficiles, compte tenu du manque de moyens ainsi que la réduction de postes d’agrégés (à la fois professeurs et praticiens) conduisent nombre de médecins vers le privé (70% des chirurgiens y travaillent déjà) : « Comment voulez-vous qu’un chirurgien gagnant 20 000 francs à l’hôpital et 80 000 ou 100 000 francs dans le privé ne préfère pas ce dernier secteur » , interroge l’un d’entre eux. « Depuis vingt ans, nous nous battons pour une harmonisation des rémunérations et nous ne l’avons jamais obtenue. »
Nombre de praticiens ont opté pour le secteur des honoraires libres : le malade doit payer de sa poche une somme plus ou moins importante. Tant qu’il existera un équilibre entre le public et le privé, ce dernier n’aura pas intérêt à trop abuser des dépassements et le libre choix demeurera. En revanche, si le déséquilibre déjà amorcé s’accentue, si le privé détient le monopole de secteurs médicaux ou géographiques, la tentation sera grande pour certains de profiter de cette situation.
Depuis une quinzaine d’années, le secteur privé s’est entièrement recomposé. Déjà en difficulté lorsqu’elles veulent investir dans des plateaux techniques adaptés, les petites cliniques traditionnelles, gérées par des praticiens dont elles étaient l’outil de travail, sont confrontées à la concurrence, notamment à celle des chaînes de cliniques soutenues par de grands groupes financiers. La plus importante d’entre elles, la Générale de santé, contrôlée par la Générale des eaux, regroupe 175 établissements répartis en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Tunisie et au Canada, et réalise un CA de près de 6 milliards de francs. En France, la Générale de santé-clinique réunit soixante-dix-huit établissements, soit près de 7 000 lits, dont 57% en médecine-chirurgie-obstétrique (Mco) soit 5 265 lits (chiffres d’affaires : 3 milliards de francs).
Autre pôle privé, Clinivest, dont le groupe Suez détient plus de 80%, possède vingt-deux établissements répartis en France et totalise 2 300 lits de court séjour, dont les deux tiers en chirurgie.
2. La santé publique et les retraites livrées aux assureurs privés ?
Le plan « Juppé-Aubry »
Le plan « Juppé-Aubry » vise plus à « faire des économies » qu’à améliorer le système de santé, sans même parler de santé publique. On pense faire des économies par l’imposition d’une gestion statistique, comptable et commerciale de la santé et de l’hôpital.
Les deux principaux instruments de la « maîtrise des dépenses » sont les Références médicales opposables (RMO) et les Programmes de médicalisation des systèmes d’information (PMSI).
Les RMO visent les médecins de ville. Des panels de médecins et de spécialistes établissent par type d’affection une marche standard à suivre censée intégrer toutes les connaissances de l’art sur chaque maladie. Si le praticien ne respecte pas le code de bonne conduite, il peut être sanctionné financièrement. Ce système a d’abord été mis en œuvre par les assureurs américains, afin de ne rembourser que ce qui est considéré comme médicalement nécessaire. Les « références médicales » édictées sont opposables aux avis des médecins. On trouvera toujours des médecins peu scrupuleux ou incompétents, qui prescrivent à tort et à travers. Si le médecin est incompétent, il faut y remédier par une meilleure formation et un suivi des compétences. S’il est malhonnête, il faut le poursuivre devant le Conseil de l’ordre, voire en justice. Dans les deux cas, les RMO ne résolvent pas le problème.
Les PMSI visent les hôpitaux. L’opération consiste à classer les malades en groupes homogènes et à calculer hôpital par hôpital le coût de chaque type d’intervention. Partant d’une situation où les hôpitaux publics n’évaluaient pas vraiment leur coût de revient, on a mis en place un contrôle par des indicateurs d’activité : nombre d’entrées, taux d’occupation des lits, durée moyenne d’un séjour hospitalier, coût par séjour et par acte, nombre de décès, etc. C’est à partir des résultats de la PMSI que la presse s’est autorisée à faire des hit-parades des hôpitaux « où l’on meurt le plus ».
Parallèlement, ces résultats sont utilisés pour pénaliser les centres hospitaliers dont les coûts sont plus élevés que « la moyenne ». Une approche statistique de ce type ne prend pas en compte les spécificités régionales ou locales qui peuvent parfaitement expliquer les différences enregistrées entre les établissements, sans pour autant que cela remette en cause la qualité des soins et la gestion. Là aussi, l’instrument peut être utile, mais son utilisation est déviée par l’obsession des économies.
Les réseaux de santé
Le projet de loi de la Sécurité sociale pour 1999 inscrit la possibilité pour les professionnels de la santé de s’organiser en réseaux. Le réseau de santé est une « organisation horizontale » de la prise en charge du patient par un groupe de professionnels de la santé et du secteur social. Un réseau est généralement conçu dans une aire géographique déterminée afin de coordonner le suivi des malades ou des populations spécifiques.
Les filières
La filière est une « organisation verticale » de la prise en charge du patient, à partir du médecin généraliste (référent) ; sous la supervision de ce dernier, les malades sont orientés vers d’autres étapes et d’autres praticiens (médecins, hôpitaux, spécialistes …). La formule du « médecin référent » entrée en vigueur le 1 er janvier 1998 constitue une ébauche de filière de soins en incitant les patients, sans les y obliger, à s’abonner chez un généraliste qui, en échange de 150 francs par malade, doit jouer ce rôle de superviseur.
Si le concept de « filière » devait être adopté, le patient pourrait perdre le bénéfice du tiers payant et même voir baisser le remboursement de la Sécurité sociale par rapport au taux actuel (70% pour les actes médicaux) s’il voit un autre généraliste « sans motif valable ». Comme le précise Gérard Arcéga, directeur de la caisse primaire du Vaucluse, « en supprimant la liberté de consultation, on réalise au moins 15 % d’économies ».
Les réseaux et filières visent à favoriser la coopération entre les différents acteurs, tels ceux de l’assurance privée, des mutuelles du patronat, des médecins, des services hospitaliers, de la Sécurité sociale et du gouvernement. Le but en soi est tout à fait légitime.
Cependant, confiée à des assureurs privés (avec une mise en concurrence des caisses de maladie), la gestion de réseaux amène ces derniers à vouloir utiliser leurs « futurs adhérents » et leur propre réseau médical et hospitalier pour réaliser des bénéfices. Le secteur de la santé est appelé à intégrer le vocabulaire de l’assurance, qui raisonne en « sinistres », en « marchés porteurs », évacuant les notions de « patient » et de « maladie ». Une tendance également favorisée par la Commission de Bruxelles (Encadré 5).
Encadré 5 :
Bruxelles au service des intérêts financiers
La Commission de Bruxelles, dans ses directives aux gouvernements en matière de politique sociale, reprend à son compte le point de vue des milieux financiers de l’assurance. Nous comparons ici quelques extraits d’une Communication sur le sujet publiée par la Commission le 12 mars 1997, avec le point de vue des fondateurs de notre système de Sécurité sociale :
Ce que défendaient les fondateurs de notre système social :
Sécurité collective nationale et familiale plutôt qu’une assurance individuelle.
Ce que propose la Commission :
« Une individualisation des droits viserait à mettre un terme à la pratique qui consiste à tenir compte de liens familiaux pour assurer la protection sociale d’un individu. »
Ce que défendaient les fondateurs de notre système social :
Système de solidarité et de répartition (c’est la société qui décide quelle est la part de la richesse produite qui doit aller aux personnes âgées).
Ce que propose la Commission :
« Encourager le développement de régimes complémentaires de retraite financés par capitalisation » (c’est d’une part favoriser les salariés ayant les moyens d’adhérer aux fonds de pension, d’autre part soumettre les pensions aux aléas boursiers).
Ce que défendaient les fondateurs de notre système social :
Abandon une fois pour toute de la logique de l’assurance privée au profit d’une assurance publique universelle.
Ce que propose la Commission :
« Chaque assureur devrait pouvoir conclure un contrat avec les prestataires de service qui offrent les meilleurs services à un prix abordable ».
Santé : le projet AXA
Les assurances Axa (encadré 6) et leur patron, Claude Bébéar, se veulent les plus en pointe dans les projets de privatisation de la santé. Claude Bébéar se présente comme le chevalier blanc de la couverture sociale, celui qui veut sauver l’assurance maladie. Son idée est donc de garder la Sécu, mais « d’améliorer son fonctionnement » par la « mise en concurrence » des prestataires de santé. Au lieu de rembourser tel ou tel médecin choisi par le patient sans contrôle aucun, la Sécu confie son budget de remboursement à Axa pour une région donnée, l’Île-de-France par exemple.
On n’hésite pas à préciser :
Pour maîtriser les coûts, on va "contrôler" les dépenses, surtout celles concernant les médicaments, les examens complémentaires et les hospitalisations. C’est là-dessus que l’on va pouvoir jouer.
Le contrôle des dépenses se fait au niveau du réseau de soins. Le médecin qui y adhère s’engage sur « les bonnes pratiques médicales », la prescription de médicaments génériques (moins chers) et, pour le médecin et le malade, l’acceptation de se prêter à des évaluations afin de mesurer la bonne coordination des soins. La règle est de chercher avant tout à freiner le recours à l’hôpital, jugé très coûteux. Les assureurs pénalisent l’assuré s’il consulte en dehors du réseau.
Une enveloppe financière annuelle (qui représente le « coût actuariel », c’est-à-dire le coût estimé sur une vie entière, ramené à l’année) est versée au groupe Axa par la Sécurité sociale pour chaque assuré. Les assurés Axa continuent à verser leurs cotisations à l’assurance maladie. Mais la Sécurité sociale la reverse immédiatement à Axa qui gère le risque maladie à sa place. L’assureur fait son affaire des bénéfices ou des pertes. Axa se propose de reverser une partie de l’argent économisé à la caisse d’assurance maladie, sans autre précision.
Il est probable que contrairement à ce que dit Axa, le coût final à traitement égal sera plus élevé. En effet, un système public et obligatoire comme l’assurance-maladie n’a pas de frais commerciaux.
Le coût de la gestion de l’assurance-maladie en France est de 5,6% (2% au Canada). La gestion du risque par un assureur privé représente en moyenne 12% et peut aller jusqu’à 20%.
Pour l’heure, une trentaine de projets sont à l’étude et soumis au gouvernement auprès de la commission présidée par Raymond Soubie. Après le projet Axa, c’est celui de Groupama qui est le plus avancé. Le réseau de soins Groupama serait nommé « Partenaire santé » et adapté aux généralistes, leur proposant de réduire leurs prescriptions de 15 à 25 % contre une revalorisation d’honoraire (un forfait de 5 000 francs et une somme annuelle de 80 francs par patient suivi).
Encadré 6 :
Le groupe AXA-UAP
En novembre 1996, Axa a absorbé l’UAP, privatisée en 1994 par Edouard Balladur. La marque UAP a disparu définitivement en avril 1998. Au niveau mondial, Axa-UAP (devenu Axa SA) a réalisé en 1997 un chiffre d’affaires de près de 364,6 milliards de francs (plus du cinquième du budget de l’Etat français en 1998), venant au deuxième rang mondial derrière le groupe Nippon Life. Axa SA garde une place de leader en gérant 3020 milliards de francs d’actifs. Allianz, le numéro un des assurances allemandes, talonne Axa en France grâce à une offre publique d’achat (OPA) réussie sur les AGE.
Une seule obsession existe pour les assureurs : atteindre la taille critique. Pierre Nanterme, associé du cabinet Andersen Consulting, rappelle que la concurrence est vive dans le milieu car « elle se traduit par une pression sur les prix qui tire les marges vers le bas. Le passage à l’Euro va renforcer cette concurrence au niveau européen en rendant les tarifs plus transparents et les comparaisons plus faciles pour le futur assuré. »
En présentant à la presse les résultats de son groupe pour 1997, Claude Bébéar annonçait :
A terme, entre dix et quinze groupes domineront le marché mondial. Axa veut y être. C’est le cas aujourd’hui ; notre problème c’est d’y rester.
La compétition est européenne et mondiale, elle se joue sur les parts de marché et la réduction des coûts, ce qui n’est pas sans conséquences sur l’emploi. Depuis 1990, les effectifs de la filiale française d’Allianz ont été réduits d’un tiers (2079 personnes en 1997), et une nouvelle réduction était programmée pour 1998.
Les « soins gérés » aux États-Unis
La récente vague de déréglementation aux États-Unis a abouti dans le domaine de la santé à ce qu’on appelle les « soins gérés » ( managed care ). Le gouvernement a encouragé le recours à des structures de maintien en santé ( Health Maintenance Organization, ou HMO , l’équivalent des réseaux français), tenues par des entreprises privées et des assureurs, auxquelles une loi de 1974 (loi ERlSA) assure une immunité absolue contre toute poursuite de leurs « clients ».
Ces organismes limitent les soins au strict indispensable dans une optique gestionnaire. Les analyses, les séjours à l’hôpital ou tout autre traitement considéré comme non nécessaire sont éliminés (Encadré 7).
Le médecin référent, par lequel le patient doit obligatoirement passer, est lui-même personnellement et financièrement récompensé pour limiter l’accès aux spécialistes ou aux analyses onéreuses. Les HMO ont été autorisées par le Congrès en 1973 et sont financées en partie par l’argent de l’assuré et en partie par le budget social du gouvernement.
Le nombre total d’adhérents à ces organismes - il s’agit d’adhérents « forcés » - est passé de 8 millions en 1980 à 140 millions aujourd’hui. Selon les estimations, ils couvrent 85% des personnes morales et privées assurées.
Encadré 7 :
Un rationnement médical criminel
Ethan Bedrick, né avec une importante paralysie cérébrale, devait bénéficier de séances de rééducation pour éviter la contraction de ses muscles. En 1993, alors qu’il avait 14 mois, l’assureur a arrêté de financer la rééducation.
Bien que ne sachant rien de cette maladie, le médecin référent du HMO, sans examen ni consultation avec les médecins d’Ethan, a conclu que la thérapie n’aboutirait selon lui à aucun « progrès significatif ».
En 1996, un juge saisi de l’affaire considère que la décision est arbitraire et sans fondement. Il note que « le fait que la possibilité de marcher à l’âge de cinq ans ne soit pas considéré comme un "progrès significatif" est simplement révoltant ». Cependant, les poursuites ont dû être abandonnées suite à la loi qui protège les HMO (loi ERISA).
Une femme gravement blessée dans un accident de voiture a été transférée dans quatre hôpitaux différents en trois jours par le HMO dont elle dépend, qui se justifie par le fait que les praticiens auxquels il fait appel dans ces structures n’étaient pas disponibles. Les transferts et le retard pris dans les traitements ont provoqué des dommages nerveux irréversibles. Ici encore, la loi ERISA interdit toute poursuite.
Un médecin ordonne que sa patiente enceinte soit hospitalisée étant donné les problèmes rencontrés au cours des grossesses précédentes. L’assureur de son employeur s’y oppose et autorise un suivi à domicile durant la journée, mais sans contrôle de nuit. Alors qu’elle était endormie, le fœtus subit une phase de détresse et meurt. Le juge, bien que convaincu du tort de l’assureur, a dû rejeter la plainte, en raison de l’ERISA.
L’étude menée par l’université de Harvard avec la Fondation Kaiser pour la famille a retenu quelques témoignages de médecins à propos d’événements récents :
- Le HMO n’avait pas de chirurgien vasculaire disponible et a retardé l’intervention pour un patient diabétique : il a fallu amputer.
- Un médecin référent refuse une coloscopie à un patient souffrant de constipation aiguë, ce dernier en meurt.
- L’assureur refuse une biopsie ; le patient avait un cancer du poumon.
- Une clinique HMO ignore pendant six mois la douleur dans le dos, liée à des symptômes neurologiques, d’un patient de 35 ans. On lui refuse la consultation d’un neurochirurgien. Il est frappé d’une paralysie de la poitrine.
- Un patient souffrant d’une très mauvaise circulation dans les jambes ne remplit pas les critères d’admission à l’hôpital requis par le HMO. Finalement admis, sa jambe doit être amputée.
Les abus innombrables et systématiques apparus avec l’extension du « managed care » provoquent de nombreuses réactions. L’économiste et candidat aux élections américaines Lyndon LaRouche en a fait l’un des thèmes majeurs de sa campagne présidentielle 2000. A propos de la loi ERISA, il déclare que « la mise en œuvre d’une politique médicale qui provoque la mort et la souffrance de personnes malades doit pouvoir faire l’objet de poursuites à l’encontre des HMO et des individus qui les dirigent. Le fait d’immuniser de tels criminels contre toute poursuite est en soi un crime contre l’humanité ».
D’après l’inspecteur général du département américain de la Santé, les structures du « managed care » ont grossièrement et volontairement augmenté leurs coûts administratifs annuels (remboursables) de 3 à 4 milliards de dollars. Une autre pratique consiste à sous-payer, ne pas payer ou payer en retard les hôpitaux qui fournissent les prestations approuvées.
De nombreux hôpitaux sont en danger de faillite pour cette raison. En tout cas, ces pratiques ont entraîné une nouvelle vague de réduction des coûts (« downsizing ») dans les hôpitaux, avec « des hôpitaux de toutes les tailles qui coupent dans leurs effectifs pour rester en vie » (revue Modern Healthcare de septembre 1998).
Une étude menée en juillet 1999 par l’université d’Harvard avec la Fondation Kaiser pour la famille a compilé les données suivantes suite à la mise en place des soins gérés :
83% des médecins et 85% des infirmières ont moins de temps à consacrer à leurs patients ;
Pour 72% des médecins et 78% des infirmières, la qualité des soins a baissé ;
Les patients de neuf médecins sur dix se sont vu refuser des services dans les deux dernières années.
61% des médecins essuient chaque semaine des refus concernant leurs prescriptions.
Selon Lyndon LaRouche [9], cette évolution dramatique vient d’une conception fausse de la santé nationale.
La tendance à traiter les patients exclusivement au cas par cas fait oublier l’impératif général de santé publique :
Bien sûr, le praticien s’occupe de chaque malade individuellement mais le système de santé qui a formé et mis au travail le médecin ou qui lui a donné l’infrastructure dans laquelle il administre les soins, doit considérer la population comme un tout. L’apparition de nouvelles formes d’épidémies de tuberculose résistante dans les pays développés, la crise du sida en Afrique ou même ici nécessitent que nous considérions l’ensemble de la population. Comment élever l’état de santé global du pays ? On ne peut examiner la situation à travers telle ou telle maladie spécifique, toute une série de problèmes se posent, y compris des problèmes de handicap qui rendent les personnes dépendantes (...)
Donc, l’idée de réduire la santé à une succession de cas individuels, de demander au patient sa carte de mutuelle ou sa carte de crédit et décider ensuite si vous allez le traiter ou non, ce qui arrive maintenant, voilà bien le rêve d’un comptable fou, d’une espèce d’Harpagon qui dispose de la vie ou de la mort : "Cette personne sera soignée, celle-là non".
« Le résultat, quand vous ne soignez pas les gens, ou quand vous ignorez les problèmes d’une partie de la population, c’est que les maladies en viennent à affecter toute la population.
Des médecins hospitaliers témoignent
Pour le Dr Kildare Clarke, responsable des urgences à l’hôpital de Kings County, Brooklyn :
La santé a été divisée en quatre parties : une santé pour les riches, une pour les pauvres, une pour les Noirs, une pour les Blancs. Cela m’inquiète beaucoup. Et il y a une cinquième ségrégation : les plus vieux et les plus jeunes sont mis de côté. On leur dit : nous ne pouvons pas nous occuper de vous. Vous coûtez trop cher. En résumé, ne prenons soin que des gens en bonne santé, des jeunes adultes qui ne coûtent rien. L’évolution des dernières années a fait de la santé une marchandise négociée en Bourse. La question est de savoir quelle HMO va pouvoir vous soutirer un montant substantiel mais si vous lui coûtez trop cher, votre place est six pieds sous terre. Cela n’arrivera pas tant que des gens comme M. LaRouche, mes collègues ou moi-même seront encore là, parce que nous nous battons (...). Aucun pays ne peut être riche si ses habitants ne sont pas en bonne santé. Le système de santé est la fondation de l’économie nationale. Le gouvernement fédéral doit faire en sorte que chaque citoyen bénéficie des meilleurs soins possibles. Et cela ne doit pas être un privilège mais un droit, et vous devez exiger ce droit (...).
Le Dr Abdul Alim Muhammad, directeur de la clinique Abundant Life à Washington D.C., va dans le même sens :
Ce qui se passe littéralement sous nos yeux, c’est que les vies humaines sont sacrifiées pour alimenter la bulle spéculative de Wall Street. Le changement récent du vocabulaire utilisé dans la santé est révélateur. Etudiant en médecine (j’ai eu mon diplôme de médecin en 1975), j’ai été formé pour soigner des patients. Maintenant, ils sont devenus des « consommateurs de santé » ou même des membres d’un système de soins gérés ; ce ne sont plus des patients. Mais pas de problème de toute façon je ne suis plus médecin. Je suis un "prestataire de services sanitaires". Je n’ai plus de profession, je participe à l’industrie ou au commerce de la santé. Les hôpitaux et les cliniques à leur tour ne sont plus considérés comme un service indispensable à la communauté, les voilà devenus « centres de coûts », des coûts à réduire le plus possible. Avec l’aide de politiciens malhonnêtes, des bandits de Wall Street ont réalisé voilà quelques années que la santé était une énorme vache à lait que l’on peut traire - presque 1 000 milliards de chiffre d’affaire net par an - mais que l’argent était gaspillé pour les gens et leurs demandes de soins.
Ces gens de Wall Street ont décidé qu’ils pouvaient faire mieux que les médecins et les professionnels de la santé, incompétents selon eux pour gérer les affaires. Ils ont prétendu nous "aider", ils nous ont en fait déchargés de la plupart de nos prérogatives. L’argent qui circule dans le système de santé est maintenant vu comme un flux de revenus supplémentaire, pour maintenir et faire gonfler la bulle spéculative.
Je suis originaire de Washington D.C. Nous assistons en ce moment à la destruction à grande échelle de l’infrastructure de santé dans notre capitale. Il y a quatre ans, le gouvernement du district budgétisait pratiquement un milliard de dollars par an pour le système de santé. La politique de soins gérés a été mise en place vers cette époque, sous le prétexte "d’améliorer le système". Dès que les soins gérés ont été acceptés, le budget santé du district de Columbia a immédiatement été réduit à 800 millions de dollars. Sur ces 800 millions, les organisations privées de type HMO prennent automatiquement 15% de frais de gestion. On est ainsi passé de un milliard à 800 millions moins 15%, soit 680 millions : la moitié des cliniques publiques du district ont disparu depuis trois ans. L’hôpital général du centre de Washington a été privatisé. Les deux HMO qui étaient supposées donner l’exemple, Prime Health et Chartered Health Care, ont fait faillite. Les administrateurs du département de la Santé qui ont conçu et mis en œuvre tous ces changements, ont démissionné pour rejoindre le secteur privé dans les deux derniers mois, comme des rats qui voient le navire prendre l’eau.
Les marchés financiers à l’assaut du magot des retraites
Une bonne partie de l’épargne des Français (700 milliards de francs en 1998) est constituée par l’épargne retraite, détenue aujourd’hui par les caisses de retraite paritaires du régime par répartition. Les « marchés » veulent absolument capter cette manne financière. Tout le jeu consiste à transférer le revenu des caisses de retraite mutualistes classiques vers les fonds privés (fonds de pension) qui injecteront aussitôt les sommes récoltées sur les marchés financiers.
Le très libéral Denis Kessler, président de la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), vice-président du Medef et proche ami de Dominique Strauss-Kahn, est la cheville ouvrière de ce projet.
L’hypocrisie des fonds de pension « à la française »
Pour justifier la mise en place des fonds de pension en France, c’est-à-dire la vente de l’épargne retraite à des intérêts financiers privés, les pouvoirs publics se targuent paradoxalement de la défense des intérêts du pays. On évoque la nécessité d’augmenter la liquidité des marchés financiers français face à l’invasion des fonds de pension étrangers sur la place de Paris (Encadré 8).
C’est oublier que les mêmes pouvoirs publics - toutes tendances politiques confondues - ont délibérément ouvert la place financière de Paris aux capitaux étrangers dans les années 80. L’argument selon lequel la mise en place des fonds de pension permettra de renforcer la capacité de financement de la Bourse de Paris ne vaut décidément pas grand-chose quand on sait que, selon une enquête menée par Natexis Groupe, la croissance et les profits des entreprises françaises sont en hausse et la marge d’autofinancement est proche de 150 % de l’investissement. Pourtant, ces entreprises ont peu investi en France et la soi-disant pénurie de capitaux français ne les a pas empêchées d’investir lourdement à l’étranger. C’est donc la rentabilité financière et non le manque de capitaux qui détermine le niveau d’investissement en France ou ailleurs.
Un premier projet de loi instituant les fonds de pension a été proposé au parlement en mars 1997. Son auteur, le député Jean-Pierre Thomas (UDF), a puisé principalement dans les statistiques de la FFSA. La défaite du gouvernement Juppé, en juin 1997, a reporté à plus tard son application. Le gouvernement Jospin travaille sur une version plus « présentable », toujours sous le prétexte qu’il faut absolument contrer les fonds des futurs retraités américains, britanniques et néerlandais.
Le projet soumis à Martine Aubry par son conseiller économique, Olivier Davanne, veut ménager la chèvre et le chou. Il propose de passer d’un système de répartition pure à un système de « répartition provisionnée ». Cela veut dire que les salariés paieraient non seulement les pensions des actuels retraités, mais acquitteraient en plus une nouvelle cotisation par capitalisation afin de créer des réserves au sein des régimes par répartition. Projet que Denis Kessler trouve trop timide :
Si un magot est constitué, jamais les gouvernements futurs ne résisteront à la tentation de piocher dans la caisse (sic). La solution est de créer de véritables fonds de retraite salariale.
Et de diminuer la charge patronale.
Il n’a pas fallu beaucoup d’efforts pour emporter l’adhésion au principe des fonds de pension d’un patronat (Medef, ex-CNPF) désormais dominé par les intérêts de banque et d’assurance. L’argument, directement inspiré par Denis Kessler, également vice-président du Medef, est que les fonds de pension sont un moyen d’abaisser les charges sociales en réduisant les cotisations de retraite classiques par répartition. A terme, il est question de dissocier la protection sociale du salaire, c’est-à-dire de revenir sur l’acquis des cinquante dernières années.
Encadré 8 :
L’invasion de la Bourse de Paris
par les fonds de pension anglo-saxons
Pour combler l’accroissement des déficits publics au début des années 80, les gouvernements des pays développés ont eu généralement recours à des emprunts obligataires (appels à souscrire aux bons du Trésor). Les pouvoirs publics français ont de surcroît modifié les textes législatifs de façon à permettre aux fonds étrangers d’acheter sans limites et à taux d’imposition zéro des actions françaises ; donc de devenir propriétaires de notre patrimoine productif.
Plus de 35% de la capitalisation boursière de Paris est aujourd’hui entre les mains d’investisseurs non-résidents. Le tiers des sociétés de Bourse ont un actionnaire majoritaire étranger ; il en est de même pour le tiers des membres du Matif. Tant au sein des grandes entreprises françaises que du tissu des PME-PMI, la part des fonds de pension anglo-saxons ne cesse de croître. Leur présence dans les sociétés du CAC 40 dépasse en moyenne 40% et atteignait 46% pour Elf-Aquitaine, 46,09% pour Valéo ou 45% pour Total en 1998. Les chiffres, depuis, se sont encore accrus.
Les investisseurs institutionnels anglo-saxons recherchent des titres liquides afin de pouvoir les revendre facilement, et c’est essentiellement pour améliorer la liquidité et remédier à l’étroitesse de la place de Paris que les milieux boursiers réclamaient depuis longtemps la création de fonds de pension « à la française »
Ne confiez pas votre retraite aux assureurs
Pour savoir ce que feront les assureurs de vos retraites, il est bon de les juger sur ce qu’ils ont déjà fait avec votre épargne.
Le stock de placements gérés par les compagnies d’assurances, au 31 décembre 1996, était de 3 000 milliards de francs. 90 % de cet argent appartient aux assurés et est versé aux compagnies sous forme de primes et de cotisations qui devront servir un jour à payer les sinistres, prestations, capitaux et rentes prévus par les contrats. Ils sont inscrits dans le bilan sous la rubrique « provisions » et, en attendant d’avoir à les restituer aux assurés, les assureurs les font fructifier. La tactique consiste à provisionner beaucoup plus que ne l’exige la prudence : les sommes prospèrent en Bourse ou dans l’immobilier et deviennent largement supérieures aux règlements lorsqu’ils se présentent. Les assureurs peuvent alors empocher la différence.
Des limites leur sont tout de même imposées par la loi. Les fonds d’assurance ne peuvent placer plus de 65 % de ces sommes en actions et plus de 45 % dans l’immobilier. Ils ne doivent pas non plus acheter, selon les cas, plus de 5 % ou de 10 % de leurs provisions dans un même titre. La latitude reste cependant grande, comme nous allons le voir.
En 1991-1992, les banquiers et les assureurs se revendaient, en circuit fermé, des immeubles à des prix surévalués. A ce petit jeu, Worms (UAP) perdra trois fois ses fonds propres : 10 milliards de francs. En 1997, l’UAP a vendu 1 400 logements, Axa 1 200, le GAN 950, les AGF 550 afin de garantir de nouveaux placements.
Tout cet argent a été immédiatement réinvesti en immobilier d’entreprise, jugé plus avantageux. Mais gare au dégonflement de la bulle. Entre 1992 et 1996, le GAN a perdu 40 milliards de francs en raison des décisions aventureuses prises dans l’immobilier par le biais de ses filiales spécialisées (la Bic ou la Bif, la banque du groupe qui finançait les professionnels de l’immobilier).
Par deux fois, en 1995 et 1997, l’Etat (donc les contribuables) a dû renflouer la compagnie pour un total de 22,8 milliards de francs, ce qui revient à plus de 12 200 francs par foyer fiscal. Après ce sauvetage, le GAN sera privatisé et l’Etat n’en tirera au mieux que 10 milliards de francs. En 1993, le GAN employait 9 488 salariés. Actuellement il en compte un millier en moins.
A force de trop gonfler les provisions pour pouvoir spéculer, plusieurs compagnies ont eu un « trou » dans leurs comptes d’exploitation. Elles se sont contentées, pour pallier au problème, d’une augmentation substantielle sur les primes demandées aux assurés sous forme d’ajustements tarifaires.
Depuis 1995, les sociétés d’assurances sont astreintes à mettre en évidence, dans leurs comptes annuels, les sommes tirées du produit de leurs placements financiers qu’elles allouent aux fonds propres. Sur l’exercice des années 1995 et 1996, les assurances de personnes (accidents, assurance-vie ...) et les assurances dommages (vols, incendies ...) ont atteint plus de 22 milliards de francs.
Comme la progression de la matière assurable stagne (le nombre de voitures, de logements, d’usines), et qu’en assurance-vie les dernières modifications de la loi de finances de 1998 font craindre là aussi une stabilisation des encaissements, la seule façon pour les assurances de continuer à croître est de racheter les concurrents ... ou d’étendre leur champ d’application comme dans « l’assurance-santé ».
L’euro reste le facteur déclencheur principal des mégafusions de type Axa en Europe. Les groupes trop nationaux (telles les mutuelles corporatistes) ne seront plus compétitifs et ne pourront que très partiellement faire appel aux marchés financiers. Les assureurs privés appellent à leur démutualisation (passage à des mutuelles-assurances privées soumises aux normes européennes) comme certains sociétaires de mutuelles anglaises, écossaises ou norvégiennes qui ont reçu plusieurs dizaines de milliards de francs lors d’opérations de démutualisation.
La prévention et les meilleurs soins pour tous
La dérive décrite dans la partie précédente révèle une crise plus générale du système financier mondialisé devenu incapable de subvenir aux besoins de tous. Il faudra sous peu une action concertée de la part des gouvernements pour mettre en règlement judiciaire ce système en faillite et prévoir une refonte globale des institutions actuelles, dans une sorte de nouveau système de Bretton Woods.
Comme la Libération et la reconstruction d’après-guerre ont permis de mettre en place un système de santé révolutionnaire pour l’époque, la nécessaire reconstruction de l’économie mondiale sur des bases plus saines sera l’occasion de réaffirmer certains principes et d’ouvrir de nouveaux horizons.
L’éclatement de la bulle financière doit être tout d’abord l’occasion de réorganiser les dettes, permettant à l’État de recouvrer le contrôle de sa politique monétaire et à la société de bénéficier à nouveau d’une politique d’investissement productif, à l’opposé de la politique de renflouement de la bulle pratiquée actuellement.
La politique sociale et d’éducation sera nécessairement un élément majeur de ce renouvellement.
En faisant du progrès technologique l’élément moteur et organisateur de notre système social, nous pouvons rendre les meilleurs équipements accessibles au plus grand nombre. C’est le moyen de rétablir l’égalité des soins et ainsi retrouver l’esprit du préambule de la Constitution de 1946, qui garantit à tous la protection sociale et la santé (Encadré 9).
I. Offrir à tous une prévention et des soins à la pointe du progrès
Le progrès technologique doit être l’élément moteur et organisateur de notre système de santé, en fonction duquel les choix médicaux et financiers doivent être faits. Or, à force de vouloir comprimer les dépenses, on supprime les investissements technologiques qui permettraient de faire de vraies économies. Cette attitude des pouvoirs publics est à terme le plus sûr moyen de voir réapparaître, tôt ou tard, le déficit de la Sécu.
Après l’effort considérable réalisé dans les années 60 et 70, notre pays est en train de prendre un retard important dans son équipement en matériels de haute technologie.
Pour Jacques N. Biot, auteur d’un rapport réalisé en collaboration avec le Syndicat national des industries médicales (le Snitem) sur les technologies médicales en France :
Les pouvoirs publics voient dans tout progrès ou innovation technologique une source potentielle de dépenses supplémentaires qu’il convient de juguler, avant même, et au lieu, de juger de leur éventuelle capacité à optimiser notre système. [10]
S’il y a des économies à faire dans le domaine de la santé, c’est pourtant en investissant en grand dans des moyens qui permettent de diagnostiquer plus rapidement et de soigner plus vite et mieux :
Les technologies médicales appliquées dans des conditions de bon usage optimisé, explique Jacques Biot, ont une incidence certaine sur la réduction des coûts de santé ; elles permettent en effet d’améliorer la productivité des services hospitaliers, de limiter les dépenses de suivi médical, d’hébergement, d’arrêts de travail voire d’éviter des ré-hospitalisations ou des complications.
L’innovation est source de grandes économies potentielles (encadré 9) à condition que les structures qui l’accompagnent s’adaptent en conséquence (notamment en répercutant la baisse des coûts) et que les caisses d’assurance-maladie modifient, à un rythme qui n’est pas aujourd’hui le leur, les tarifs et les nomenclatures.
La structure de la Nomenclature générale ou NGAP (pour Nomenclature générale des actes professionnels), qui donne la liste des actes remboursés et à quel tarif, date de l’arrêté du 27 mars 1992 ; modifiée à de nombreuses reprises, elle n’a jamais fait l’objet d’une refonte générale et n’intègre donc pas la majorité des actes liés aux nouvelles technologies médicales.
Le syndicat des chirurgiens-dentistes se plaint par exemple de ce que la nomenclature générale des actes professionnels relatifs à la dentisterie date pour l’essentiel du 12 mai 1960 :
Il y a une incohérence entre les techniques et les actes pratiqués dans nos cabinets en dentisterie, en prothèse, en chirurgie, et la nomenclature ; c’est-à-dire la liste des actes susceptibles d’être remboursés par la Sécurité sociale.
Autrement dit, la Sécu en est restée à la technologie des années 60 pour codifier ses remboursements dentaires ... et limiter sa contribution à la santé publique !
Encadré 9 :
Notre horizon : retrouver l’esprit des fondateurs de la Sécurité sociale
« France est sortie de la guerre particulièrement meurtrie » déclarait Pierre Laroque avant de fonder la Sécurité sociale.
Les vieux cadres sont brisés, il faut reconstruire, il faut faire du neuf, sous l’angle social, comme sous l’angle économique. Et c’est dans le cadre d’un effort d’ensemble pour l’édification d’un ordre social nouveau que se situe notre plan de Sécurité sociale.
Jean Monnet et l’équipe du Plan, cheville ouvrière de la reconstruction, embrassaient les problèmes de la nation globalement : il fallait équiper le pays pour en faire une grande nation industrielle moderne. Ils envisageaient la France comme une sorte de grande fabrique produisant toutes sortes de biens indispensables. Il fallait remettre la population au travail et restaurer les principales infrastructures. Pour cela, on devait d’abord se donner une main-d’œuvre en bonne santé, capable de pourvoir aux besoins particuliers et collectifs des Français (voir appendice).
C’est ce qu’exprime le Général de Gaulle dans son annonce devant l’Assemblée consultative provisoire le 5 mars 1945 :
Afin d’appeler à la vie les douze millions de beaux bébés qu’il faut à la France en dix ans, de réduire nos absurdes taux de mortalité infantile, d’introduire au cours des prochaines années avec méthode et intelligence des bons éléments d’immigration dans la collectivité française, un grand plan est tracé.
L’accent initial a été mis sur le ravitaillement et la production agricole. En 1954, avec Mendès-France et Monnet, chaque enfant de maternelle avait droit à son verre de lait quotidien.
Socialement, le « grand plan » de Charles de Gaulle a accouché de la Sécurité sociale, « la plus belle fille de la Libération ». Alliant la médecine privée et, pour les grandes infrastructures hospitalières, le secteur public, la majorité des objectifs ont été remplis. 99,5% de la population bénéficie aujourd’hui d’une protection sociale. Au cœur du dispositif, l’hôpital public regroupe encore les meilleures équipes, les matériels et les technologies les plus avancées, et c’est là que s’effectue la plus grande part de l’enseignement et de la recherche appliquée.
Parmi les grands domaines de pointe dans lesquels il existe des équipements performants, mais où nous sommes sous-équipés, citons :
- La télémédecine qui permet la réalisation à distance de diagnostics ou d’actes divers, jusqu’aux opérations chirurgicales en cas de besoin ;
- L’imagerie médicale, avec en particulier la résonance magnétique (Imagerie à résonances magnétique - IRM - appelée aussi résonance magnétique nucléaire, RMN) et la tomographie, principalement utilisées pour le traitement des cancers ;
- La microchirurgie.
Le dépistage précoce des pathologies grâce au développement de l’imagerie et notamment le diagnostic des cas difficiles sont déterminants pour le choix et le succès du traitement. Prenons l’exemple du TEP (PET en anglais), pour tomographe à émission de positrons. Cette technologie consiste à injecter des produits réactifs émetteurs de positrons (électrons chargés positivement) et à étudier les réactions des tissus [11].
Le TEP, mieux que toute autre technologie d’imagerie, est à même d’établir de cette façon des diagnostics pour les cancers du poumon ou du colon.
Il n’y a actuellement en France que deux TEP, un au Val-de-Grâce et un autre qui vient d’être installé à l’hôpital Tenon. Il en existe environ quatre-vingt en Allemagne, une vingtaine en Belgique.
Le besoin estimé dans notre pays, selon le Pr Askeniazy, chef du service de médecine nucléaire à l’hôpital St-Antoine, est d’environ soixante appareils. Un TEP coûte entre 6 et 14 millions de francs. L’injection du produit chargé de positrons, le FDG, coûte à elle seule 3 500 francs, ce qui porte le coût d’un examen à 7 000 francs tout compris.
L’argument opposé à la dissémination des TEP est bien sûr leur prix. Mais dans ce cas, le diagnostic est tout de suite très fin, il dispense de multiples autres analyses de laboratoires ou autres examens radiologiques, et permet entre autres de décider de ne pas opérer si cela est inutile. Faute de TEP, on multiplie des examens nécessairement moins efficaces, donnant lieu à de multiples déplacements et transferts.
A titre d’exemple, un transport médicalisé à l’intérieur de Paris, c’est-à-dire en ambulance avec infirmiers et éventuellement médecin, coûte autour de 5 000 francs. Si un patient doit rester hospitalisé parce qu’il y une liste d’attente pour accéder au TEP, le coût de la journée d’hospitalisation varie entre 4 000 et 10 000 francs ...
Il faut donc avoir des TEP et ne pas hésiter à s’en servir. Le Pr Askeniazy cite l’exemple d’un malade dont un premier examen général au TEP avait donné quelques indices de tumeurs au cerveau. Il aurait fallu un examen complémentaire rapide, du cerveau uniquement. Étant donné ce « surcoût » et la liste d’attente pour la machine de Tenon, les autorisations ont traîné, et lorsque le patient a pu à nouveau faire un TEP, de nouvelles tumeurs étaient intervenues. Celles-ci auraient peut-être pu être soignées entre-temps si l’examen avait été tout de suite poussé à fond.
On cite aussi l’exemple de ce professeur qui a mis au point un traitement nouveau, pour lequel il a eu une autorisation spéciale des autorités sanitaires, afin de traiter par l’injection massive de FDG les cancéreux considérés comme perdus. Le coût de l’injection est de 80 000 francs non remboursés par la Sécurité sociale, ni a priori par les mutuelles. Ce traitement - pour ceux qui ont pu se l’offrir depuis environ deux ans s’est traduit généralement par des rémissions, les patients sont toujours en vie alors qu’ils devraient être morts. Mais il faudrait à certains une deuxième injection. Avec quel argent ? Sans parler de ceux qui ne peuvent même pas se payer la première injection.
Dans un tout autre domaine, imaginons un médecin généraliste qui a un doute sur l’interprétation d’un électrocardiogramme. S’il était sérieux, il fera appel à un spécialiste, et ce dernier risquerait de refaire l’examen avec les moyens plus performants dont il dispose. La télémédecine permettrait pourtant de pratiquer à distance un électrocardiogramme de qualité et de le faire interpréter par le spécialiste voulu, sans déplacement du patient, avec un gain notoire de temps et d’argent, puisque tout se passe dans le cabinet du généraliste. Or la télémédecine n’est absolument pas prise en compte à l’heure actuelle par la Sécurité sociale.
Il en est de même pour les défibrillateurs cardiaques implantables. En délivrant un choc électrique au cœur, ils peuvent éviter à leur porteur le syndrome de la « mort subite » (une attaque cérébrale par exemple), mais en raison de leur prix relativement élevé, de l’ordre de 150 000 francs pièce, seulement neuf appareils par million d’habitants sont implantés en France, contre trente-sept en Allemagne et cent cinquante aux États-Unis. Quant aux appareils de RMN, on en compte 176 en France contre 1 000 en Allemagne.
Trop réticents à l’innovation technologique des dernières années, les pouvoirs publics n’ont du coup rien fait pour soutenir le secteur de l’industrie médicale : « L’industrie des technologies médicales n’a suscité de la part des Pouvoirs publics qu’un intérêt modéré, souvent limité à une approche économique voire comptable » affirme le rapport Biot.
Plus grave encore, contrairement à la plupart des professionnels des autres secteurs de l’économie, les médecins n’ont aucune facilité pour la formation permanente. A l’extrême, un médecin sorti de l’université en 1952 à 25 ans peut très bien, s’il n’a pas la conscience professionnelle qui caractérise fort heureusement la plupart de ses collègues, vous soigner aujourd’hui avec les connaissances de son époque. Tout au plus aura-t-il accès aux progrès des médicaments que lui propose régulièrement l’industrie pharmaceutique. Rien ne l’oblige ou ne l’encourage à se « recycler ».
Si les nouvelles technologies médicales sont considérées uniquement comme « ayant des coûts d’acquisition élevés », c’est aussi parce que les instruments pour analyser leurs retombées n’existent pas. Comme le dit le rapport Biot :
Faute d’outils d’évaluation macro-économique, il n’est pas possible de mettre en regard les économies réalisées par ailleurs.
Globalement, l’argent mis à maintenir en permanence les hôpitaux et les réseaux de soins à la pointe du progrès est largement « récupéré » par les bénéfices que la société en retire. Outre les économies réalisées sur les journées d’hospitalisation, on peut aussi compter sur une réintégration plus rapide des malades dans le tissu productif.
Nous touchons là - bien au-delà du secteur de la santé - à une incapacité fondamentale de l’analyse économique actuelle, qui n’a jamais considéré le progrès technologique comme une donnée à part entière ni pris en compte l’intérêt général (par exemple, les conséquences d’une guérison rapide), et qui n’est donc pas intéressée à calculer les effets macro-économiques de ce progrès. L’idée même de croissance économique est abordée dans les manuels de nos étudiants en science économique au dernier chapitre, pour dire que les fonctions économiques classiques sont incapables d’en rendre compte. Les plus honnêtes déclarent que le facteur-clé, qui a sans doute été oublié, c’est le progrès technologique.
Sur les traces de l’économiste américain Lyndon LaRouche, il faut au contraire considérer dès le départ le progrès technologique comme la force motrice de l’économie réelle, permettant de subvenir aux besoins d’une population toujours plus nombreuse, prospère et en bonne santé. C’est en suivant cette voie que l’on arrivera à redéfinir une politique de santé publique.
II. Rétablir l’égalité dans l’accès aux soins
L’inégalité devant la santé est strictement proportionnelle au mode de vie, selon que les revenus sont élevés ou non. La baisse des revenus des populations affecte globalement la prévention et le niveau des soins. En France, la différence d’espérance de vie entre un manœuvre de 35 ans et un cadre supérieur était, en 1980, de neuf années.
Avec la crise, cette différence qui était en voie de résorption dans les années 60, a de nouveau tendance à s’accroître, au détriment des populations « exclues ». Rappelant que la découverte à New-York en 1996 de vingt-cinq cas de tuberculose évolutive sur 100 000 personnes avait déclenché une véritable panique, l’ancien ministre chargé de l’Aide humanitaire et sociale Xavier Emmanuelli déclarait en juin 1999 : « Nous, on s’aperçoit que sur Paris, la tuberculose est de cinquante pour 100 000. C’est donc effroyable. Il faut faire quelque chose. Il faut inventer pour les exclus des nouvelles manières de dépistage. »
Encadré 10 :
Les progrès scientifiques et technologiques
dans la science médicale
Les progrès scientifiques et technologiques dans la science médicale permettent :
- de prévenir l’apparition des affections ou de les dépister beaucoup plus tôt,
- de remplacer progressivement les opérations classiques au profit d’interventions très ciblées et peu coûteuses en frais d’hospitalisation,
- d’alléger considérablement les traitements et de raccourcir le temps de convalescence.
La banalisation des techniques est accompagnée d’une extension de leur utilisation. Chez les personnes âgées, on pratique désormais les dialyses, on effectue des opérations de la cataracte alors même qu’il y a une vingtaine d’années l’on en mourait ou devenait aveugle.
Voyons quelques exemples des progrès réalisés, décrits par Jean de Kervasdoué (*) et le Pr Jean-Charles Sournia (**) :
« Pour les analyses, Il faut parfois aujourd’hui 1 000 fois moins de temps qu’il y a seulement vingt ans. Moins onéreuses, plus rapides, ces analyses sont aussi plus fiables.
« Aucune révolution n’a été aussi radicale dans les pratiques chirurgicales que celle de la coeliochirurgie, née et perfectionnée en France. À l’aide d’instruments et d’une optique introduits dans la cavité abdominale par deux petites incisions, on peut faire des prélèvements, on peut enlever des tissus ou des organes anormaux, corriger des mal positions, suturer des conduits ou des vaisseaux etc. …
« Un pas de plus a été franchi lorsque l’optique introduite dans la cavité a été complétée par la transmission télévisuelle : la vidéochirurgie permet dès lors au chirurgien de contrôler à distance le jeu de ses instruments non pas sous le contrôle direct de la vue, mais par lecture sur écran.
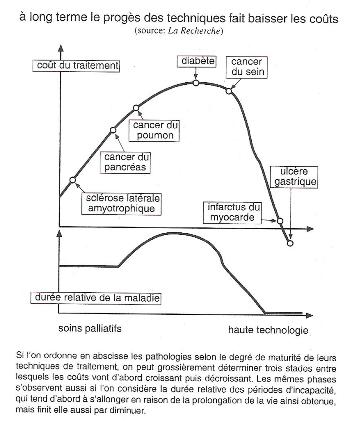
« Ces perfectionnements représentent des économies dans la longueur des incisions cutanées, donc dans les risques d’infection et de douleurs postopératoires, et des gains de temps ; ils exigent moins de personnel, avec des anesthésies plus courtes en écartant souvent l’anesthésie générale. On comprend que les malades subissant moins de désagréments limitent d’eux-mêmes la durée de leur hospitalisation : ces interventions ont considérablement raccourci les temps de séjour en établissement de soins. Un patient hospitalisé pour subir une opération de la cataracte reste en moyenne deux jours contre huit il y a dix ans. L’incision est plus limitée, les cristallins artificiels sont meilleurs, les complications sont moins nombreuses et l’intervention coûte moins cher (***). On répand la coutume des opérations pratiquées en l’espace d’une journée, les institutions privées s’étant adaptées à cette "chirurgie de jour" plus rapidement que les hôpitaux publics.
« Si certains traitements sont, au départ, très onéreux, le fait est que l’on trouve souvent le moyen d’en baisser le coût ; entre-temps, on a sauvé des vies humaines. Jusqu’à la fin des années 40, les insuffisants rénaux chroniques dont les reins avaient cessé de fonctionner mouraient. Aujourd’hui, 18 000 insuffisants rénaux chroniques disposent de reins artificiels, représentant un coût de 10 milliards de francs environ pour l’assurance maladie. Ce coût important a encouragé la pratique de la transplantation. Quand elle est possible et réussie, elle évite plusieurs années de dialyse. Un malade en dialyse coûte entre 250 000 et 500 000 francs par an ; une transplantation coûte de l’ordre de 140 000 francs et ces coûts ne se répètent pas d’année en année.
« Il en est ainsi aussi dans le domaine du diagnostic. Quand les premiers appareils de résonance magnétique nucléaire sont apparus, ils coûtaient cher (15 millions de francs pour certains d’entre eux en 1984), ils étaient lents et d’accès difficile. Aujourd’hui, ils sont trois à quatre fois moins chers, plus rapides et plus faciles d’accès. »
Notes :
(*) La santé intouchable, enquête sur une crise et ses remèdes, Jean de Kervasdoué, JC Lattès.
(**) La nouvelle médecine française. Jean-Charles Sournia, site Internet (bibliothèque) du ministère des Affaires étrangères.
(***) En 1970, la durée moyenne de séjour dans les hôpitaux français était proche de quinze jours. Elle a été divisée par plus de deux en vingt cinq ans.
A l’hôpital
L’hôpital sera - encore et toujours - le pivot de notre système de soins. Il a évolué surtout depuis une trentaine d’années vers une technicité croissante, qui permet de traiter très efficacement et rapidement les cas d’urgence, moyennant un coût plus élevé par journée d’hospitalisation. Les considérables progrès réalisés dans le diagnostic grâce aux techniques d’imagerie médicale (RMN, gamma-caméras, exploration par laser, etc.) permettent de réduire les interventions au strict nécessaire. Il était un temps où il fallait opérer « pour voir ». Maintenant on sait exactement où l’on va, et la microchirurgie minimise considérablement le choc opératoire. Les interventions sont moins longues, moins invasives, et la récupération se fait bien mieux, raccourcissant les séjours en milieu hospitalier.
Aujourd’hui et plus que jamais, les grands centres hospitaliers doivent avant tout concentrer les compétences et les meilleurs matériels afin de traiter les urgences et les cas graves, en restant toujours à la pointe.
Le raccourcissement du séjour hospitalier implique cependant un renforcement des équipes soignantes, et non une diminution comme c’est le cas depuis 1995. La charge de travail est plus grande en effet lorsque le malade reste peu et pour des soins intensifs. L’extrême technicité des soins absorbe actuellement les personnels soignants au point où la relation humaine avec leurs patients se réduit à presque rien. Des soins de qualité exigent une disponibilité et une écoute qui n’est pas compatible avec la rationnement actuel des effectifs.
Désengorger les urgences et les services hospitaliers
Le traitement aux urgences est pleinement justifié pour seulement 15% des personnes qui s’y présentent, il est compréhensible pour 40% des admis. Les autres peuvent être examinés par des médecins appartenant à des réseaux de garde et de soins à domicile, à mettre sur pied ou à développer. Débordés, les services des urgences sont réduits à faire du « triage », avec des délais d’attentes excessifs. Quand s’y ajoutent des locaux vétustes et à la limite de la propreté, l’effet sur le malade est désastreux.
Plus généralement, l’hôpital public héberge en trop grand nombre des personnes qui ne devraient pas y être, surtout les plus démunis - pour lesquels l’hôpital est le seul endroit où l’on puisse se faire soigner gratuitement - et les personnes âgées en long séjour (dans les hôpitaux américains, les personnes âgées sont affublées du nom de « Gomers » pour « go out of my emergency room », littéralement « tire-toi des urgences », avant de devenir des « Bed blockers » pour « bloqueurs de lits »).
L’hôpital actuel n’est pas de toute façon un lieu de vie adapté à la convalescence. Au choix du malade et suivant son état, le patient sera orienté vers son domicile ou vers une structure hôtelière proche. Il faut un suivi d’autant plus rapproché après l’hospitalisation que celle-ci a été courte. On ne peut renvoyer brutalement et systématiquement le patient à son domicile comme c’est souvent le cas, avec parfois des complications et des infections nosocomiales. La mise en place à grande échelle de réseaux de soins à domicile et de résidences médicalisées dotées de télésurveillance demande des investissements conséquents. Le but n’est donc pas de faire des économies en poussant les malades hors de l’hôpital, mais d’améliorer le bien-être du convalescent et accélérer sa guérison.
Soulignons toutefois la spécificité de certains services comme la maternité pour lesquels, à l’inverse, il faudrait rallonger la durée des séjours hospitaliers, actuellement réduits à l’extrême.
Il est par ailleurs question de confier les urgences dans les CHU à des praticiens polyvalents ayant acquis des connaissances rudimentaires dans tous les domaines de la pathologie. C’est, selon le Pr Vichard, un défi intellectuel humainement impossible à réaliser. Faire prendre en charge le malade par un praticien au savoir limité, formé sur le tas, sous prétexte que les pouvoirs publics cherchent avant tout à augmenter le nombre de blouses blanches aux urgences pour rassurer le public, est typique de cette « gestion de crise » qui ne peut aboutir qu’à des désastres. Le nombre ne doit jamais se substituer à la qualité. Il faut les deux.
Augmenter les dotations en équipements
La diffusion des matériels modernes - pour les rendre accessibles au plus grand nombre - se heurte aux critères budgétaires des agences régionales d’hospitalisation (ARH). Bien dotés, les hôpitaux auront d’autant plus les moyens de former et de recycler les médecins aux dernières avancées. Au moment où l’industrie médicale souffre d’un quasi-abandon des pouvoirs publics, c’est aussi l’occasion d’établir un partenariat industrie-hôpital pour la mise au point d’équipements qui pourront aussi être exportés.
Bien que souvent trop réduite, la dotation de chaque région en équipements, décidée par les agences régionales d’hospitalisation, se fait en négligeant les critères géographiques (temps moyen mis pour accéder aux équipements).
Deux régions sont ainsi mieux équipées ; l’Île-de-France parce que la population y est très dense et la Côte-d’Azur parce que la clientèle est plus âgée et aisée. La plupart des autres régions sont moyennement ou mal équipées. Pour accéder à tel ou tel matériel, quand il existe, il faut faire de nombreux kilomètres, ce qui éloigne le malade et sa famille (il a été démontré que les chances de guérison dans les petites unités, à qualité de soins égale, sont supérieures à celles des grandes unités, pour des raisons d’entourage affectif et familial). Il s’ensuit de nombreux déplacements d’hôpital à hôpital parce que, suite aux restructurations, chaque hôpital se voit cantonné dans un rôle de plus en plus étroit.
Autonomie et augmentation des moyens humains
Une plus grande autonomie des hôpitaux sera le gage d’une meilleure gestion. L’hôpital public doit dans ce cadre être bien doté - et d’une façon distincte - pour ses missions fondamentales de service public : urgences, recherche, formation. Dans le cadre de « l’enveloppe globale » actuelle, la majeure partie des décisions de dépenses et de recettes sont extérieures à l’hôpital. Le poids grandissant des contraintes réglementaires visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins demande un travail supplémentaire des équipes soignantes (à titre de comparaison, le secteur automobile a mobilisé 10% de ses effectifs pendant dix ans pour l’amélioration de la qualité). Les dirigeants se trouvent sans marge de manœuvre, avec pour seul choix le dégraissage ou l’embauche au rabais. Il faut de toute urgence embaucher dignement les personnels qualifiés dont on a besoin. Nous ne prendrons que deux impératifs, parmi les plus criants ; offrir de toute urgence une formation et un statut dignes de ce nom aux médecins étrangers, majoritaires aux urgences, souvent vacataires et payés moitié moins que leurs collègues français et prendre en compte, par une augmentation des rémunérations et des perspectives de carrière, le fait que le métier d’infirmière hospitalière est beaucoup plus qualifié qu’il ne l’était. La réduction des effectifs pèse doublement sur les infirmières amenées à pallier aux manques de disponibilité des médecins et au sous-effectif des personnels de nettoyage.
Dans les cliniques
Les cliniques doivent pouvoir s’en sortir sans chercher à « faire du chiffre ». Remboursées à l’acte par l’assurance-maladie, elles ont tendance à multiplier les actes, pour grossir leur chiffre d’affaire. Leur sous-capitalisation les pousse à ce comportement. Faute de fonds propres, elles sont obligées pour subsister de se vendre aux grands groupes financiers qui pratiquent la réduction systématique des coûts.
Elles doivent être aidées à acquérir une autonomie financière, en fonction de projets de développement et de soins à contrôler et suivre étape par étape.

Les dépenses de santé, autour de 700 milliards de francs depuis 1996, se répartissent pour l’essentiel entre l’hôpital (près de 50%), les honoraires médicaux et dentaires (près de 20%) et la pharmacie (environ 18%). Ces dépenses ont donné lieu en 1996 à 458 milliards de remboursement de la Sécu, dont 13,8% pour la pharmacie. L’hôpital public représente 42% du budget de la santé. Sur ce budget, 72% sont dépensés en frais de personnel.
Pour la médecine de ville
Grâce à des mesures incitatives, les pouvoirs publics devraient encourager les médecins à choisir leur spécialité et leur implantation en fonction des besoins de la population, alors qu’aujourd’hui c’est la carrière, la rémunération et le confort de vie qui priment. Les spécialités à risques ou à fortes contraintes sont actuellement délaissées. Les risques judiciaires encourus par les anesthésistes et les gynécologues provoquent par exemple l’abandon de ces spécialités, pour lesquelles on recrute de brillants médecins de pays étrangers, en pillant dans la substance de ces derniers. On paraît se résigner à cette situation. En même temps, les radiologues exerçant dans des grandes villes - spécialisation sans risques et n’exigeant pas de compétences excessives obtiennent des revenus plus que confortables.
A travers la refonte des conditions statutaires de l’exercice de la médecine libérale - qui remontent à plus d’un siècle ! - la collectivité nationale doit exprimer ce qu’elle attend des médecins libéraux et leur en donner les moyens. La liberté de choix du médecin par le patient doit bien sûr être préservée, mais encore faut-il qu’il y ait un choix possible, ce qui n’est pas toujours le cas, loin de là. Nous estimons pour notre part que :
- Le médecin généraliste a vocation à rester le pivot de la médecine libérale, pourvu qu’il soit bien formé, équipé, et qu’il se tienne au courant des dernières avancées.
- Parallèlement au paiement à l’acte, qui pousse à la consommation, le médecin libéral devrait pouvoir être rémunéré pour une médecine de qualité et de prévention qui exige de prendre plus de temps et d’écouter le patient.
- Le médecin devra aussi choisir sa spécialité et son implantation en fonction des besoins de la population, pas uniquement des revenus et du confort de vie qu’elles procurent. On a actuellement, particulièrement en campagne, un nombre croissant de zones sans médecins où le seul recours - parfois éloigné - est l’hôpital.
- La disponibilité des médecins libéraux qui s’est dégradée ces dix dernières années, particulièrement pour les rendez-vous urgents, doit être améliorée. Actuellement, la médecine libérale pratique majoritairement les heures de bureau. Elle est souvent fermée le samedi au moment même où ceux qui travaillent auraient le temps d’y aller pour eux-mêmes ou leurs enfants.
A la Sécurité sociale…
- La Sécurité sociale est à la santé publique ce que le ministère des Finances est au gouvernement. Elle a les moyens d’imposer une politique ambitieuse de santé publique en tant que payeur en dernier ressort. La grande machine administrative, « qui rembourse » sans porter de jugement, est appelée à changer, pour devenir le fer de lance de la nouvelle politique de santé.
- Première tâche ; augmenter la part remboursable, en baisse depuis vingt ans à tel point qu’il faut aujourd’hui avoir systématiquement recours aux assurances complémentaires privées, alors que dix millions de Français n’en ont pas les moyens.
- Afin de diminuer le coût par personne des soins de qualité, la « Sécu » doit, on l’a vu, favoriser l’emploi des produits et méthodes de pointe à grande échelle à travers la mise à niveau des nomenclatures.
III. Priorité à la prévention
L’amélioration générale du niveau de vie et d’éducation reste la meilleure prévention. La succession de progrès scientifiques et technologiques qui caractérise toute économie vivante doit se diffuser progressivement dans toute la population, en s’appliquant à tous les domaines de l’existence : politique alimentaire, nutrition, famille, école et travail, ville et campagne etc.
En tant que telle, la prévention repose sur trois piliers :
- Un dépistage généralisé en évaluant pour chaque individu les points vulnérables, par exemple la prédisposition à telle ou telle maladie ou déficience. Cela ne pourra être fait à grande échelle qu’avec l’arrivée de nouveaux instruments, notamment des spectroscopes de masse permettant de faire l’inventaire spatiotemporel du corps humain en train de vivre, en trois dimensions.
- L’établissement d’une carte épidémiologique du territoire, à l’aide de registres, qui commencent tout juste à être constitués, par exemple pour les cancers (on entrevoit des appareillages qui permettront de faire en quelques minutes l’inventaire de tous les virus et microbes jugés indésirables chez n’importe quel patient).
- Une éducation sanitaire généralisée à l’école. L’assurance maladie ne consacre actuellement que quelques dizaines de millions de francs par an (30 millions eh 1997) à l’éducation pour la santé alors que l’industrie pharmaceutique consacre 6 milliards de francs à la publicité auprès du corps médical !
Dans ces domaines, prévention et épidémiologie, le plus gros reste encore à faire.
La médecine scolaire
L’éducation sanitaire doit commencer à l’école. On en sort avec une foule d’informations, sans savoir la façon dont nous sommes faits nous-mêmes et en quoi notre vie et notre santé (aliments, rythmes de vie) sont précieuses pour la société.
Avec une charge de cinq mille enfants par tête, les médecins scolaires ne font pas face. Leur effectif doit être doublement renforcé, compte tenu des nouvelles tâches qui leur incomberaient dans l’hypothèse d’une relance de la prévention et de l’éducation à la santé. Le projet de loi de finances 1997 sur la Sécurité sociale prévoyait le renforcement des équipes de médecine scolaire et du travail par des médecins sentinelles chargés de l’épidémiologie et de la prévention. L’idée a été abandonnée « faute d’argent ».
La médecine scolaire a un rôle essentiel à jouer dans l’alimentation des enfants, afin de repérer en amont le problème des carences alimentaires et de la malnutrition, surtout dans les familles pauvres (il y a en France 10% de pauvres). Certains collèges prévoient une caisse pour que les enfants des ménages les plus démunis aient accès à la cantine scolaire. Mais cela relève d’initiatives locales, professeurs ou parents d’élèves qui s’aperçoivent de situations difficiles. Il faut substituer une logique de responsabilité publique à celle d’intervention charitable qui prévaut actuellement.
Pour y parvenir, il faut au moins trois assistantes sociales et une infirmière à plein temps pour cinq à six cents jeunes, plus un médecin venant faire des consultations gratuites au moins trois à cinq demi-journées par semaine. Ici encore, le « gain » obtenu par l’amélioration du présent et de l’avenir médical des enfants et des adolescents compensera le « coût » supplémentaire au départ.
L’éducation des mères est tout aussi vitale. Des études récentes conduites en Angleterre, en Suède, en Inde et dans d’autres pays indiquent que plusieurs pathologies (coronopathies, hypertension, accidents cardiovasculaires cérébraux, diabète non insulino-dépendant et thyroïde auto-immune) débutent in utero ou dans la petite enfance, mais ne sont apparentes qu’à un âge moyen ou avancé. Dans ce cas, les individus semblent en bonne santé et aucun trouble ne se manifeste durant la période de latence. Cependant, l’apparition précoce de maladies dégénératives chez la personne âgée semble liée à un développement cellulaire anormal dans les premières années de la vie.
La médecine du travail
Les effectifs de la médecine du travail doivent aussi être augmentés (il y a dans la médecine du travail interentreprises environ un médecin à temps plein pour 3000 salariés) et leurs missions élargies. La médecine du travail pourrait être un relais précieux dans la prévention auprès des adultes et l’épidémiologie. A ce jour, seules lui incombent la santé et la sécurité des salariés sur leur lieu de travail [12].
Parce qu’elle contribue à la santé publique, la médecine du travail doit être financée à part égale par l’Etat et l’employeur et non exclusivement par l’employeur comme c’est le cas aujourd’hui (soumises à la déréglementation et à la concurrence, les entreprises voient souvent dans le poste « médecine du travail » une obligation légale dont elles se passeraient bien. D’autant plus que le médecin du travail demande parfois des investissements supplémentaires pour améliorer la sécurité).
Le médecin du travail perd sa raison d’être si, sous prétexte de la concurrence acharnée, les pouvoirs publics ferment les yeux sur la sécurité pour sauvegarder l’entreprise qui n’a pas les moyens d’investir, ou que la charge supplémentaire rendrait moins « compétitive ».
S’il faut en finir avec le chômage et le travail au noir, cela ne doit pas dispenser de suivre médicalement, d’ici là, les chômeurs et les travailleurs au noir sous la forme d’une assistance gratuite et anonyme (dans le bâtiment, la confection, la restauration ...).
Par ailleurs l’hygiéniste, l’infirmier, le psychologue, l’ergonomiste ont vocation à travailler aux côtés du médecin, pour envisager globalement la qualité de vie au travail. Cela reste un vœu pieu pour 80% des entreprises qui sont des PME. Aussi ce type de service aux PME doit être au départ envisagé plus comme une aide que comme une contrainte.
La prévention des maladies du vieillissement
Sans les vaincre toujours, on peut de mieux en mieux intervenir dans les nouvelles pathologies liées à l’avancée de l’âge : cancers, maladies cardiovasculaires, affections liées à l’ostéoporose chez les femmes, et maladies dégénératives. On peut également lutter contre le vieillissement physiologique, c’est-à-dire la perte de la masse osseuse, de la masse musculaire, la rigidité artérielle entre autres.
Prenons le cas de l’ostéoporose, cette fragilisation des os qui intervient chez les femmes après la ménopause. L’ostéoporose est à l’origine de nombreuses hospitalisations pour fractures, avec des séquelles lourdes dans un certain nombre de cas. La première prévention se fait entre 15 et 20 ans, au moment où se forme l’essentiel de la masse osseuse. Il faut un régime alimentaire bien équilibré et de l’exercice physique. La deuxième prévention, c’est un traitement hormonal à partir de l’âge de 45 ans. Tout ceci évite les fractures après 75 ans. En France, le pourcentage des femmes récemment ménopausées qui sont traitées est de 30%. Des progrès ont été réalisés mais il reste beaucoup à faire.
La prévention des cancers du sein et du colon devrait aussi faire l’objet de dépistages systématiques ou alors de campagnes d’éducation bien plus importantes. Un cancer du sein de moins d’un centimètre peut être guéri dans 90% des cas et ce à moindre frais. Aujourd’hui, seuls trente-et-un départements ont mis sur place un dépistage systématique pour les femmes de plus de cinquante ans.
Pour les personnes plus âgées
Une fois que les personnes ont atteint un certain âge, une prévention digne de ce nom passe par la mise en place de services gériatriques, ce qui n’existe pratiquement pas dans notre pays. La discipline gériatrique n’est pas reconnue comme telle par l’université et les jeunes médecins ignorent généralement tout du vieillissement et des problèmes particuliers qui lui sont liés, ce qui est un comble quand on mesure l’ampleur révolutionnaire du phénomène de vieillissement.
L’un des domaines où il reste le plus de progrès à faire (car la recherche est récente) est celui des maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer ou celle de Parkinson. Des traitements pour retarder leur évolution existent d’ores et déjà ceux-ci devraient être administrés à toutes les personnes souffrant d’Alzheimer, maladie que de nombreux médecins, faute de formation, traitent encore souvent d’un revers de manche en disant : « C’est l’âge ». Globalement, le coût d’un patient dont on traite la maladie d’Alzheimer est, selon le Pr Forette [13], inférieur à celui d’un patient qui n’est pas traité. Mais il faut raisonner globalement, car le coût est reporté de la famille vers la Sécurité sociale.
Plus généralement, un examen gériatrique complet à partir d’un certain âge, avec les soins qui s’ensuivent, « réduit non seulement le taux de mortalité prématurée, la fréquence des placements en établissements de long séjour et le taux de réadmission en milieu hospitalier, mais améliore également l’état fonctionnel des personnes âgées fragiles » (Françoise Forette).
Par ailleurs, les soins gériatriques spécifiques n’alourdissent pas les dépenses de soins et s’avèrent rentables à long terme. Ils pourraient même réduire considérablement les frais d’hospitalisation.
Prévoir des structures pour la grande dépendance
Très peu de structures ont été prévues jusqu’à maintenant pour les personnes dépendantes de plus de 85 ans, sauf pour celles qui ont suffisamment de moyens financiers. Ces personnes se retrouvent souvent grabataires à l’hôpital public, et leur état s’y aggrave car l’hôpital n’est pas conçu pour les recevoir. Elles sont très souvent, bien plus que la moyenne, tentées par le suicide.
Centraliser les données auprès du patient
Tout en laissant complète liberté au patient dans le choix du praticien, il faut que ce dernier puisse connaître complètement l’historique médical de son patient sans avoir à reconstituer toute une vie. Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées. Le suivi doit être pris en charge par des organismes assurant une confidentialité absolue, notamment pour éviter le triage d’assureurs privés qui ne veulent retenir que des malades « rentables ».
Favoriser une véritable médecine en réseau
A l’opposé des réseaux de « soins gérés » américains, nous devons favoriser le développement d’une véritable médecine de réseau. Plus on avancera dans la connaissance médicale, plus la prévention et les traitements nécessiteront des jugements croisés de spécialistes de différents secteurs de la santé et une collaboration entre le médecin généraliste, le ou les médecins spécialistes, l’infirmière, les professions paramédicales (kinésithérapeute, psychologue, etc.), éventuellement le médecin du travail et l’assistante sociale.
Un réseau rassemble ces compétences entre personnes qui se connaissent pour offrir au malade une prise en charge globale et lui proposer le mode de soins qui lui convient le mieux. Une telle coopération permet en particulier d’éviter les hospitalisations systématiques. Si hospitalisation il y a, on doit orienter les patients dès que possible vers leur domicile ou vers des appartements d’accueil pour une transition entre l’hôpital et le domicile.
Le réseau doit donc renforcer les capacités d’aides médicale et ménagère et de soins à domicile, notamment pour les personnes âgées et valides ou qui pourraient l’être rapidement.
Relever les défis du XXIe siècle
I. Le défi culturel : vivre plus longtemps et mieux
L’espérance de vie est actuellement en France de 75 ans pour les hommes et de 83 ans pour les femmes. Au début des années 50, l’espérance de vie moyenne de la population mondiale était de 47 ans [14].
Jeanne Calment a démontré que l’on pouvait aller jusqu’à 120 ans avec une santé satisfaisante.
Cela dit, nous ne savons pas vraiment jusqu’à quel âge nous pouvons vieillir. Il n’est pas du tout prouvé que la vie humaine soit fixe. Selon James W. Vaupel [15] :
Les taux de mortalité, même aux âges les plus avancés, sont malléables et peuvent être réduits par des interventions médicales, comportementales ou environnementales.
Malgré les faits, affirme Vaupel :
La conviction que la mortalité au grand âge est irrémédiable reste profondément enracinée chez de nombreuses personnes. En raison de ses implications pour la recherche, la santé et la politique sociale, cette conviction est pernicieuse. Mais comme elle est prédominante, les prévisions de croissance de la population âgée sont trop faibles, les dépenses de santé pour ces sujets sont insuffisantes et les dépenses de recherche biomédicale sur les maladies mortelles du grand âge sont également insuffisantes.
Quand elle évoque les perspectives d’avancée en âge, Françoise Forette suscite régulièrement des réactions apeurées. Nous avons généralement une vue négative de la période de la vie au-delà de 65 ans : plus d’un se voit grabataire, dépendant, « gâteux ». En fait, moins de 5% des personnes âgées de plus de 65 ans (et moins de 12% des plus de 80 ans) vivent dans des centres spécialisés.
L’espérance de vie « en bonne santé » (sans incapacités) augmente encore plus vite que l’espérance de vie moyenne. L’allongement de l’espérance de vie à la naissance intervenue au cours de la dernière décennie en, France, par exemple, n’a provoqué aucune augmentation des années d’invalidité.
Une autre peur domine : l’ennui, pour des personnes que la retraite rend inactives.
Toute une série de nouveaux défis se posent ainsi, sur l’aménagement des périodes de vie et l’organisation de la société :
Être actif tout au long de son existence
Aujourd’hui, dans notre économie en pleine crise, l’augmentation importante de la population âgée est vue uniquement comme un grand poids à porter par le reste de la société. En effet, le chômage de masse force les personnes de 55 ans et plus à une retraite anticipée.
Au contraire, les réformes économiques que nous préconisons nous permettant- en principe -de vivre tous centenaires, nous devrions passer à une économie organisée selon une géométrie complètement différente, à très haute valeur ajoutée, nécessitant une main-d’œuvre extrêmement qualifiée, car les emplois s’éloigneront toujours plus des tâches physiques (l’idée que la vieillesse commence à 60 ans est dépassée ; elle remonte à Jean-Baptiste Colbert, dans une économie où le travail physique était prépondérant).
Le modèle actuel découpe la vie en compartiments étanches : préparation à la vie active jusqu’à 25-30 ans, vie active jusqu’à 55-65 ans, et la retraite au-delà. Il n’a plus de sens. Supposons un ingénieur de haut niveau formé jusqu’à 30 ans, mis en préretraite à 55 ans, et qui vit jusqu’à 95 ans : c’est vingt-cinq ans de vie active pour vingt-cinq ans à l’école et quarante ans en retraite !
Les périodes actives succèderont à des périodes de congés longs (pour les enfants, congé sabbatique), ou de reconversion (formations, reprise des études, etc.). Cela permettra d’aménager une vie productive sur le long terme, bien au-delà de 60 ans. Généralement, on organisera la société de façon à permettre à chacun de développer au mieux son potentiel créateur. Combien d’adultes n’ont eu d’activité « intellectuelle » que durant leur période scolaire ou universitaire ? Une fois le diplôme en poche, la « vie active » est souvent synonyme de désert intellectuel et culturel (Encadré 12). Les « loisirs » ne visent pas purement à « passer le temps », ils permettent d’exercer d’autres activités créatrices comme de jouer d’un instrument de musique, participer à des découvertes scientifiques, se préparer à une reconversion, etc.
Le droit d’avoir plus d’enfants : rétablir la base de la pyramide des âges
A l’autre bout de la pyramide des âges, les conditions de vie actuelles dans les pays développés bloquent le taux de fécondité. Nombreuses en effet sont les familles qui limitent leur taille pour des raisons matérielles et pécuniaires. L’augmentation du niveau de vie moyen permettra aux ménages des pays développés et en développement d’avoir plus d’enfants, autant qu’ils le désirent et d’autant plus qu’ils seront convaincus que leur société se bâtira pour assurer un avenir meilleur.
La baisse préoccupante du taux de fécondité dans nos pays est d’ailleurs en passe d’atteindre nos voisins du Sud. On constate depuis une dizaine d’années un net ralentissement dans la croissance de la population mondiale, largement dû aux nouveaux comportements dans les pays en voie de développement. Le nombre d’enfants par famille y chute actuellement de façon brutale, semblant vouloir rejoindre les bas taux de fécondité des pays industrialisés.
Contrairement aux idées reçues sur une prétendue surpopulation propagées par le Club de Rome depuis les années 60, nous sommes ainsi menacés de sous-population (Encadré 11). Conjugué au déclin général de la natalité, l’avancement en âge provoque un vieillissement de la population du globe. Ces deux problèmes existentiels de l’humanité - renouvellement et vieillissement - ne pourront donc être résolus que par une augmentation drastique du développement économique et du niveau de vie pour tous, intégrant une politique de santé publique définie par les progrès scientifiques et technologiques résultant de ce développement.
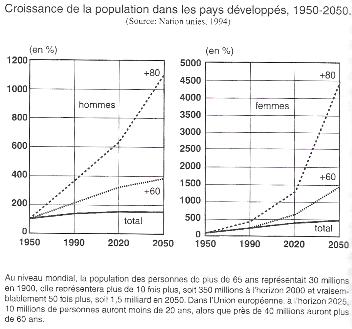
Au niveau mondial, la population des personnes de plus de 65 ans représentait 30 millions en 1900, elle représentera plus de 10 fois plus, soit 350 millions à l’horizon 2000 et vraisemblablement 50 fois plus, soit 1,5 milliard en 2050. Dans l’Union européenne, à l’horizon 2025, 10 millions de personnes auront moins de 20 ans, alors que près de 40 millions auront plus de 60 ans.
Encadré 11 :
Partie d’Europe, la révolution démographique atteint les pays du Sud.
Les gains significatifs en longévité dans les pays développés remontent à trois siècles environ. L’augmentation régulière du niveau de vie et une meilleure alimentation ont préparé le terrain. Le coup de fouet a été donné à la fin du XIXe siècle par les percées dans les domaines de l’hygiène et de l’asepsie et surtout par le formidable bond en avant fait grâce à Pasteur et aux pasteuriens dans la lutte contre les maladies infectieuses. A partir de là, le développement économique va diffuser et prolonger ces découvertes à grande échelle, notamment par la mise en place de politiques de santé publique.
C’est en gagnant sur la mortalité infantile, très élevée il y a un siècle, que l’on a le plus gagné en espérance de vie. Selon Jacques Vallin, directeur de recherche à l’INED Paris :
En France, le taux de mortalité infantile est tombé de trois cents pour mille au milieu du XVIIIe siècle, à cinquante pour mille vers 1950 et à moins de six pour mille aujourd’hui.
Les prémisses d’une deuxième révolution, celle du vieillissement, sont apparues dans les années 60. Depuis cette époque, l’augmentation de l’espérance de vie est due plus à la baisse de la mortalité aux grands âges qu’à la baisse de la mortalité infantile.
Le facteur de loin le plus important dans l’explosion actuelle de la population centenaire est ainsi le déclin de la mortalité après l’âge de 80 ans.
En haut de la pyramide des âges, le nombre de centenaires augmente à une vitesse exceptionnelle d’environ 8% par an. Cette nouvelle phase de progrès s’est affirmée avec les succès majeurs rencontrés dans la prévention et le traitement des nouvelles maladies du XXe siècle (cancers, artériosclérose, ostéoporose, maladies dégénératives).
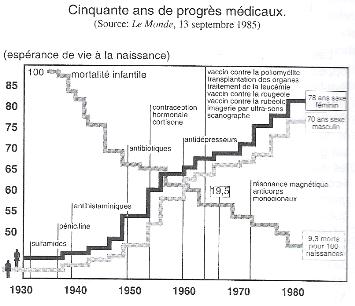
Avant la transition démographique des pays développés amorcée au XVIIIe siècle, le nombre d’enfants mis au monde par famille était très élevé, pour compenser la mortalité infantile et éloigner le spectre de la pauvreté. Au fur et à mesure des progrès médicaux, les taux de mortalité ont baissé alors que les taux de natalité étaient encore élevés. D’où la relative explosion démographique de la France par exemple durant les deux derniers siècles.
Ce même phénomène s’est révélé d’une façon spectaculaire depuis les années 60 dans les pays du tiers-monde, où la transition démographique a été bien plus brutale, explique Jacques Valin.
S’il y a eu « explosion » dans ces pays, c’est parce que la baisse de la mortalité a commencé beaucoup plus tardivement : « Amorcée au début du siècle dans quelques pays d’Amérique latine et d’Asie, elle s’est surtout généralisée après la Seconde Guerre mondiale. S’appuyant sur des techniques efficaces mises au point en Europe après des siècles de balbutiements, le progrès sanitaire a été, dans ces pays, extrêmement rapide.
En vingt ou trente ans, le Mexique et la Chine ont gagné autant d’années d’espérance de vie que la Suède ou la France en cent cinquante ans. Tout comme, en cette seconde moitié du XXe siècle, l’explosion du tiers monde correspond à l’expansion démographique européenne du XIXe siècle, au vieillissement en douceur des populations du Nord va correspondre, au début du siècle prochain, un vieillissement accéléré de celles du Sud ».
En Chine, la croissance de la population âgée est amplifiée par la politique d’un enfant par famille.
Trois chercheurs ont étudié la croissance de la population très âgée en Chine, extrapolée à l’an 2050. Dans le scénario à faible mortalité, les sujets âgés de 65 ans et plus en Chine passeront de 63 millions en 1990 à plus de 400 millions en 2050, soit une multiplication par six.
Pour les sujets âgés de 85 ans et plus : ces chercheurs estiment que leur nombre passera de 2,3 millions en 1990 à plus de 80 millions en 2050, ce qui est une incroyable explosion (multiplication par trente six).
Ainsi, au milieu du prochain siècle, la population des sujets très âgés en Chine dépassera probablement la population totale de l’Allemagne, même en se bornant à extrapoler et donc sans prendre en compte de nouveaux progrès scientifiques ou une diffusion plus rapide de ceux qui existent déjà !
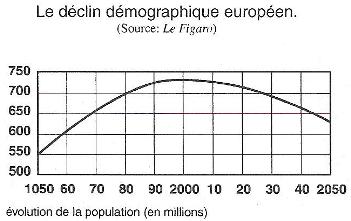
Encadré 12 :
pour mieux vivre, apprenons l’histoire
Le niveau de vie relativement élevé atteint dans les pays développés et l’allongement de la vie qui en résulte, est le fruit d’un long combat pour sortir de l’esclavage et de la barbarie. Le combat des cités grecques contre l’empire perse en a été l’un des épisodes les plus marquants. Il doit inspirer celui que nous devons livrer aujourd’hui contre l’oligarchie financière.
La civilisation grecque à laquelle nous sommes tant redevables est pour ainsi dire née de la résistance à l’oppression de la Perse et de Babylone.
Les Perses payaient des mercenaires ou employaient des quasi-esclaves pour combattre. Quand Athènes s’est trouvée en péril lors des batailles de Marathon et de Salamine, le citoyen grec éduqué par Homère, Eschyle ou Solon avait conscience de défendre une civilisation qui, pour la première fois, donnait à l’individu une liberté et en même temps une responsabilité morale dans l’histoire.
Du combat anti-oligarchique est née l’idée de République (*), apparue pour la première fois dans la Grèce classique. La République de Platon, quelles que soient par ailleurs ses limites dues aux conditions de l’époque, pose les grandes lignes d’un gouvernement pour le bien commun, transcendant les intérêts individuels et favorisant le développement de tous et de chacun.
L’histoire contribue ainsi puissamment, à travers les exemples qu’elle donne, à la formation du caractère et à l’identité du citoyen de la République.
Hélas, l’élève qui subit à l’école les nouveaux cours d’histoire ne peut en tirer aucun enseignement pour la société ni pour lui-même. Confronté à une succession de dates et d’événements sans cohérence, présentés de manière faussement objective, il ne peut situer l’empire financier d’aujourd’hui par rapport aux grands empires oligarchiques de l’histoire, qu’ils soient géographiques (Babylone, l’empire perse et l’empire romain) ou commerciaux (empire vénitien et empire britannique).
La plupart des traités d’histoire atténuent quand ils ne gomment pas la lutte entre les empires et leurs opposants républicains. D’après l’historien Tony Papert :
Ce que nous appelons aujourd’hui archéologie, paléontologie et études classiques (…) a été concocté à partir des universités de Cambridge et d’Oxford, certainement dès le XVIIe siècle et peut-être même avant. Tout ce que vous considérez comme des faits indiscutables à propos de l’archéologie classique et des événements qui lui sont reliés en préhistoire constituent très largement des montages complètement arbitraires, que pratiquement rien ne vient étayer.
Pour assurer un avenir à l’humanité, il faut d’urgence réhabiliter un enseignement de l’histoire débarrassé du poids de la vulgate oligarchique.
La longévité, artefact de la civilisation
Selon le chercheur André-Pierre Contandriopoulos (**), la santé mesurée par l’espérance de vie est plus fortement influencée par l’ensemble de l’organisation sociale (conditions de vie et position sociale des individus) que par des politiques spécifiques de santé ou par tel ou tel système de soins.
D’une façon générale, la longévité est selon l’expression de James Vaupel, un « artefact de la civilisation ».
Notre civilisation judéo-chrétienne est l’héritière de la civilisation de la Grèce classique dans le domaine de la longévité. Selon Mirko Grmek (***), « la durée moyenne de la vie atteint alors des sommets qu’elle ne retrouvera qu’au XX siècle ».
Les obligations militaires s’y étendent jusqu’à 60 ans, la position d’arbitre public à Athènes est, elle, réservée aux sexagénaires. Quand Socrate est condamné à boire la ciguë, à 70 ou 71 ans, il est considéré comme un homme sage, mais pas un vieillard. Sophocle a écrit sa dernière pièce à 82 ans, il est mort à 90 ans. Platon a vécu jusqu’à 81 ans, Hippocrate, le père de la médecine, est mort entre 90 et 100 ans. Archimède disparaît à 75 ans, Pythagore à 80 ans.
Notes :
(*) « Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » disait Abraham Lincoln.
(**) Professeur à la faculté de médecine de l’université de Montréal, Québec, Canada.
(***) Mirko Grmek et Danielle Gourevitch, Les Maladies dans l’art antique, Fayard, 1998.
II. Le défi scientifique et technologique contre le tout-génétique, la science et les technologies permettent de maîtriser le domaine du « vivant »
1. Les limites de la thérapie génique
Les trente dernières années ont vu un perfectionnement constant des technologies existantes. Mais du point de vue de la compréhension fondamentale des mécanismes vivants, on en est resté aux acquis des années 50 et 60.
Comme dans la plupart des pays occidentaux, la recherche médicale française souffre d’une affectation déséquilibrée des fonds en faveur de la génétique et de la priorité donnée au niveau international au projet de génome humain (PGH).
Le PGH, lancé dans les années 80 par les chercheurs rassemblant des centres de recherche publics japonais, américains et britanniques, vise à découvrir tous les gènes constituant le génome humain (encadré 13). Il donne lieu actuellement à une course effrénée opposant des sociétés privées, qui veulent privatiser et breveter chaque gène qu’elles découvrent, à des organismes publics. Il est à craindre que cet inventaire complet, même s’il a des côtés indéniablement utiles, ne soit à la médecine ce qu’est la quadrature du cercle à la géométrie. Plus on trouve de pièces dans le mécano génique, moins on est capable de dire comment tout cela constitue un être qui vit... et qui pense.
Encadré 13 :
ADN, génome et génétique
Dans son noyau, chacune de nos cellules comporte quarante six chromosomes composés de molécules d’ADN (acide désoxyribonucléique), constituant les gènes, qui déterminent les caractères héréditaires. Le génome, c’est l’ensemble de l’information génétique. Les vingt trois paires de chromosomes portent chacune des gènes spécifiques. L’homme posséderait entre 60 000 et 100 000 gènes différents, chacun étant un code héréditairement transmis et participant à la synthèse d’une protéine, qui correspond à un caractère déterminé. Les gènes contiendraient ainsi des « instructions » permettant à l’organisme de fonctionner.
On connaît aujourd’hui, chez l’homme, quelques centaines de gènes dont les anomalies sont responsables de maladies telles que le cancer, l’obésité, le diabète, l’hypertension, dont certaines formes sont héréditaires. L’ADN, considéré comme le vecteur de l’information génétique, a été évoqué pour la première fois en mai 1943 par le professeur américain C.T. Avery. Il fallut ensuite une quinzaine d’années de travaux en virologie et biochimie pour que l’ADN engendre l’essor de la génétique.
De fait, on sait de mieux en mieux découvrir et qualifier les gènes et leurs propriétés, mais cette nouvelle connaissance reste aujourd’hui relativement stérile, car il y a peu d’applications thérapeutiques.
Distinguons tout d’abord la thérapie génique de la thérapie génomique.
La thérapie génique - qui nous allons le voir n’existe pas encore - consiste en une intervention sur les gènes de cellules montrant une prédisposition génétique à la maladie, en les réparant ou en y introduisant un gène de remplacement, sans anomalie, ou bien un gène supplémentaire, à l’effet bénéfique. L’ADN peut être transféré ex vivo en laboratoire, dans une cellule qui est ensuite administrée au patient, ou in vivo directement dans une cellule du patient. Le transfert des gènes dans les cellules humaines est réalisé par l’utilisation de vecteurs qui peuvent être soit des vecteurs viraux (rétrovirus, adénovirus), soit des vecteurs non viraux (lipides, polymères). La thérapie génique peut être assimilée à de la chirurgie moléculaire.
Avec la thérapie génomique, il s’agit de profiter de la connaissance annoncée de tous les gènes pour analyser finement les processus pathologiques et découvrir des cibles nouvelles pour des médicaments nouveaux.
Si l’industrie pharmaceutique a vite vu dans la thérapie génomique un domaine d’avenir pour la mise au point de nouveaux médicaments, la thérapie génique demeure, elle, toute théorique.
En réclamant moins de triomphalisme et plus de biologie (« less hype, more biology »), le Pr Jean-Claude Kaplan et Claudine Julien affirment dans un rapport de l’Académie des sciences [16] que « l’engouement initial (pour la thérapie génique) s’est manifesté par la mise en œuvre de moyens de plus en plus considérables (...) avec d’énormes investissements financiers. (...) Pour autant, aucun résultat décisif ne permettait d’afficher le moindre triomphalisme.
En 1995, le rapport d’un comité d’experts mandatés par H. Varmus, directeur du NIH (Institut national de la santé, aux Etats-Unis) faisait l’effet d’une bombe en remettant les pendules à l’heure par ses conclusions : la thérapie génique avait jusqu’à présent donné lieu à trop de surexcitation et pas assez de bonne science. Ce rapport soulignait que les multiples obstacles avaient été sous-estimés, et qu’il était grand temps de les attaquer par une recherche fondamentale sérieuse plutôt que de multiplier des essais thérapeutiques à faible valeur scientifique, mais à très grand retentissement. En somme, tout s’était passé comme si l’action avait précédé la réflexion ».
Avec la biologie moléculaire, le génie génétique prétend tout expliquer par la cellule. Or, quand on étudie la croissance des tissus vivants, il apparaît que chacune des cellules répond à un ordonnancement supérieur, ce que Gurwitch appelle le « champ biologique ».
Quand l’embryon se forme par exemple, les cellules s’agencent mutuellement pour former différents organes, ici l’oreille, là la main. Ces « instructions » ne viennent pas du programme génétique de la cellule.
Le gène parle une langue purement cellulaire alors que le « caractère » de l’oreille ou de la main est réalisé à un niveau supra-cellulaire. Les gènes localisés dans chacune des cellules ne sont pas capables par eux-mêmes de guider l’action générale qui transforme un amas de cellules vivantes en organe bien caractéristique. L’approche exclusivement par la biologie moléculaire et le génie génétique est donc absolument réductrice. En biologie comme en économie, le tout n’est pas égal à la somme des parties. Le corps humain n’est pas un empilement de cellules autonomes.
De fait, les conséquences de la suppression ou de la neutralisation d’un gène associé à une maladie sont inconnues. Cela peut aussi bien faire apparaître d’autres problèmes et modifier dans le mauvais sens le patrimoine héréditaire.
Certes le progrès se fait par expérimentations et tâtonnements, mais il arrive un moment où l’expérimentation sans aucune hypothèse laisse la place à la recherche de profits rapides et aux fantasmes qui rappellent l’eugénisme des années 30. On cherchait alors à purifier la race en éliminant les « tarés ». Certains cherchent maintenant à créer dès le départ l’être humain parfait par « ingénierie génétique ». Ils ne sont pas moins dangereux que leurs prédécesseurs.
2. La vraie science des processus vivants
Le processus de vieillissement qui nous amène vers la mort est très mal connu parce que nous ne savons pas ce qu’est la vie. Empêtrées dans la biologie moléculaire, les sciences du vivant patinent. On sait comment en sortir, la voie a été ouverte par Vernadsky et ses élèves en Russie. [17].
La biologie, si l’on en croit les vieux manuels, est « la science de la vie dans le sens le plus large, ou pour être plus exact, la science des processus qui se déroulent dans les organismes vivants ». La tâche majeure de la biologie est donc de découvrir les lois de la vie.
Or la plupart des recherches en biologie, emmenées par les spécialistes de biologie moléculaire, évacuent d’emblée l’étude de la vie et des processus vitaux. La biologie moléculaire considère en effet les organismes vivants comme rien de plus que des machines extrêmement complexes, réduisant la vie à un meccano, « une sorte de grand puzzle, un code à déchiffrer » [18].
La biologie du XXe siècle se base ainsi « sur l’idée qu’il est possible de réduire toutes les manifestations de la vie à des processus gouvernés par les lois de la physique et de la chimie, comme lorsqu’on étudie la nature inorganique ».
Cette approche a certes permis à la biologie moderne « d’enregistrer un succès impressionnant en décodant la structure et en discernant certaines propriétés importantes du substrat matériel des choses vivantes ».
Mais, d’après Voeikov :
Plus on avance dans l’organisation structurelle des objets biologiques, plus il apparaît que cette approche de base ne nous permettra pas d’appréhender les lois qui gouvernent les processus vitaux les plus spécifiques.
En résumé, la biologie moléculaire standard, l’ingénierie génétique [19] et les méthodes de recherche biochimiques et pharmaceutiques étudient analytiquement les composants biologiques et chimiques de la matière vivante mais sont incapables d’appréhender le processus vivant, ce qu’est la vie [20].
L’exemple des recherches sur le sida, qui ont permis voici maintenant plus de quinze années de comprendre l’origine de la maladie mais ont été incapables d’agir sur le processus qui mène à l’infection, résume l’impasse dans laquelle nous sommes.
Fort heureusement d’autres scientifiques, notamment l’école russe de biologie - à partir des travaux de Vladimir Vernadski, Alexandre Gurwitch et Ervin Bauer - pensent, contrairement aux adeptes de la biologie moléculaire, que la distinction entre processus vivants et non-vivants est fondamentalement irréductible.
Selon Vernadski, Gurwitch et Bauer, l’existence et l’évolution des processus vivants sur la terre ne sont pas des phénomènes isolés ou accidentels, mais constituent des expressions cohérentes d’une caractéristique fondamentale de développement de l’Univers comme un tout. Cela contredit au passage toutes les théories sur le vieillissement - ou entropie - inexorable de l’Univers suite au « big-bang » originel.
Les scientifiques russes ont ainsi insisté sur la nature dirigée, au sein d’une biosphère (incluant son substrat géologique et géochimique) marquée par l’activité des organismes vivants, des transformations représentant le travail réalisé par l’agrégat des processus biologiques sur leur environnement. Ces transformations ont mené dans le cours de l’évolution à un accroissement accéléré du rendement énergétique et de la puissance globale de transformation physique du processus vivant pris comme un tout.
Selon Vladimir Voiekov, le développement est ainsi le trait le plus caractéristique des systèmes vivants. Si l’on accepte la formulation de Vernadsky que « les phénomènes de la vie et de la nature inorganique, envisagés du point de vue géologique (c’est-à-dire planétaire), sont les manifestations d’un processus uniforme », il apparaît que le processus de développement - présenté comme « impossible » du point de vue de la physique et de la chimie de la nature inorganique - le processus de transformation de l’inférieur vers le supérieur, de l’uniforme et de l’incohérent vers le différencié mais divisible, constitue le principal processus naturel.
Si cela est vrai, alors, peut-être les « lois de la nature » que l’on apprend à l’école ne sont-elles que des cas particuliers, alors que la loi principale, la loi de l’accroissement progressif de l’organisation, nous ne la comprenons pas encore.
Vernadski va un cran plus loin : il considère l’histoire humaine à la lumière des principes généraux qui gouvernent le développement des systèmes vivants et l’envisage comme une progression légitime de l’histoire naturelle. Dans le cours de l’histoire connue, l’espèce humaine, à travers le développement graduel et l’expansion de son activité sociale productive, a accru son pouvoir global sur la nature à une vitesse accélérée, au point de devenir la force dominante dans la biosphère, affirme-t-il.
Les progrès dans la production et les progrès analogues dans l’organisation sociale, qui ont permis cette croissance de la puissance d’action physique, découlent des pouvoirs créatifs des esprits humains individuels à même de faire des découvertes de principes dans la science ou des domaines analogues, et de les appliquer à la pratique humaine sociale.
L’émergence de l’humanité est ainsi un nouveau bond dans le processus intégral du développement de notre planète. Avec l’humanité émerge une nouvelle forme d’énergie, l’énergie de la culture humaine, apportée par le développement de la raison humaine.
Pour cette raison, Vernadski parle de noosphère - une biosphère qui évolue sous la direction consciente de la raison humaine - et de la raison humaine en elle-même comme force planétaire (et dans le futur, interplanétaire).
A ce stade, pense Voeikov :
La compréhension de la primauté du phénomène de la vie permettra à l’Homme de distinguer un vecteur constant de développement qui mène vers une toujours plus grande cohérence de l’Univers, au sein de la complexité immense des corps et des processus naturels. Si l’on arrive à faire des progrès dans cette direction, cela donnera à l’être humain une nouvelle chance de ressentir qu’il est une part inséparable - et en même temps, la part la plus unique - de cet univers continuellement émergent, et que sans sa coopération, son développement sera retardé.
Dans l’équipe russe, les travaux de Gurwitch ont porté sur la faculté des tissus vivants à utiliser l’énergie présente dans leur environnement, notamment sous forme électromagnétique et à émettre eux-mêmes différentes radiations. L’une des caractéristiques des cellules vivantes est d’augmenter leur stock d’énergie libre durant leur développement, un stock qui permet notamment la division cellulaire et assure la reproduction de la vie.
Le champ biologique dans lequel évoluent les cellules vivantes est à la fois acoustique, thermique, chimique, mécanique et électromagnétique. Les cellules vivantes communiquent entre elles, entre autres par rayonnement électromagnétique, sans aucun contact physique ou chimique.
Cette faculté de transformation énergétique semble avoir considérablement augmenté au cours de l’évolution. Selon les données physiologiques, la consommation d’énergie en relation à la masse vivante durant la période du cycle de vie augmente dans une proportion de plusieurs milliers dans la séquence qui part des Coelenterates primitifs et se termine aux Primates. Pour l’Homo Sapiens, ce paramètre est plus élevé d’au moins un ordre de grandeur par rapport aux Primates.
Au sein même de l’histoire humaine, la consommation énergétique totale de l’humanité et la transformation de l’énergie externe dans une énergie libre dite « structurelle », utilisée pour réaliser toutes sortes de travaux, augmentent ainsi sans aucun doute au fur et à mesure des progrès accomplis.
Tous ces travaux, qui rejoignent dans le domaine de la biologie les percées de Lyndon LaRouche dans le domaine de l’économie, restent pour l’instant pour ainsi dire confidentiels en dehors de la Russie et de quelques scientifiques considérés comme des marginaux par la toute puissante caste des adeptes de la biologie moléculaire. Il n’en reste pas moins que les prochaines avancées de la médecine et les percées dans l’espérance de vie seront conditionnées par leur développement à grande échelle, car il s’agit là d’un domaine de formation d’hypothèses et non de déduction mécaniste.
Encadré 14 :
Pour une recherche publique aux frontières
La ligne de front de la lutte contre les pandémies, surtout le sida, se situe dans les pays du Sud, l’Afrique venant en tête (70% des cas de sida actuellement). Dans plusieurs pays d’Afrique sub-saharienne, plus de la moitié de la population active est séropositive. L’initiative de défense biologique que nous proposons vise bien sûr l’Afrique, mais l’Europe n’est pas moins concernée. Comme le précise le Pr Jean-Claude Chermann, codécouvreur du virus HIV :
Nous ne pouvons pas laisser s’instaurer [en Afrique] un bouillon de culture dans lequel se développera inévitablement un virus qui change, qui mute et qui nous reviendra plus tard sous une forme plus dangereuse, par exemple avec un autre mode de transmission. Nous sommes donc condamnés à traiter ce problème sur toute la planète.
Dans un tel contexte d’urgence en santé publique, la recherche doit d’abord être publique. Il faut par exemple redonner à l’Institut Pasteur, déjà financé aux deux tiers par des fonds privés (et actuellement à la recherche de nouveaux partenaires industriels pour compenser la baisse attendue de son budget), les coudées franches pour une recherche fondamentale dans l’intérêt de tous.
Cela veut dire aussi retrouver l’esprit de Pasteur, Calmette ou Jamot, dont la devise était « aller partout et voir tout le monde ». Le médecin-général Lapeyssonnie, ancien médecin colonial qui a fait sienne la méthode de Jamot dans les années d’après-guerre l’évoque en ces termes :
On partait alors en brousse dix ou douze mois par an avec des équipes armées de vingt ou trente microscopes.
Âgé aujourd’hui de 85 ans, il martèle :
Le désastre sanitaire que l’on observe depuis plus de dix ans en Afrique, c’est tout simplement le résultat de vingt-cinq ans d’abandon de la méthode Jamot. Quand les Africains doivent marcher pendant quatre jours pour arriver au dispensaire le plus proche, comment voulez-vous qu’ils se soignent ? Qu’est-ce-qu’on fait ?
On décide de les laisser crever dans la brousse ? C’est bien ce qui se passe aujourd’hui pour la trypanosomiase (*). Cette affection est bel et bien une maladie administrative !
Note :
* La trypanosomiase ou maladie du sommeil menace environ 55 millions de personnes dans trente-six pays africains au sud du Sahara, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au Congo, dans de nombreux villages la trypanosomiase atteint plus d’une personne sur deux et la maladie du sommeil y est la première cause de mortalité.
3. Les applications possibles de la biophysique optique
Nous sommes juste au début de l’étude des processus biologiques fondamentaux, au moyen de ce qu’on appelle la biophysique optique. Cette discipline peut ouvrir un monde de nouvelles découvertes dans les domaines de base de la connaissance où la biologie, la physique et la chimie se recoupent.
La biophysique optique, appelée parfois spectroscopie biologique non linéaire, est l’étude de l’interaction des substances vivantes avec le rayonnement lumineux, bien au-delà de la bande étroite de la lumière visible. Le champ de recherche de la biophysique optique s’étend sur tout le spectre des radiations électromagnétiques, des ondes radio longues jusqu’aux ondes très courtes au-delà des rayons X, dans la région spectrale des rayons X mous et des rayons gamma.
C’est Louis Pasteur qui le premier a examiné d’une façon systématique la relation entre l’activité optique et la substance vivante.
Aujourd’hui, l’un des domaines prioritaires est la fabrication d’instruments scientifiques pour la recherche fondamentale.
C’est au biophysicien russe Alexandre G. Gurwitch, évoqué plus haut, que l’on doit l’une des premières expériences réalisées en 1922, d’où naquirent les premières hypothèses sur les émissions lumineuses des plantes. Gurwitch observa un accroissement significatif de la division cellulaire dans une racine d’oignon lorsque l’on plaçait une seconde racine d’oignon à proximité. Il en conclut que seule une émission de lumière ultraviolette pouvait être à l’origine de cet accroissement, car on pouvait arrêter cet effet accélérateur de la division cellulaire (ou mitose) en plaçant entre les racines une vitre ordinaire arrêtant les rayonnements UV, contrairement au verre de quartz qui les laisse passer.
Gurwitch s’intéressait donc au processus de développement de la matière vivante, à commencer par la division cellulaire, et à la façon dont ce processus change.
Les mêmes hypothèses ont été reprises après la guerre par des scientifiques comme le Dr Fritz Popp, physicien et biologiste de l’université de Kaiserslautern, et le Pr Genzel de l’Institut Max Planck de physique des solides (Allemagne) [21].
Ce n’est que bien après la Seconde Guerre mondiale que furent mis au point des photomètres suffisamment précis pour détecter les émissions lumineuses extrêmement faibles des tissus végétaux et animaux.
Diverses expériences furent menées sur des semences végétales, en particulier en Russie et en Italie.
Les Russes notamment ont établi que des micro-ondes de faible intensité à des fréquences spécifiques, dans le domaine des ondes millimétriques, pouvaient multiplier par un facteur de dix la division cellulaire, pourvu qu’un seuil minimal soit atteint. Ces découvertes permirent une première compréhension approximative des effets de résonance dans la matière vivante : certaines micro-ondes incitent les molécules cellulaires à accroître leur vibration interne spécifique (résonance) et augmentent leur capacité de travail biologique.
Si les tissus vivants sont sensibles à certains rayonnements, ils émettent eux-mêmes des rayonnements. Dans les cellules vivantes, cela prend la forme d’un flux régulier de photons. Dans différentes expériences où il inoculait un virus dans une cellule saine, Popp a constaté un brusque changement quand le virus entre dans la cellule : cela donne lieu à une série de « bouffées de rayonnements » bien plus intenses qui vont en s’espaçant jusqu’à la mort de la cellule.
Ainsi, la naissance (division cellulaire) comme la mort des cellules se traduisent ou sont influencés par des phénomènes électromagnétiques caractéristiques.
On mesure tout de suite l’intérêt de ces découvertes à la fois pour le diagnostic de certaines maladies, voire pour leur traitement.
Ainsi, grâce à la résonance magnétique nucléaire (RMN), une tumeur cancéreuse peut être clairement différenciée d’un tissu normal. Dans la RMN, de puissants champs magnétiques alignent les spins des noyaux d’hydrogène (protons) de l’eau et des autres substances présentes dans les cellules, et l’on peut mesurer une oscillation caractéristique de ces protons lorsque l’on soumet ces tissus à des radiofréquences. Un scientifique américain (James Frazer) a ainsi découvert que les tissus tumoraux absorbent et émettent les signaux radio à des fréquences et des vitesses légèrement différentes des tissus normaux.
La capacité de stocker des photons et de les réémettre de façon cohérente s’avère être l’une des pré-conditions premières des processus vivants. Il existe ainsi un champ photonique biologique. Pour se déclencher, les réactions métaboliques nécessitent un flux hautement concentré de photons qui fournissent l’énergie d’activation de ces réactions exactement à l’endroit et au moment requis.
Dans ce processus de travail, les molécules d’ADN et de chlorophylle semblent jouer un rôle central. De nombreux chercheurs ont en effet constaté que ces molécules sont capables de décaler les fréquences vers le haut de plusieurs ordres de grandeur.
L’ADN, avec ses propriétés géométriques exceptionnelles, est au centre des recherches sur les processus de la vie. Les deux brins de l’ADN enroulés en hélice sont eux-mêmes entourés d’autres super et super-super hélices. Si l’on déroulait cette structure, l’ADN d’une seule cellule constituerait un fil d’approximativement deux mètres de long. Et l’ADN du corps humain, mis bout à bout, atteindrait une longueur équivalant au diamètre du système solaire, environ 10 milliards de kilomètres.
L’arrangement hélicoïdal de l’ADN et ses proportions géométriques lui donnent le potentiel de médire l’action électromagnétique cohérente dans le travail biologique. L’un des rôles joués par l’ADN est de « stocker » les photons et de les mettre à la disposition de l’organisme quand et là où il le faut.
L’efficacité des rayonnements semble être liée à leur spectre. En effet, telle action biologique sera déclenchée par tel rayonnement dans tel spectre très étroit. Les papillons de nuit par exemple sont attirés par les substances qui émettent des ondes électromagnétiques dans une étroite bande spectrale de l’infrarouge (c’est le cas d’une lumière de bougie, ou des sécrétions hormonales externes de certains insectes). Tout se passe comme si l’organisme du papillon était capable de percevoir les ondes électromagnétiques cohérentes et de les transformer en travail actif. On a découvert sur leurs antennes des « censeurs » qui fonctionnent comme un instrument de réception pour les étroites bandes de fréquences émises par les phéromones produites par les insectes femelles.
4. les armes de la nouvelle révolution médicale
La lutte contre le sida et autres pandémies qui ont tendance à resurgir actuellement nécessite une véritable initiative de défense biologique à l’échelle internationale. Nous parlons d’un effort comparable au programme Apollo qui envoya un homme sur la Lune, visant notamment à percer les secrets de la division cellulaire normale et de ses formes pathologiques ; c’est le phénomène le plus complexe qui ait jamais été soumis à une analyse physique détaillée. Cet effort commence par la mise au point d’appareils permettant de visualiser en direct les manifestations de la vie à l’échelle de la cellule, notamment par des sortes de « caméras-microscopes ».
Les progrès de l’optique au XVIIe siècle ont mené à l’invention du microscope optique et aux premières observations et recherches sur la vie microbienne. L’évolution actuelle des lasers et d’autres sources de rayonnement électromagnétique cohérent sur une vaste bande du spectre ont permis de développer les instruments brièvement décrits ici, qui sont en mesure de révolutionner la médecine et la biologie dans les vingt-cinq ans à venir. Tous mesurent les caractéristiques d’émission, d’absorption ou de transformation des rayonnements électromagnétiques par des organismes vivants.
La spectroscopie à effet Raman
Avec la mise au point de la spectroscopie laser à effet Raman, nous sommes en possession d’un instrument avec lequel les oscillations internes à hautes fréquences des cellules peuvent être étudiées de façon pratique et au fur et à mesure de l’évolution éventuelle du phénomène.
Dans ce type de spectroscopie, un faisceau laser échange de l’énergie avec les vibrations moléculaires de l’échantillon examiné, provoquant des changements dans la fréquence de la lumière diffusée (effet Raman). Le spectre Raman des cellules vivantes diffère totalement de celui observé avec des cristaux ou des suspensions ou solutions de molécules organiques.
La recherche fondamentale en médecine a à peine commencé à tirer parti des promesses de la spectroscopie Raman in vivo. L’élément le plus important est que cette méthode (de même que celles de la diffusion lumineuse multiparamétrique, de l’émission photonique ultra faible et de la résonance magnétique nucléaire étudiées ci-après) nous permet d’observer directement les caractéristiques spatio-temporelles de l’organisme vivant.
Les radiographies ou images ordinaires à l’échelle microscopique (micrographies) tendent à ne relever que la distribution de « structures » qui résultent de l’activité vivante, mais laissent de côté le processus vivant en tant que tel.
Les oscillations révélées par la spectroscopie Raman ne semblent pas provenir de molécules isolées, ce sont plutôt la manifestation d’ondes cohérentes liant les composants cellulaires dans un processus unifié.
La diffusion lumineuse multiparamétrique (DLM)
Quand nous regardons un spécimen sous un microscope, l’image que nous voyons se compose de régions claires et sombres correspondant à la façon dont les diverses régions de l’échantillon absorbent la lumière ordinaire. Mais l’image microscopique représente seulement un petit aspect des phénomènes complexes qui régissent la façon dont la lumière est absorbée, réémise et diffusée par le spécimen. Les instruments de diffusion lumineuse multiparamétrique observent la totalité de la lumière diffusée dans toutes les directions par un échantillon donné, en fonction de la longueur d’onde de la source lumineuse (un laser), de l’angle de diffusion et du degré de polarisation à droite ou à gauche de la lumière incidente portant sur l’échantillon. Plutôt que de donner une image photographique, la technique DLM produit une « signature » caractéristique qui peut être utilisée pour identifier en quelques minutes des micro-organismes et des virus dans des fluides biologiques. Cette technique permet même de différencier des variétés très proches de virus, que l’on ne peut distinguer autrement que par de laborieuses techniques de culture et de génie génétique.
En principe, l’ensemble des informations contenues dans la lumière diffusée contient suffisamment de données pour discriminer entre des milliers de microbes différents, même quand plusieurs d’entre eux sont présents simultanément dans un échantillon donné. En outre, on pourrait associer la DLM à ce qu’on appelle un cytomètre à flux (où l’échantillon liquide passe dans un fin tube de verre ou de quartz, au lieu de se trouver dans une cuvette), permettant d’examiner successivement les cellules de différents types passant devant le faisceau laser. Ceci ouvrirait une révolution dans la médecine clinique : idéalement, un instrument DLM automatique transmettrait des données à un puissant ordinateur conservant en mémoire une banque de « signatures » de tous les virus et bactéries ayant un intérêt clinique. En quelques minutes, le médecin pourrait obtenir un « inventaire » détaillé de tous les microbes contenus dans le sang d’un patient, avec leurs concentrations respectives ! Comparez cela aux heures et aux jours de travail de laboratoire souvent nécessaires aujourd’hui pour diagnostiquer la maladie dont souffre le patient.
Photoémission ultra faible des cellules vivantes
Comme nous l’avons dit plus haut, la découverte de l’émission lumineuse ultra faible des tissus vivants et la compréhension graduelle de son importance biologique doivent être classées parmi les découvertes biologiques les plus sensationnelles de ce siècle.
L’application la plus immédiate de cette technique de détection photonique ultra faible (EPU) est la mesure des effets potentiellement toxiques de diverses substances. Quand des quantités même minuscules d’une substance toxique sont déposées sur une culture cellulaire, on enregistre une rapide « bouffée » de photoémission, indiquant une perturbation de la configuration de « moindre action » normale du système vivant. Il y a là de nombreuses applications potentielles dans l’étude sur la pollution, dans les recherches en pharmatoxologie, dans la médecine légale et la défense.
Mais ces applications pratiques ne sont que peu de choses à côté des implications dans la recherche fondamentale. Bien que la quantité totale d’énergie mesurée au capteur photonique soit très faible, le débit de fluence énergétique du rayonnement à l’intérieur de la cellule peut être très élevé. Par rapport aux événements au niveau microscopique moléculaire, un simple photon ultraviolet constitue l’équivalent d’un obus d’artillerie lourde. Un seul photon ultraviolet suffit à fracturer une puissante liaison chimique, à activer un enzyme ou à faire subir à un électron une longue chaîne de transformation. Des expériences du spectroscopiste soviétique Prokhorov montrent qu’un photon ultraviolet unique suffit, dans certaines conditions, à déclencher la division cellulaire.
L’EPU d’un tissu normal dérive d’un champ cohérent « couplant » les activités de milliers ou de millions de cellules via des interactions électromagnétiques à distance. Dans un tissu normal, le flux photonique réel est bien plus intense que le résidu mesuré à l’extérieur.
Les éléments rassemblés par le scientifique Popp et d’autres semblent indiquer que l’ADN contenu dans le noyau cellulaire joue un rôle central dans l’émission photonique observée. Ceci pourrait expliquer une anomalie qui embarrasse beaucoup les biologistes moléculaires : plus de 95% de l’ADN des cellules humaines, animales et végétales n’ont aucune fonction de « codage » dans la synthèse protéinique. Plutôt que d’accepter que les cellules vivantes ne fonctionnent pas à la façon de l’ordinateur digital que certains s’imaginent y voir, des biologistes moléculaires dogmatiques comme Crick tiennent absolument à diffamer ces 95% de matériel génétique en les taxant « d’ADN parasite » ou même de « junk DNA » ( « ADN rebut »).
Ce sont plutôt les dogmes de la biologie moléculaire qu’il faudrait mettre au rebut. Popp propose une hypothèse bien plus séduisante : des expériences et des calculs montrent que la molécule d’ADN peut fonctionner comme un laser microscopique idéal, stockant de l’énergie dans un réservoir à valve et la réémettant de nouveau en bouffées cohérentes de longueurs d’onde plus courtes. Contrairement à la plupart des lasers techniques qui fonctionnent seulement sur une ou quelques longueurs d’onde, l’ADN fonctionne comme un laser multimodal, émettant peut-être des milliers de fréquences différentes et régulant, via l’absorption résonante de fréquences spécifiques par des processus cellulaires spécifiques, tout le complexe de l’activité métabolique du tissu.
Spectroscopie, tomographie et microscopie en résonance magnétique nucléaire in vivo
Des travaux visent à mettre au point l’équivalent microscopique du tomographe RMN (Encadré 15) ; un tel outil serait en mesure de « disséquer » in vivo une cellule vivante, peut-être même à l’intérieur du corps du patient. De concert avec le microscope à rayons X et l’holographie à rayons X (voir plus bas), ces micrographies RMN révolutionneront totalement notre connaissance de l’organisation tridimensionnelle des organismes vivants.
Microscopie et holographie à rayons X
L’un des problèmes les plus évidents de la recherche virologique est que personne n’a jamais vu un virus au cours du processus d’infection d’une cellule ou pendant sa réplication à l’intérieur de la cellule vivante. On ne peut voir les virus qu’avec un microscope électronique. Mais pour observer du matériel biologique avec un microscope électronique, il faut d’abord fixer l’échantillon à observer (c’est-à-dire le tuer), le découper en tranches extrêmement fines et le revêtir de métal. Aussi, les photographies représentant des virus du sida « bourgeonnant » d’une cellule, sont des prises de vue de cellules mortes.
Ce dont nous avons réellement besoin pour la recherche, c’est du film des phénomènes ayant lieu dans la cellule, pris avec un pouvoir de résolution suffisant pour visualiser les virions. C’est exactement ce qui devient possible avec la mise au point de la microscopie en rayons X et l’holographie.
Quels sont les obstacles à la mise au point d’un microscope à rayons X permettant de filmer les processus de la cellule vivante ? L’utilisation de rayons X interdit d’utiliser des optiques de verre comme dans le microscope optique ordinaire. Il faut utiliser des lentilles métalliques ayant un effet analogue au verre sur la lumière visible. L’hologramme X va plus loin encore. Il permet d’obtenir littéralement une image tridimensionnelle. Avec un hologramme X, nous serons capables d’étudier les modifications de la géométrie de l’ADN de cellules vivantes pendant les diverses phases de la division cellulaire ou de la réplication des virus.
Encadré 15 :
la résonance magnétique nucléaire (RMN)
Issue de recherches sur les radars menées pendant la Seconde Guerre mondiale, la technique de résonance magnétique nucléaire (RMN) est l’instrument de diagnostic in vivo par excellence n’exigeant ni hospitalisation ni geste compliqué. Les résonances des noyaux situés profondément à l’intérieur d’un organisme vivant - un être humain par exemple - peuvent être excitées et mesurées entièrement par un système de bobines magnétiques se trouvant à l’extérieur du sujet d’expérience.
Ainsi, la RMN a donné à la médecine la technologie de diagnostic clinique la plus révolutionnaire depuis les rayons X : le tomographe RMN. Dans l’une des formes de cet instrument, le patient est placé à l’intérieur d’une puissante bobine magnétique supraconductrice munie d’une série de bobines auxiliaires. Dans ce tomographe « corps entier », les résonances des noyaux de l’ensemble du corps sont mesurées en fonction d’un champ électromagnétique « structuré » variable, et l’ensemble de l’information recueillie est emmagasinée dans un ordinateur de forte capacité. Le patient peut retourner chez lui, tandis que les médecins ou chercheurs, opérant sur leur console, demandent à l’ordinateur de reconstruire l’image de n’importe quelle « coupe » désirée du corps du patient.
(Les grands domaines d’application de la RMN ou IRM sont la tête, le cerveau, la colonne vertébrale, les articulations, le cœur, le foie et les voies biliaires, l’appareil urinaire.)
III. Le défi économique et social : revenir à l’esprit des « trente glorieuses »
L’allongement de la vie s’accompagne d’une amélioration de l’état de santé mais aussi d’une augmentation du nombre de maladies et donc de besoins accrus en matière de prévention et de soins médicaux. Avec l’amélioration des conditions de vie, nous désirons aussi obtenir des soins plus accessibles, plus efficaces, plus confortables. Ces progrès nécessitent un système de protection sociale encore plus performant que celui légué par la Libération.
1. Augmenter le niveau de protection sociale
Plus un pays est riche et développé, plus il investit par tête en montants absolus pour sa protection sociale. Les dépenses sociales ont pris en France une part croissante dans la dépense nationale depuis la dernière guerre, pour arriver aujourd’hui à environ 24% du PIB. L’augmentation rapide des dépenses sociales jusque dans les années 80, plus importante que l’augmentation générale de richesse, traduit le fait que toute une série de besoins médicaux et sociaux de base n’étaient pas encore satisfaits.
La part de la consommation médicale dans le PIB (produit intérieur brut) a presque doublé de 1970 à 1995 et s’est stabilisée depuis (9,8% du PIB pour les seules dépenses médicales en 1997). Cette protection sociale élevée, débarrassant les travailleurs des soucis du lendemain, a été un puissant moteur du développement économique de l’après-guerre.
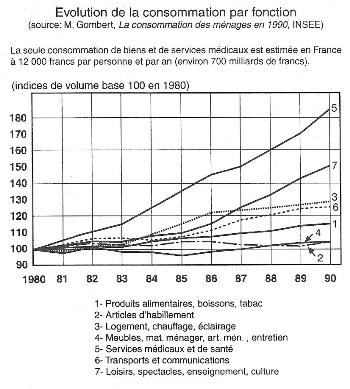
La seule consommation de biens et de services médicaux est estimée en France à 12 000 francs par personne et par an (environ 700 milliards de francs).
Nombreux sont les « experts » qui affirment aujourd’hui l’inverse. Une forte protection sociale serait selon eux un handicap au développement. Ils l’accusent d’alourdir les charges de l’économie et d’affecter la rentabilité vis-à-vis d’autres pays qui peuvent produire moins cher parce qu’ils protègent moins leurs populations.
Voici ce que disait à ce propos en 1975 Chantal Euzebey, chargée de conférence à la faculté des sciences économiques et sociales de Grenoble, à une date où les charges de protection sociale n’avaient pas encore été alourdies par le poids du chômage :
Toute augmentation de la part représentée dans le PIB par les dépenses de protection sociale tend à apparaître dans les pays économiquement et socialement les plus avancés comme de moins en moins compatible avec la réalisation des objectifs de leurs politiques économiques (...) Pour rester dans le système actuel d’échanges libéralisés, ces pays devront privilégier l’efficacité économique et la compétitivité de leurs entreprises, avec le risque de renoncer, au moins provisoirement, à certains objectifs sociaux.
Chantal Euzebey appelle ici au « dumping social ». La Grande-Bretagne, championne de la déréglementation sociale, le pratique depuis une quinzaine d’années. En France, le « trou » de la Sécurité sociale est utilisé comme prétexte à des coupes budgétaires qui vont dans le même sens.

Cela étant dit, même s’il reste des zones d’ombre, la grande majorité des Français est couverte et les dépenses auraient dû augmenter à un rythme moins élevé depuis les années 90. Si cela n’a pas été le cas, c’est que le chômage a continué à croître tandis que les revenus sur lesquels sont prélevées les dépenses ont peu ou pas augmenté ; le poids relatif des dépenses sociales s’est alors accru (figure ci-dessus). Si les salariés gagnaient plus en moyenne et n’étaient pas au chômage, on pourrait globalement percevoir plus de cotisations en cotisant moins par tête (taux de cotisation plus bas).
Le meilleur moyen de baisser le « coût » relatif de la protection sociale, c’est donc d’augmenter le niveau de vie plus vite que le niveau de protection sociale. Suivons en cela la route tracée par les bâtisseurs de l’après-guerre.
2. Peupler et construire le continent eurasiatique, un impératif pour la santé publique en France
Aujourd’hui ce n’est pas à l’échelle de notre pays ou même de l’Union européenne actuelle qu’il faut reconstruire, mais de tout le continent eurasiatique. Aux destructions du système communiste ont succédé les ravages pires encore de la « thérapie de choc » et de l’ultralibéralisme.
La majorité des populations de l’Eurasie n’ont encore aucune protection sociale. Par son ampleur, la tâche demande l’adhésion et la participation de tous.
La première remarque qui vient à l’esprit lorsque l’on regarde la carte des populations mondiales, c’est que, hormis quelques zones précises ; l’Europe, la Chine et une partie de l’Asie et du sous-continent indien, la région des grands lacs aux Etats Unis, notre planète pour la plus grande partie est vide.
Ensuite, si l’on juxtapose une carte des richesses naturelles et notamment minières, on s’aperçoit que les zones très peuplées sont pauvres en matières premières alors que les zones sous-peuplées, à l’image de la Sibérie, en regorgent souvent.
La troisième donnée n’apparaît pas sur la carte ; en gros dès que l’on sort des pays du G-7, un immense appétit de développement et de croissance émane des trois quarts des populations du globe encore sous-développées.
Il revient certes à chacun des pays en voie de développement de se développer d’abord par lui-même. Mais encore faut-il, à défaut de les aider, ne pas les en empêcher comme c’est le cas aujourd’hui avec les politiques d’endettement et de sous-développement technologique menées par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.
Pour mieux extraire les matières premières, les transformer sur place et acheminer les produits semi-finis et finis, l’équipement lourd des pays du Sud (voies de communication, énergie, machines-outils) nécessite un transfert massif de technologie et de savoir-faire de nos pays vers les leurs, afin qu’ils puissent au plus tôt maîtriser les techniques de fabrication et de distribution les plus nécessaires.
Seul, aucun pays développé ne peut satisfaire aux besoins d’infrastructure du continent eurasiatique. L’Europe a vocation à devenir la locomotive économique du développement continental, à être l’arsenal qui va concevoir et livrer les équipements lourds nécessaires au décollage économique des pays moins avancés. Elle réunit toutes les conditions pour l’être : la seule zone du globe à réunir à la fois une population nombreuse, très dense, et très éduquée en moyenne, avec une base infrastructurelle encore la meilleure au monde. Le tout avec un niveau technologique de premier plan.
Le triangle productif européen entre Paris, Berlin et Vienne, selon la conception de l’économiste américain Lyndon LaRouche, constituerait une sorte de plate-forme d’exportation de biens à haute valeur ajoutée et de savoir-faire vers l’Est et le Sud (Encadré 16).

Le développement se concentrerait dans un premier temps autour des corridors qui courent le long du continent, sur les trajets des anciennes Routes de la soie. Ces couloirs concentreront tout ce qu’il faut pour le décollage (eau, énergie, transport, hôpitaux), et regrouperont les populations de zones peu peuplées et parfois hostiles dans des villes nouvelles de taille moyenne (50 000 habitants environ).
Un tel projet, repris actuellement avec force par les autorités chinoises sous le nom de « pont terrestre eurasiatique », implique - outre une réforme totale du système monétaire international - un changement qualitatif profond de l’économie européenne.
En effet, l’Europe dont on nous rebat l’oreille n’existe pas dans la vie de tous les jours. A l’exception des dessertes TGV, il faut presque autant de temps qu’il y a trente ans pour se rendre dans les grandes capitales européennes à partir de Paris par la voie terrestre. Au sein même des grandes villes européennes, les temps de transit s’allongent démesurément, surtout pour se rendre à son travail.
Les banlieues des grandes villes forment des excroissances anarchiques et sous-équipées. L’objectif prioritaire du cœur technologique constitué par le triangle productif est de mettre en place un réseau de chemins de fer à grande vitesse qui permettra de transporter les passagers entre deux points quelconques en moins de trois heures et le fret en moins de quarante huit heures, de porte à porte.
Encadré 16 :
Les trois priorités du Pont terrestre
- Faire un réseau de transport à grande vitesse de fret et de passagers dans le triangle géographique qui inclut, entre Paris, Berlin et Vienne, les régions les plus densément peuplées et la main-d’œuvre la plus qualifiée du monde ;
- Concevoir et mettre en place une nouvelle génération de réacteurs nucléaires de petite taille et intrinsèquement sûrs (ils existent, ce sont les réacteurs à haute température, ou HTR) que l’on puisse installer facilement en Europe et surtout en Asie et en Afrique, car ils seront assemblés par modules préfabriqués ;
- Maîtriser rapidement la fusion thermonucléaire qui décuplera les capacités de transformation de la matière, ouvrant des domaines totalement inédits dans la science des matériaux et la biologie.
Le concept est de mettre les moyens actuels et futurs de l’Europe occidentale développée « à la disposition » de l’Europe, et au-delà de toute l’Eurasie et du continent africain, pour créer un espace de développement mutuel, comme le plan Marshall le fit entre les Etats-Unis et l’Europe occidentale.
La France et l’Allemagne ont vocation à emmener le peloton européen. Notre pays est leader mondial dans les domaines stratégiques que nous venons de citer (leader mondial dans le traitement de l’eau, dans l’énergie, les transports ferroviaires et aéronautiques). L’Allemagne est, avec son « Mittelstand » (réseau de PME), le leader mondial de la machine-outil et de la résolution des problèmes d’économie physique.
Outre les mesures indispensables en termes d’orientation du crédit et de mobilisation des secteurs de base, le grand défi du pont terrestre concerne les populations. L’acceptation quasiment avouée du chômage - l’hypothèse de taux de chômage retenue en 1998 par le rapport Charpin sur les retraites est de 9% en 2040 ! - et la réduction du temps de travail en désespoir de cause apparaissent comme quasi-criminelles quand on mesure à quel point nos ressources humaines sont sous-exploitées en regard des besoins.
Il faudra non seulement utiliser toutes les capacités productives existantes, en main-d’œuvre et équipement, mais aussi ne pas exclure une nouvelle immigration en Europe.
Cette main-d’ œuvre devra tenir, cette fois, des postes qualifiés et bien rémunérés. Elle pourra venir dans le cadre d’accords de coopération prévoyant le retour vers le pays d’origine afin d’y exploiter les connaissances et l’expérience acquises. Pour ceux et celles qui désireraient rester, l’intégration ne pourra se faire que par le haut, en faisant référence au fond culturel commun de la civilisation judéo-islamo-chrétienne.
Ces nouveaux actifs contribueront à résorber le déséquilibre démographique ... et le trou de la Sécurité sociale.
Un projet d’une telle ampleur nécessite notamment la mobilisation des personnes plus âgées et encore en pleine possession de leurs moyens, dont l’expérience sera irremplaçable pour former les nouvelles générations. Il faut des dizaines d’années pour former une main -d’ œuvre industrielle hautement qualifiée et créative. D’ores et déjà des industries comme le nucléaire font appel à leurs jeunes retraités qui continuent à exercer une activité car l’entreprise a besoin de leur mémoire et de leur expérience.
L’allongement de la durée de vie devient, dans ce contexte, une nécessité économique, car la transmission de la connaissance y est plus longue et plus complexe.
Nous reviendrons alors nécessairement à des standards élevés de santé publique, en considérant le budget santé comme une sorte d’investissement plutôt qu’une dépense. L’accent principal sera mis sur la prévention ; nous aurons effectivement un ministère de la Santé, et non comme actuellement un ministère qui gère la maladie.
3. Les infrastructures sont une « question vitale »
Pourquoi il faut réinvestir prioritairement et massivement dans les grandes infrastructures, à commencer par la relance des projets abandonnés ces dernières années : canal Rhin-Rhône, Super phénix, schéma TGV... accompagnant et fournissant sa raison d’être à la création d’un vrai maillage hospitalier.
Selon les points de vue les plus optimistes, 15% [22] seulement de l’amélioration de la santé des Occidentaux sont dus aux progrès des soins médicaux curatifs en tant que tels.
Les 85% qui restent sont expliqués par d’autres facteurs en tête desquels viennent les conditions de vie liées à l’infrastructure du pays - approvisionnement en eau pour l’hygiène et la diététique, énergie pour l’agriculture, l’industrie et l’habitat, transports rapides et confortables, etc. - et à son organisation sociale. L’espérance de vie dans un pays donné est, par exemple, en relation directe avec la capacité énergétique.
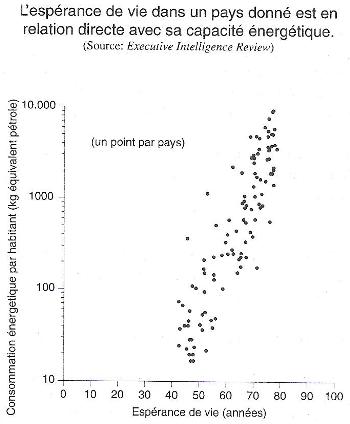
Or les grandes infrastructures de base de notre pays ont été réalisées ou lancées durant les Trente Glorieuses. Alors qu’arrivait le temps de les renouveler ou de les moderniser, le rythme des investissements s’est considérablement ralenti depuis une vingtaine d’années et même les budgets alloués à l’entretien sont en baisse.
Dans le domaine de l’énergie, notre pays a été le pionnier toutes catégories du nucléaire. Le remplacement prévu récemment d’une partie du parc électronucléaire par des centrales à gaz consacre le retour à une technologie économiquement plus arriérée (c’est-à-dire à moindre densité de flux énergétique produit). Par ailleurs, la nouvelle génération de réacteurs piétine, et on reste sur les acquis de la technologie développée voici trente ans pour construire notre parc électronucléaire.
Il en est de même dans les transports et surtout l’infrastructure urbaine. Le budget d’entretien du réseau routier national a diminué de 30% depuis dix ans, celui du réseau départemental de 50% selon la Fédération nationale des travaux publics. Le TGV lui-même vieillit, l’équipement des réseaux a connu un coup d’arrêt et son successeur n’est toujours pas prévu. Dans les villes, l’amélioration des équipements collectifs a été sacrifiée en faveur d’une tendance à la consommation individuelle. Les banlieues « mangent » l’urbanisme, reflétant un sous-investissement massif depuis au moins vingt ans.
Pour justifier ce laisser-aller, on prétend que les grandes infrastructures sont des gouffres financiers. C’est méconnaître leur rôle.
Si la part des infrastructures dans le coût global d’une économie est de fait prépondérante, leur rentabilité réelle n’est généralement pas prise en compte. Ainsi, les infrastructures jouent un rôle essentiel dans la dissémination du progrès technologique dans l’économie (énergie, transport, sciences de la vie-médecine), tant par les capacités productives qu’elles augmentent que par leur vertu propre, étant donné les techniques avancées qu’elles requièrent pour leur construction et leur exploitation.
Tout cela a certes un prix, mais celui-ci doit être évalué à l’aune de la capacité de l’économie dans son ensemble à augmenter le volume et la qualité des ressources physiques. On ne peut apprécier la rentabilité d’une infrastructure qu’en comparant son coût à l’augmentation de productivité qu’elle engendre dans l’économie prise comme un tout [23]. Et aucune méthode n’existe à ce jour pour estimer cet accroissement de productivité globale.
Que dans ces conditions la volonté politique faiblisse, et ce sont au contraire les arguments étroitement comptables qui l’emportent.
C’est ce qui se passe pour la santé. En tant qu’infrastructure qui permet la production nationale, le système de santé ne saurait en aucun cas obéir à une logique d’entreprise isolée. Cela revient à demander aux fondations d’un édifice de justifier de leur existence indépendamment de l’immeuble qu’elles soutiennent. Notre pays a de toute façon besoin du meilleur système de santé possible en fonction de l’état des connaissances. Faire de chaque hôpital individuel un « centre de profit » est un non-sens absolu en terme d’économie nationale.
4. Revenir vers les secteurs productifs
En améliorant en permanence les technologies employées, on peut, avec un travail moindre, produire plus de biens et de meilleure qualité. La quantité de biens disponibles par ménage, regroupés en « panier de biens », parmi lesquels on doit compter tous les biens de consommation individuelle ou collective relatifs à la santé, augmente donc en même temps que leur qualité (Encadré 17).
Le maintien d’un flux de biens et de services adéquat pour notre santé dépend donc de notre capacité productive globale. Or celle-ci diminue, parce que les actifs travaillent de moins en moins dans la production physique de biens et parce que le nombre d’inactifs ne cesse d’augmenter.
Encadré 17 :
Réorienter l’emploi vers la recherche et la production
Plus l’économie avance, plus la proportion d’emplois qualifiés relativement aux emplois non qualifiés, notamment dans l’éducation (*), la recherche et l’industrie, augmente. Corrélativement, le nombre de personnes employées dans la production de biens d’équipement augmente par rapport à celles qui travaillent dans le secteur agricole et celui des matières premières.
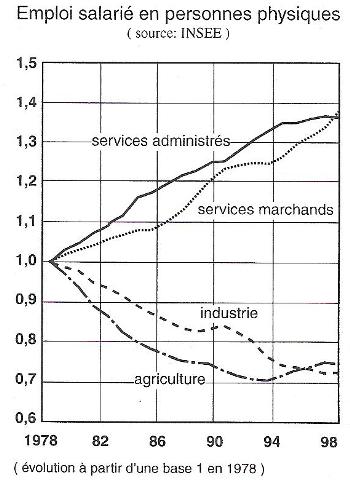
En moyenne, une personne sur deux doit être engagée dans la production de biens physiques ou dans des activités qui y contribuent directement comme les transports et la santé (soit 50% de la population active). Et, très rapidement, au moins 5% des actifs doivent être employés dans les activités visant à favoriser les découvertes fondamentales et la diffusion dans l’économie du progrès technologique qui en découle : recherche fondamentale et appliquée, transferts technologiques vers l’industrie.
En médecine, l’innovation est le fruit d’une collaboration entre cliniciens, scientifiques, et industriels. Elle se fait principalement au sein de petites unités, soit au sein de grands groupes, soit plus encore dans des PME positionnées sur des niches technologiques. Ces PME sont généralement créées par des entrepreneurs issus de l’université ou de la grande industrie et qui, propriétaires d’une technologie originale protégée (par un brevet ou un savoir-faire exclusif) construisent un projet d’entreprise autour de cette technologie. Les organismes de recherche qui, en France, sont à la base de ce processus sont l’INSERM, le CNRS, les universités, les écoles d’ingénieurs, les établissements hospitaliers publics (CHU). Les entreprises de ce secteur consacrent en moyenne 7% de leur chiffre d’affaire à la recherche et au développement (R&D).
Note :
*On peut vouloir allonger la durée d’études des jeunes pour augmenter leur niveau de culture générale et de qualification. Ce délai supplémentaire pour l’entrée dans la vie active coute à l’économie parce que ces jeunes continuent à consommer sans produire. Mais quand ils arrivent sur le marché du travail, ils élèvent d’autant plus le niveau de productivité de l’économie. Celle-ci profite ainsi de l’investissement consenti pour leur formation.
Les actifs vont plutôt vers les services
Le nombre des actifs engagés dans la production de biens physiques, dont dépend l’existence de toute la population, n’a pas cessé de diminuer depuis trente ans. Les emplois viennent de secteurs de plus en plus éloignés de la production physique, généralement moins qualifiés, au mieux vaguement utiles, au pire nuisibles.
Citons tous les petits boulots qui sont une forme de chômage déguisé, les emplois de service qui se multiplient de manière cancéreuse (dans la publicité, le marketing, l’assurance, l’industrie des spectacles de masse, les divertissements en tous genres qui abêtissent au lieu d’élever). Et toutes les activités criminelles et para-criminelles (industrie de la pornographie, drogue, jeux, trafics et spéculations de tous ordres, à commencer par la spéculation sur les marchés financiers).
Il y a un nombre croissant d’inactifs
Le potentiel de travail n’augmente pas autant qu’il le devrait à cause de la dénatalité, du chômage et de la préretraite. Alors que les besoins augmentent avec l’allongement de la durée de vie, lé passage massif en préretraite a diminué la durée de la vie active moyenne, restreignant d’autant la capacité productive de la population active
A l’autre extrémité de la pyramide des âges, une partie importante des jeunes arrivants à l’âge d’être productif sont au chômage : l’économie qui a investi pour leur éducation et leur formation n’en a pas le retour.
On consacre chaque jour et à juste titre des sommes très importantes pour sauver des vies humaines, avec des équipements de pointe : Si par ailleurs les vies sauvées à grand prix vont rejoindre le bataillon des chômeurs dont le système économique actuel est incapable de solliciter le potentiel productif, alors, oui, nous vivons au-dessus de nos moyens. Et l’on trouvera fatalement un quelconque ministre du Budget pour déclarer un jour : à quoi bon maintenir les « chômeurs structurels » en bonne santé, puisqu’il a été admis que l’économie n’en avait pas besoin ?
Le travail des femmes a masqué la baisse relative de production
Le travail croissant des femmes a retardé les manifestations de la crise. Dans les années 60, le revenu de la famille reposait sur l’emploi unique du mari. Aujourd’hui, les ménages sont souvent contraints de travailler plus pour maintenir leur niveau de vie. Aux États-Unis là ou le chef de famille n’avait qu’un travail, il en a aujourd’hui couramment deux pour maintenir les rentrées d’argent. Cela se traduit au final par une qualité de vie très dégradée, beaucoup de temps dans les transports et des enfants qui voient peu leurs parents.
Nous arrivons maintenant à un point de rupture où malgré ces efforts pour se maintenir, les ménages constatent une baisse nette de leur niveau de vie en plus de la dégradation de la qualité de vie. On a beau travailler plus, les rentrées ne sont pas aussi importantes. Le stress de ceux qui sont surchargés de travail s’ajoute au stress - différent mais peut-être encore plus destructeur - de ceux qui n’en ont pas, générant de nouvelles affections physiques et psychologiques qui sont un autre défi à la santé publique.
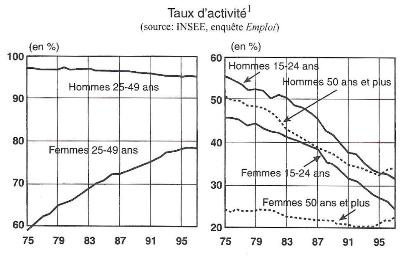
Les effets de la montée en force du travail féminin, phénomène bien entendu positif s’il était toujours choisi librement et s’il apportait un véritable « plus » au ménage, s’estompent ainsi au fur et à mesure que les activités non productives prennent le pas sur les productives.
Pour ces deux raisons ; diminution générale de la population active et moindre proportion de producteurs dans cette population active, l’existence physique des populations repose ainsi sur une base toujours plus étroite de producteurs [24]. Jusqu’à quand de moins en moins de producteurs pourront-ils satisfaire de plus en plus de consommateurs qui ne produisent pas ?
Appendice
Retrouver l’optimisme des pionniers de la sécurité sociale
L’élan de 1945
Les systèmes de protection sociale universelle qui se sont mis en place un peu partout à la Libération, en Europe et en Amérique, tendaient à la réalisation du vieux rêve d’une société débarrassée du souci constant de la survie, formulé au XVIIe siècle par le philosophe et mathématicien Gottfried Leibniz (*).
Alexandre Parodi, nommé ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le gouvernement provisoire formé après la Libération de Paris, présentait ainsi le projet d’organisation de la Sécurité sociale : « Tous les pays du monde, dans l’élan de fraternité et de rapprochement des classes qui marque la fin de la guerre, s’efforcent d’instituer au profit des travailleurs et même parfois de l’ensemble de leur population un système de Sécurité sociale ».
Chargé par Alexandre Parodi de mettre sur pied une réforme ambitieuse pour la France, Pierre Laroque s’inspirait notamment du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (**), déclarant que la nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Il précisait lui-même que « la dignité inaliénable de l’être humain doit passer par un bon accès aux soins et une sécurité matérielle, notamment pour les vieux jours ».
La Sécurité sociale était selon lui :
La garantie donnée à chaque homme qu’en toute circonstance il pourra assurer dans des conditions satisfaisantes sa subsistance et celle des personnes à sa charge.
Il faut, affirmait-il :
Débarrasser les travailleurs de la hantise du lendemain, de cette incertitude génératrice chez eux d’un complexe d’infériorité paralysant l’expansion de leur personnalité, et origine réelle de la distinction des classes entre possédants, sûre d’eux-mêmes et de leur avenir, et les non-possédants, constamment sous la menace de la misère.
S’adressant aux futurs cadres de l’institution, il concluait :
C’est une révolution qu’il faut faire et c’est une révolution que nous ferons.
Les conséquences de ce renversement doctrinal sont effectivement considérables. On est passé de la notion séculaire de sécurité-propriété à celle de sécurité-droits. Les salariés, éternels exclus, ont accédé à un niveau de protection supérieur.
À la logique antérieure d’assurance s’est substituée celle d’un droit fondamental garantissant à tout être humain la couverture de l’ensemble des risques sociaux auxquels il est confronté. Dans une société qui reconnaît majoritairement la libre entreprise comme force motrice de son développement, l’ordonnance de 1945 marque la volonté de raisonner dans le domaine de la santé, au niveau non pas de l’entreprise individuelle, mais de l’entreprise nationale. Le souci d’assurer au pays une population en bonne santé ne saurait être dévolu à la seule initiative individuelle, ce que certains appellent la « régulation du marché ».
La clé de la vision de Pierre Laroque tient dans cette phrase :
Pour moi, le haut fonctionnaire c’est l’Etat, ce qui veut dire qu’il est le représentant de l’intérêt général en face des intérêts particuliers.
Pierre Laroque définit cet intérêt général comme un objectif presque inaccessible, un idéal qui permettrait de réaliser l’harmonie en dépassant des conceptions et des intérêts contradictoires.
Le triage des plus faibles réapparaît
Juste après la guerre, il était ainsi évident pour la plupart que l’essor des conditions de vie générales en France et en Europe devait être suivi dans les autres pays moins avancés. C’était l’esprit du mouvement des non-alignés, de la conférence de Bandung de 1955 et de la première décennie pour les développements des Nations unies, auxquels font référence aujourd’hui des pays comme l’Inde ou la Chine.
En réaction à l’émergence de nations souveraines qui pouvait résulter de ce mouvement général, une intense propagande prit corps à la fin des années 60, visant en priorité les pays du Sud. C’est à cette époque que l’on commence à parler de « croissance zéro » et de réduction démographique. Voici, résumée, la thèse sous-jacente :
Par sa prolifération incontrôlée, l’espèce humaine met en danger notre planète dont les ressources sont limitées. Nous allons vers l’épuisement des richesses fournies par la nature, il faut donc bloquer le développement et les naissances.
L’Égypte, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, sont mis au banc des accusés pour être trop prolifiques et contribuer à une soi-disant surpopulation. En fait, ces pays sont visés parce qu’ils représentent les plus gros potentiels de développement.
Le Club de Rome, différents mouvements écologistes internationaux (Greenpeace étant le plus connu), et certains gouvernements (surtout l’administration Carter aux États-Unis) militent alors dans ce sens.
Au départ, le Club de Rome expose ses thèses crûment : dans la théorie dite du « canot de sauvetage », ses « experts » affirment que tous les pays ne peuvent pas survivre et qu’il faut faire un tri entre ceux qui peuvent vivre et ceux qui devront être « laissés pour compte ».
A l’ image de la famille Harriman - propriétaire de la Chase Manhattan Bank - qui soutint l’eugénisme et la montée au pouvoir d’Hitler dans les années 30, une bonne partie de l’oligarchie financière actuelle pense toujours en ces termes. Elle se conçoit comme supérieure, donc apte à faire un tri « éclairé » entre ceux qui peuvent vivre et ceux qui doivent mourir.
Devant le tollé soulevé auprès des pays du tiers-monde, sans parler des églises (la réaction du Vatican fut cinglante), de tels discours ne sont plus tenus en public.
Insidieusement, ils sont cependant mis en application, en invoquant par exemple une « libération de la femme » que les mêmes beaux parleurs ne se gênent pas pour opprimer en imposant « la loi inéluctable des marchés » (conduisant à une baisse de l’espérance de vie, à la propagation des maladies tropicales, à une moindre éducation et un accès à l’eau potable insuffisant).
Sous des dehors qui se veulent respectables, le Fonds monétaire international (FMI) se trouve ainsi aujourd’hui à la tête d’un triage actif vis-à-vis des pays en voie de développement.
Les dirigeants qui acceptent le pillage dont leur pays fait l’objet passent pour de « bons élèves », les autres sont dénoncés pour leur corruption et les obstacles qu’ils mettent aux « réformes ». Le FMI est ainsi devenu le décideur eh dernier ressort de la politique économique de nombreuses nations en voie de développement.
Le libre-échange universel, slogan des Etats-Unis notamment à partir de l’administration Reagan, est le moyen privilégié pour effectuer le tri de ceux qui sont le plus aptes à survivre, pour reprendre l’expression de Darwin vulgarisée par Herbert Spencer. Un pays peu développé qui se soumet au libre-échange est en effet condamné à stagner (***).
La mondialisation, dans la mesure où elle est la version moderne de ces idées, est incompatible avec le respect des droits inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme, dont celui à la santé.
On voit ainsi réapparaître des tendances rappelant les mesures prises au cours des années 30 vis-à-vis des malades mentaux, des handicapés et d’une façon générale de toutes les personnes considérées comme « inutiles » ou « inférieures ». Les plus faibles sont victimes d’un triage qui ne dit pas son nom, au nom de règles d’équilibre comptable (****).
En invoquant la « loi de l’offre et de la demande », la science économique classique porte intégralement cette vision. Elle considère en effet l’homme comme une variété évoluée d’animal. On lui reconnaît un instinct supérieur appelé intelligence, mais il ne peut en aucun cas se soustraire aux lois du règne animal, à savoir que le développement de chaque espèce est limité par une niche écologique.
La globalisation actuelle est au total une tentative d’imposer à l’ensemble de l’humanité l’économie classique prédatrice, celle d’Adam Smith, de Malthus et de Darwin-Spencer. L’être humain y est envisagé du simple point de vue utilitaire (Encadré 18), il alimente la machine économique de l’empire en augmentant le profit par action (la fameuse « share holder value » ).
Encadré 18 :
Al Gore et le triage des plus faibles
Al Gore, le vice-président américain sous Bill Clinton, a été l’un des instigateurs du projet de réforme du « Welfare Bill » entériné par le président contre l’avis de ses conseillers les plus proches.
Signé par un président démocrate, le « Welfare Bill » institutionnalise un système de coupes draconiennes dans tous les budgets sociaux du gouvernement fédéral. C’est le même Al Gore qui est intervenu début 1999 au nom des sociétés pharmaceutiques de son pays pour demander l’interdiction d’introduire en Afrique des médicaments à bas coût permettant de traiter les victimes de l’épidémie de sida, parce que « cela constituerait une concurrence déloyale pour les laboratoires américains ».
Les ultraconservateurs tels que Newt Gringrich, qui ont fait de l’équilibre budgétaire leur cheval de bataille et font maintenant pression pour des baisses d’impôts, tirent plus fort encore dans la même direction.
Santé physique et santé psychique
On peut comprendre à quel point ce nouveau paradigme économique entraîne un changement culturel non moins profond, générateur de dépressions et des nombreuses maladies psychosomatiques contemporaines. Apparu dans les années 60, le basculement culturel s’est confirmé avec l’accession à l’âge adulte et aux postes de responsabilité des générations « soixante-huitardes ». Le malaise existentiel frappe prioritairement les jeunes. Ils éprouvent le sentiment que leur existence est inutile, provoquant des comportements de fuite, ou un désintérêt général assorti de la réflexion « à quoi bon ? ».
Les « soixante-huitards » et leurs enfants, débordés par la mystique de la « consommation », avec ses services, son marketing et sa publicité, ont perdu peu à peu le sens des responsabilités et d’aventure collective liée à une réalité de production physique qui avait soufflé au début de la reconstruction.
La montée des mouvements contestataires pendant et après la guerre du Vietnam reflète l’impasse économique du consumérisme et l’impasse stratégique du conflit vietnamien. Outre la peur d’être enrôlés, les jeunes adultes américains voyaient à juste titre dans la guerre du Vietnam un conflit inique et destructeur. Plus généralement, derrière le paravent de la lutte contre le communisme, les doctrines développées lors de la guerre froide traduisaient une vision bestiale du monde, partagé en deux camps avec leurs zones d’influence, dominés par le rapport de force et le clientélisme éhonté.
Le choix de la terreur nucléaire fait par les Etats-Unis une fois Roosevelt disparu scelle, malgré la parenthèse Kennedy, l’espèce de coup d’Etat effectué par l’oligarchie anglo-américaine sur le terrain des relations internationales et contre les Etats-nations. Parce qu’ils représentaient, surtout sous Franklin Delano Roosevelt et Kennedy, dans la grande tradition de Lincoln, un potentiel pour le meilleur dans le monde, les Etats-Unis eux-mêmes ont été les premiers visés. L’optimisme de leur population, nourri par les succès de la lutte contre le nazisme, a été en partie cassé et leur puissance mise au service de l’équilibre de la terreur et du pillage des richesses appartenant à d’autres.
En France, le souffle gaullien éteint, c’est une vision froide et moderniste de l’industrialisation qui prend le pas avec Georges Pompidou. Rouage d’une grande machine sans âme, l’individu producteur ne se retrouve plus dans le « métro-boulot-dodo » des années 70. Cette nouvelle orientation se traduit dans les réformes du contenu des enseignements, avec notamment l’apparition des mathématiques modernes comme formalisme logique coupé de tout contexte créateur.
Systématiquement renvoyé à lui-même, le citoyen se replie : « Je m’occupe de ma famille », « la politique c’est sale » avec sa variante « d’accord mais dans un grand parti respectable ». Ou alors, je contribue « à mon niveau », à quelques œuvres humanitaires par exemple, mais sans jamais m’élever à la compréhension des affaires de ce monde. Au pire, ce sera le « carriérisme survivaliste » : « Tu dois gagner, sinon c’est toi qui vas te faire bouffer. »
Chercheur israélien, Aaron Antonovsky tente a contrario d’expliquer pourquoi certains individus prennent plus de goût à la vie et vieillissent mieux que d’autres (cité dans le mensuel La Recherche (*****)). Il parle du « sens de la cohérence ».
L’individu qui possède un « sens de la cohérence » élevé a le sens que la vie a du sens, que l’on peut agir sur elle, que les choses n’arrivent pas par hasard. Antonovsky a étudié plusieurs groupes d’individus dans différents pays et a montré que les individus qui ont un « sens de cohérence » élevé vivaient mieux leur retraite (c’est-à-dire tombent moins malade, moins longtemps, vivent plus vieux, etc.). Selon lui, ce sens se développe très tôt dans l’existence, parfois dès la petite enfance. Il est dépendant du milieu familial, de l’éducation et est souvent renforcé par les rencontres de la vie : un professeur admirable, une grand-mère combative ...
Le sens de la cohérence dont parle Antonovsky est naturel dès qu’on remet l’homme à sa place, créé à l’image de Dieu et à ce titre co-créateur. Cet optimisme culturel est le meilleur antidote à la tentation du repli sur soi. Il incite à agir sur le monde et nous donne un sens de responsabilité pour les autres.
Chaque être humain est doué de raison et ses capacités créatrices sont potentiellement illimitées. Il est porteur d’une humanité qui a la capacité, si elle s’en donne les moyens, d’élargir toujours plus le champ de sa connaissance par une série de découvertes de principes physiques nouveaux expérimentalement validés.
Sans vouloir entretenir une nostalgie impuissante des années passées, nous devons ainsi recréer l’horizon de développement commun qui caractérisait les années d’après-guerre. Nous avons aujourd’hui les moyens d’aller beaucoup plus loin encore dans la découverte et le progrès pour tous. A condition de développer notre potentiel créateur et de recommencer l’aventure.
Notes :
* Dans son texte Économie et société (1671). Leibniz écrit : « Si un homme n’est pas, avant tout, assuré de sa subsistance (et d’un minimum de bien-être physique, ndlr), il n’a ni le cœur ni l’esprit pour quoi que ce soit, il produit seulement ce qu’il espère vendre, se préoccupe de banalités, et n’a pas le cœur à entreprendre quoi que ce soit de nouveau ».
** Auquel renvoie expressément la Constitution de 1958.
*** Sans protection douanière, il ne peut développer ses propres productions ; condamné à importer, sa marge de manœuvre est très réduite étant donné la cherté des biens d’équipement étrangers. Son niveau de vie dépend de sa capacité résiduelle à importer des biens de consommation, d’autant plus réduite que sa balance des paiements est déséquilibrée.
**** Les prétentions sociales des états qui, comme la France, voudraient une société plus humaine dans le cadre du système financier actuel sont à terme intenables. L’économie sociale de marché n’existe pas. Contrairement à ce que croit par exemple un Lionel Jospin, on ne peut détacher l’économie de marché de la société de marché, car c’est un tout.
***** La Recherche, numéro spécial, Vivre 120 ans, juillet/août 1999.
