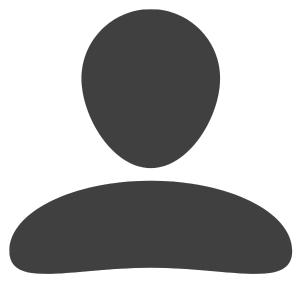[sommaire]

Cet article fait partie d’un ensemble de deux articles consacré aux pièces historiques de William Shakespeare. Voir Le Roi Jean de Shakespeare, une histoire contemporaine.
Pourquoi Shakespeare aujourd’hui ?
Il y a quelque chose de pourri dans notre culture ambiante qui fait que la plupart d’entre nous ont « le nez collé au guidon » du présent immédiat, de « l’ici et maintenant ». C’est un problème politique très grave car, comme chacun le reconnaîtra maintenant, notre société se trouve dans une crise générale. Non seulement la pensée courte qui domine notre culture a rendu cette crise possible, mais en plus, elle empêche nos concitoyens de réfléchir rationnellement à la situation et d’en trouver des solutions.
La première étape nécessaire pour résoudre une crise consiste à en découvrir les causes. La plupart du temps, ces causes ne sont pas directement visibles. Nous en voyons différents symptômes (destruction du « pouvoir d’achat », drogue et violence dans la jeunesse, terrorisme et guerres, sous développement…), tout cela est bien connu, mais il n’est pas évident pour tout le monde ne serait-ce que de se demander si ces symptômes n’auraient pas une relation les uns avec les autres.
En réalité, les causes de la crise que nous connaissons étaient déjà présentes avant même notre naissance. Pour pouvoir la résoudre il faudrait donc libérer la pensée de nos contemporains de l’immédiateté – ce qui peut paraître irréaliste à première vue car comment convaincre quelqu’un qui se noie de réfléchir ? Cependant, non seulement on ne pourra pas se dispenser de parier ainsi sur la capacité de l’être humain à penser, mais en plus, l’histoire nous montre que des paris aussi fous ont été tentés et gagnés en d’autres temps. Et c’est la raison qui nous conduit ici à invoquer l’esprit de Shakespeare.
Pour que cette dernière proposition ne paraisse pas arbitraire, il n’est pas inutile de rappeler quelque chose concernant le Président Lincoln. En plein cœur de la Guerre de Sécession, il avait l’habitude de lire des écrits de Shakespeare et des livres de blagues devant les membres de son gouvernement bousculés par les évènements immédiats auxquels ils faisaient face. Ces derniers étant restés particulièrement rigides après qu’il leur eût lu une histoire apparemment très drôle, il leur dit un jour :
Pourquoi ne riez-vous pas Gentlemen ? Si je ne riais pas, je mourrais certainement, et vous avez autant que moi besoin de cette médecine.
Lincoln a finalement vaincu l’esclavage aux Etats-Unis et organisé l’une des plus solides politiques de développement économique de l’histoire : on peut sans doute lui accorder le crédit de savoir comment trouver le calme nécessaire dans la tempête. Manifestement, il avait saisi quelque chose d’essentiel dans la manière de penser de Shakespeare, qui avait franchi plus de deux siècles et demi pour parvenir jusqu’à lui. Un siècle et demi après Lincoln, empruntons-lui à notre tour ses jumelles pour nous inspirer des leçons du passé.
La dynamique politique à l’époque de Shakespeare
Si vous trouvez que l’époque contemporaine est compliquée, projetez-vous par la pensée dans celle de Shakespeare. Shakespeare est né en Angleterre en 1564 sous le règne d’Elisabeth 1ère, et mort en 1616 sous le règne de son successeur Jacques 1er, le fils de Marie Stuart. Ces deux dates le placent dans l’une des périodes les plus sanglantes de l’histoire de l’Europe depuis la Renaissance : la période des guerres de religion qui commence en 1492 avec l’expulsion des Juifs d’Espagne du fait de l’Inquisition dirigée par Torquemada ; et qui finit en 1648 avec la Paix de Westphalie au terme de la Guerre de Trente Ans.
Parmi ceux qui portent la plus lourde responsabilité d’avoir embrasé l’Europe, figure sans conteste le roi Henry VIII d’Angleterre, le père d’Elisabeth 1ère. Comme Shakespeare le montre dans sa pièce éponyme, Henry VIII était un obsédé sexuel manipulé par ses conseillers – parmi lesquels figure le vénitien Francesco Zorzi. N’ayant pu obtenir une dispense du Pape pour annuler son mariage avec sa première femme Catherine d’Aragon, Henry VIII provoqua un schisme en créant l’Eglise anglicane dont le roi, ou la reine, d’Angleterre serait le chef suprême.
Lorsqu’elle arrive au pouvoir, Elisabeth 1ère hérite d’une situation très chaotique. Anglicane, elle est excommuniée par le Pape. Sur le plan extérieur, elle est donc en permanence sous la menace d’une attaque de la première puissance du monde, l’Espagne catholique de Philippe II qui lui envoie l’Invincible Armada en 1588. Philippe II, comme il est décrit dans le Don Carlos de Schiller, est un tyran au service de l’Inquisition.
Sur le plan intérieur, Elisabeth 1ère fait face à la fois aux catholiques et aux protestants puritains. Sans doute aurait-elle été favorable personnellement à une tolérance religieuse que refusent les extrémistes des deux bords, mais elle se laisse progressivement entraîner dans une politique de persécution à l’égard des catholiques. C’est ainsi qu’elle fait exécuter sa cousine prétendante au trône d’Angleterre, la catholique Marie Stuart qu’elle avait retenue prisonnière pendant près de 20 ans. Elle avait hésité entre l’idée de la déclarer ouvertement son héritière –la succession d’Elisabeth, la « reine vierge », est une question politique majeure au moment où Shakespeare écrit ses pièces historiques et ses tragédies – ou de la faire exécuter par peur d’un coup d’état catholique qui la mettrait au pouvoir.
Elisabeth 1ère passe ainsi son règne à hésiter et à laisser les évènements décider à sa place, alors qu’elle aurait pu s’inspirer de l’Edit de Nantes du roi de France Henri IV – qu’elle avait aidé par ailleurs. Une alliance entre une France et une Angleterre basée sur la liberté religieuse aurait sans doute permis d’abréger les guerres de religion d’une bonne cinquantaine d’années… Elisabeth 1ère est l’exemple même de ce qu’on pourrait appeler un personnage tragique : elle est intelligente, instruite, plutôt opposée au fanatisme, mais au bout du compte, elle ne devient qu’une courroie de transmission de la dynamique de guerre qui existait avant elle.
Lorsque Jacques Stuart devient roi d’Angleterre, il établit une dictature particulièrement répressive, persécutant à la fois les catholiques et les puritains. C’est sous son règne que le « parti vénitien », représenté par Francis Bacon, jette les bases de ce qui deviendra au siècle suivant l’Empire britannique. Londres est devenue progressivement la première place financière et géopolitique du monde, et ceci est toujours vrai à l’heure où nous écrivons ces lignes.
L’éducation politique du citoyen par l’histoire
Doit-on en conclure que l’individu humain est incapable de changer la dynamique de l’histoire ? Ce n’est pas l’avis de Shakespeare. Shakespeare est l’héritier de réseaux humanistes issus de la Renaissance parmi lesquels on trouve au début du XVIe siècle Erasme, Rabelais, Thomas More, Machiavel… Bien que ces derniers se soient battus contre la corruption dans l’Eglise, ils refusèrent de soutenir les provocations de Luther et de Calvin qui dénonçaient les mêmes abus qu’eux mais en cherchant l’affrontement avec Rome. Les humanistes comprenaient très bien que la Réforme et la Contre-réforme étaient toutes deux poussées politiquement par Venise dans un but de « diviser pour régner ».
Contre toutes ces manipulations, l’arme des humanistes était l’éducation du prince et des citoyens. La génération de Shakespeare poursuivit cette œuvre. C’est la génération de Christopher Marlowe, qui écrivit une pièce contre le massacre de la Saint Barthélemy avant d’être assassiné ; c’est celle de Chapman qui traduisit Homère en Anglais pour le rendre accessible au plus grand nombre… C’est par l’éducation humaniste qu’on peut permettre à l’homme de prendre du recul par rapport au témoignage immédiat de ses sens, de découvrir les causes réelles des évènements grâce à la méthode de l’hypothèse. Cette éducation vise à éveiller chez l’individu une capacité de jugement souveraine, plutôt que de lui impartir des connaissances académiques arbitraires.
Pour un individu réellement souverain, le temps n’est plus le temps qu’on subit, celui de l’horloge cartésienne mécanique inexorable, mais il devient celui de la causalité, de la dynamique qui ordonne les évènements.
Toute l’œuvre de Shakespeare est tournée vers ce but d’éducation du caractère, et pas seulement ses fameuses pièces historiques dont il va être question ci-après, mais également ses comédies qui sont la plupart du temps des tragédies déguisées. Bien entendu, il ne pouvait pas directement écrire une tragédie sur Elisabeth 1ère s’il voulait garder sa tête sur les épaules – il appartiendra à Schiller de le faire deux siècles plus tard dans sa Marie Stuart – cependant, tout comme Schiller, Shakespeare écrit des pièces sur le passé pour intervenir politiquement dans le présent.
C’est ainsi qu’il lance une attaque contre un certain « esprit de Plantagenet », du nom de la dynastie des chevaliers anglo-normands qui avaient régné sur l’Angleterre depuis le XIIe siècle, impliqués dans les Croisades et la guerre de Cent Ans orchestrées par Venise. Se disputant entre eux pour le pouvoir, les derniers descendants de cette dynastie provoquèrent une guerre civile, la guerre des Roses, qui s’arrêta à la fin du XVe siècle grâce à la défaite de Richard III Plantagenet, face à Henry Richmond, le futur Henry VII.
Calomnies
Avant de rentrer dans le vif du sujet des pièces historiques, il peut être utile ici, et plus particulièrement pour un lecteur français, de préciser que les lignes qui précèdent ont de quoi paraître quelque peu « sulfureuses » en raison du poids des calomnies portées contre Shakespeare dans notre culture jusqu’à aujourd’hui, pour des raisons politiques. Contentons-nous d’un exemple :
« Les Anglais avaient déjà un théâtre, aussi bien que les Espagnols, quand les Français n’avaient que des tréteaux. Shakespeare, qui passait pour le Corneille des Anglais, fleurissait à peu près dans le temps de Lope de Véga. Il créa le théâtre. Il avait un génie plein de force et de fécondité, de naturel et de sublime sans la moindre étincelle de bon goût et sans la moindre connaissance des règles. Je vais vous dire une chose hasardée, mais vraie : c’est que le mérite de cet auteur a perdu le théâtre anglais ; il y a de si belles scènes, des morceaux si grands et si terribles répandus dans ses farces monstrueuses qu’on appelle tragédies, que ces pièces ont toujours été jouées avec un grand succès. Le temps, qui seul fait la réputation des hommes, rend à la fin leurs défauts respectables. La plupart des idées bizarres et gigantesques de cet auteur ont acquis au bout de deux cents ans le droit de passer pour sublimes ; les auteurs modernes l’ont presque tous copié ; mais ce qui réussissait chez Shakespeare est sifflé chez eux, et vous croyez bien que la vénération qu’on a pour cet ancien augmente à mesure que l’on méprise les modernes. On ne fait pas réflexion qu’il ne faudrait pas l’imiter, et le mauvais succès de ses copistes fait seulement qu’on le croit inimitable. »
Ces lignes viennent d’un auteur de théâtre français dont la célébrité des pièces auprès de la postérité se passe de commentaire, mais qui joue un rôle fondamental dans notre culture, c’est-à-dire dans notre manière de penser. Ces lignes sont extraites des Lettres philosophiques de Voltaire.
Il faut ici bien se représenter le gouffre infini qui sépare le théâtre de Shakespeare, de celui dit « classique français ». Ce dernier a pour but le divertissement d’une aristocratie décadente à la recherche d’émotions fortes. Ni Corneille, ni Molière, ni Racine, ni encore moins Voltaire, ne cherchent réellement à transformer leur public dans le sens politique et humaniste du terme (Molière est particulièrement pessimiste sur la capacité de l’homme à devenir meilleur) ; ils visent seulement à plaire au roi et à ses courtisans. Les règles et le bon goût tant vantés par Voltaire contre Shakespeare, comprennent toute une série de conventions arbitraires qui par principe sont diamétralement opposées à la simple idée d’éduquer le citoyen. Il y a par exemple dans ces conventions les fameuses trois unités – unité du temps, unité de l’espace, unité de l’action – qui enserrent le théâtre dans une véritable camisole de force : comment serait-il possible de transmettre l’idée d’une dynamique historique, comme le fait Shakespeare, si l’action doit nécessairement se dérouler en une seule journée ?
L’ironie omniprésente dans le théâtre de Shakespeare paraît également horripilante du point de vue des règles de convenances du théâtre français. Jamais une comédie de Shakespeare ne sera exempte d’un épisode menaçant de la faire basculer dans une tragédie – Beaucoup de bruit pour rien par exemple. Mais surtout, inversement, on trouvera dans chacune de ses tragédies, aussi noire soit-elle, au moins un épisode grotesque qui viendra, en contrepoint à la pompe et la majesté des « héros » de la pièce, discréditer leurs déclarations – le cas du rôle de Falstaff dans les deux parties de Henry IV étant sans doute le plus célèbre. Bien entendu, ce contrepoint n’est pas gratuit de la part de Shakespeare et vise à provoquer une certaine forme de réflexion dans son public mais, comme on le voit, tout ceci est vulgaire pour un Voltaire.
La forme même de la scène est également révélatrice d’une certaine intention. Il y a dans le théâtre français une scène placée dans le fond d’une salle, donc nettement séparée du public. Au théâtre du Globe de Londres, on peut au contraire voir une scène circulaire placée pratiquement au centre d’un public qui se tient debout. Ce dernier – qui n’est pas constitué de l’aristocratie versaillaise, mais de toutes les couches de la société londonienne – y est plus directement pris à partie par le spectacle. Il y a donc une interaction étroite entre la représentation de la tragédie de l’histoire et les spectateurs. Pour éveiller la conscience politique du public, le dramaturge invite ainsi ce dernier à se projeter par la pensée sur la scène et à se demander ce qu’il aurait fait s’il avait été à la place des responsables politiques acteurs de la tragédie.
Voltaire n’a jamais caché qu’il était opposé à l’éducation de la « canaille ». La connaissance et le pouvoir étaient pour lui réservés à une petite élite. L’on ne sera donc pas étonné de sa haine des humanistes en général et de Shakespeare en particulier. Cependant, il est loin d’être le seul à attaquer l’auteur de Hamlet et de Jules César. Sous couvert d’admirer Shakespeare, d’autres en ont fait alternativement un héros romantique, un existentialiste, un nihiliste, un angoissé, un propagandiste du chauvinisme anglais, un obsédé sexuel, un prête-nom, pire encore : un artiste apolitique. Faisons maintenant table rase de toutes ces absurdités !
La méthode de découverte par l’ironie et l’ambiguïté
Comment l’éducateur humaniste peut-il éveiller chez son élève une capacité de jugement souveraine ou, ce qui est la même chose, un esprit de découverte ? La méthode exposée par Platon dans son Menon consiste à présenter à l’élève un paradoxe, c’est-à-dire plusieurs propositions qui paraissent vraies considérées séparément, mais qui s’avèrent radicalement incompatibles considérées ensemble. Cela signifie évidemment que l’une au moins est fausse, mais comment savoir laquelle ou lesquelles ? Le bon pédagogue ne doit pas donner la solution à cette contradiction, mais doit encourager l’élève à la trouver par lui-même. Pour cela l’élève est conduit à émettre des hypothèses et à les vérifier ou les infirmer. Apprendre, c’est la plupart du temps répéter les préjugés et les erreurs de ceux qui nous précèdent ; découvrir, c’est aller en un lieu où nul n’est allé avant nous – et d’où l’on ne revient jamais vraiment.
Le propre d’une véritable République, c’est de former des citoyens qui pensent par eux-mêmes : jamais ils n’accepteront un pouvoir arbitraire. Cependant, dans la mesure où tous les usurpateurs prétendent exercer un pouvoir légitime et utilisent beaucoup de moyens dans leur propagande, il est nécessaire d’armer le citoyen contre ce type de mensonge. C’est pourquoi Shakespeare ne dira jamais directement que tel roi est bon ou tel roi est mauvais, mais il provoquera la réflexion de son public par des paradoxes, des ironies, des ambiguïtés – par exemple une contradiction entre les paroles d’un roi et ses actes.
Dans quelle mesure peut-on dire si le pouvoir qui s’exerce dans telle société est légitime ou non ? Cette question qui revient sans arrêt d’une manière ou d’une autre dans toutes les pièces de Shakespeare, est d’une actualité particulièrement brûlante à son époque. La scène de la déposition du roi dans Richard II a été censurée du vivant d’Elisabeth 1ère et cette dernière aurait déclaré : « Richard II, c’est moi » car elle avait de bonnes raisons de se sentir menacée par un coup d’Etat. L’une de ces raisons est qu’elle avait été déclarée par son père Henry VIII, à la fois bâtarde et héritière de la couronne d’Angleterre – une contradiction du point de vue des lois, mais pas du point de vue de la manière dont les descendants de Guillaume le Conquérant et des Plantagenets jusqu’à Henry VIII avaient pris l’habitude de respecter les règlements…
La question de la légitimité d’Elisabeth 1ère se pose donc ; mais, dans la mesure où elle n’a pas d’enfant, la question d’un successeur légitime se pose également avec la même intensité. Et ces questions doivent être impérativement résolues, sinon l’Angleterre risque de revoir surgir le spectre des guerres civiles, comme la Guerre des Roses, qui ont ensanglanté son histoire.
La République a horreur du vide
La Guerre des Roses est précisément le décor historique des trois tragédies Henry VI de Shakespeare. Dans ces pièces, la légitimité du roi est mise en question. Et en effet, Henry VI n’est pas un roi légitime, mais – et c’est là l’ironie – pas pour les raisons généalogiques invoquées par ceux qui veulent le renverser et prendre sa place. Il est illégitime à cause de son propre comportement qui ne permet pas d’assurer le bien-être de la société : Henry VI est un roi bienveillant mais faible, et il laisse les querelles se développer autour de lui en refusant de regarder en face les conséquences de son impuissance. On pourrait peut-être dire inversement que c’est sa faiblesse qui rend ces querelles possibles.
Tous les acteurs de la tragédie à l’exception de lui-même sont des criminels qui veulent le pouvoir, et lorsque la guerre se déchaîne, il essaie désespérément de se tenir à l’écart. On le voit méditer au moment où se déroule une bataille à côté de lui dans 3 Henry VI, II, 5 de la manière suivante :
« Je voudrais être mort, si Dieu y consentait –Car dans ce monde tout est souffrance, adversitéO Dieu ! Je crois que je vivrais des jours heureuxSi je n’étais rien de plus qu’un simple bergerS’asseoir sur quelque butte, comme je le fais ici,A graver des cadrans ouvragés, fignolésSur lesquels peut se lire la course des minutes.Voir combien il en faut pour que l’heure soit passée,Combien il reste d’heures pour que le jour s’achève,Combien de jours avant que se termine l’année,Combien d’années un homme, un mortel peut survivre.Cela connu, il reste à répartir les temps :Tant d’heures sont dévolues au soin de mon troupeau,Tant d’heures sont dévolues à reposer mon corps,Tant d’heures sont dévolues à la méditation,Tant d’heures sont dévolues à mon divertissement ;Cela fait tant de jours que mes brebis sont pleines,Tant de semaines pour l’agnelage, pauvres petites !Et tant d’années avant que je tonde les toisons.Ainsi minutes, heures, jours, les mois et les annéesS’écouleraient à faire ce pour quoi ils sont faits,Guidant mes cheveux blancs vers la paix du tombeau.Ah ! Quelle vie ce serait ! Si douce et si plaisante ! »
Ah ! Qu’il est rassurant de se sentir impuissant à empêcher la catastrophe qui vient. Sans doute Shakespeare ne s’adresse t-il pas seulement aux hommes de son temps mais à ceux de tous les temps. Sans doute ce Henry VI est-il aussi pour nous un personnage familier…
Que Shakespeare répond-il à ce vide de pouvoir légitime ? La rêverie du roi est interrompue quelques instants plus tard par l’arrivée sur scène d’un homme portant le cadavre d’un autre :
« Bien mauvais est le vent qui à nul ne profite.Cet homme que je viens de tuer au corps à corpsA peut-être sur lui une poignée de couronnes ;Et moi qui ai ici l’heur de l’en délester,Je peux avant ce soir les perdre avec ma vie,Au profit de quelque autre, comme ce mort au mien.[Il enlève au mort son casque]Que vois-je ? Ah ! Dieu ! Mais c’est le visage de mon père !C’est lui qu’à mon insu j’ai tué au combat.Ah ! Temps funeste, pour enfanter de tels malheurs !A Londres, la presse du roi m’a enrôlé de force,Mais mon père, qui est sujet du comte de Warwick,S’est trouvé, pressé par son maître, lutter pour York. »
Quelques instants plus tard, un autre soldat arrive sur scène avec le cadavre de son fils qu’il vient de tuer dans des conditions similaires. Que fait Henry VI face à ces horreurs que la société s’inflige à elle-même ? Il se lamente sur lui-même :
« Quel roi s’est autant affligé des maux du peuple ?Grand est votre chagrin ; le mien l’est dix fois plus. »
Voila donc une ironie majeure pour le spectateur de la tragédie. Henry VI est apparemment le seul « gentil » de la pièce. Le spectateur est induit à vouloir que quelqu’un intervienne pour sauver la situation, mais ce quelqu’un ne peut pas plus être Henry VI qu’aucun des autres personnages représentés. Il n’y a aucun « héros » dans la pièce, et c’est précisément pour cela qu’il y a tragédie. Est-ce du pessimisme de la part de Shakespeare ? Bien au contraire ! Le dramaturge essaie de provoquer un sentiment de révolte dans l’esprit du spectateur. « Je vous présente les conséquences d’une société peuplée d’irresponsables. » pourrait-il dire. Il n’y a pas de « message moralisateur » au sens formel du terme là-dedans ; l’homme est libre de ses choix dans la vie réelle – être ou ne pas être irresponsable – Shakespeare s’efforce simplement de lui faire prendre conscience que la passivité a aussi des conséquences.
Qui croire lorsque tous mentent ?
Un autre aspect ironique de la question de la légitimité du pouvoir apparaît lorsque plusieurs personnages déclarent simultanément que le « droit » de régner leur revient. Il s’agit même d’une situation très fréquente dans les pièces de Shakespeare. Bien entendu, plusieurs rois ne peuvent être légitimes en même temps. Donc, en cas de dispute, l’un d’entre eux au moins a tort. Oui, mais lequel ? Sur quels critères peut-on donner raison à l’un plutôt qu’à l’autre ?
Il est remarquable que les mots « droit », « honneur », et « fidélité » reviennent sans arrêt dans la bouche de ceux qui prétendent exercer le pouvoir. Chacun s’efforce de démontrer sa légitimité par des arguments logiques formels. Par exemple, l’un dira que c’est à lui que revient légitimement le trône en vertu de la légitimité de ses ancêtres qui ont régné avant lui (ce qui en soi est déjà un gag, puisque Guillaume le Conquérant, l’ancêtre commun des Plantagenets des pièces de Shakespeare, était un bâtard) ; ou alors, il dira que l’autre, celui qu’il veut renverser, est un usurpateur parce qu’il a commis une trahison ou violé le « code chevaleresque ». De telles démonstrations peuvent sembler convaincantes prises séparément, mais l’ironie survient lorsque des démonstrations convaincantes et contradictoires coexistent sur la même scène.
La conclusion qui s’impose alors dans l’esprit du spectateur face à cette accumulation de « démonstrations », ce n’est pas simplement que l’un des personnages doit mentir, mais c’est plutôt que tous mentent certainement et que la vérité se trouve à un autre niveau que celui des discours prononcés. Par ses sens, la vue et l’ouïe, le spectateur perçoit le mensonge ; mais pour accéder à la vérité, il doit chercher au-delà des sens : dans le monde intelligible des idées. L’ironie issue des mensonges qui se confrontent sur la scène de théâtre, provoque le spectateur à chercher la vérité dans sa propre pensée. Une œuvre d’art réussie ne démontre pas, elle suggère.
Comme on le voit, Shakespeare n’a pas le moindre respect pour les têtes couronnées qu’il représente dans son théâtre, car c’est de leurs mensonges que naissent les guerres. L’idée suggérée par Shakespeare (mais jamais énoncée explicitement) c’est que la véritable légitimité d’un dirigeant politique ne s’évalue pas par une démonstration juridique mais par son engagement à défendre le bien du peuple. Si on juge ainsi la légitimité d’un roi par ses actes, alors aucun de ceux que présente Shakespeare n’est légitime (à l’exception toutefois de Henry VII qui n’arrive dans la pièce Richard III que pour arrêter la tragédie).
Temps mécanique

Sur la Figure 1, nous avons représenté la succession de tous les rois d’Angleterre depuis Edouard III jusqu’à Henry VIII, c’est-à-dire la période de deux siècles qui précède immédiatement le temps présent de Shakespeare. Cette période correspond presque exactement à celle qui est couverte par neuf des dix pièces historiques du dramaturge. Nous n’avons pas représenté la période de la dixième pièce, Le roi Jean – un roi qui précède de plus d’un siècle le règne d’Edouard III. Jean a, comme les autres, toutes les caractéristiques d’un Plantagenet (« The very spirit of Plantagenet ») : il a pris la couronne qui, selon le droit d’ainesse, aurait dû « légitimement » revenir à son neveu Arthur de Bretagne dont il s’est ensuite débarrassé, et il a entraîné son pays dans des guerres désastreuses.
Le cas d’Edouard III
Nous avons par contre décidé de représenter Edouard III sur notre chronologie, l’ancêtre commun de tous les monarques qui le suivent, bien qu’il n’apparaisse dans aucune des pièces. En réalité, il définit la dynamique historique que Shakespeare nous représente sur son théâtre, et on peut dire qu’il est en quelque sorte implicitement présent dans toutes ces pièces. Pour comprendre la suite, il est nécessaire de donner ici quelques points de repères le concernant.
Edouard III est l’une des figures clefs du XIVe siècle que les historiens ont appelé par la suite « l’âge des ténèbres ». C’est le siècle de la Grande Peste noire et de la guerre de Cent ans qui a vu en quelques décennies une chute démographique catastrophique en Europe. A l’origine de cette situation se trouvent les manipulations de l’Empire vénitien associé aux banquiers lombards. Venise a bâti sa puissance en organisant des guerres, ou plus précisément en faisant prêter de l’argent à taux usuraire aux rois d’Europe, pour qu’ils se battent entre eux ou qu’ils s’entendent pour partir en croisade. On l’aura compris, le bénéfice du pillage de ces guerres permettait en retour de rembourser les prêts contractés. De leur côté, pour pouvoir rembourser leurs prêts, les rois n’avaient d’autre moyen que de piller davantage, donc de faire davantage de guerres, donc d’emprunter davantage, et ainsi de suite. Les Vénitiens ont ainsi créé une dépendance par l’endettement qui n’est pas sans rappeler les pratiques de banques actuelles et du Fonds monétaire international. Vint un moment où l’un des rois, en l’occurrence Edouard III, se trouva en cessation de paiement. Il en découla le plus grave krach financier de tous les temps jusqu’alors : une faillite en chaîne des établissements prêteurs qui ne pouvaient alors plus être remboursés. La conséquence de cette crise financière fut que l’économie réelle de l’Europe se trouva ruinée – en particulier l’agriculture – et les famines qui s’ensuivirent créèrent les conditions pour de grandes vagues d’épidémies.
Parmi les nombreux autres titres de gloire d’Edouard III figure également celui d’avoir déclenché la guerre de Cent Ans. Il faut cependant reconnaître qu’il a été aidé dans cette entreprise par sa mère, Isabelle de France. Cette dernière a mis son fils sur le trône d’Angleterre en organisant un coup d’état contre son mari, Edouard II, qui fut assassiné dans sa prison par la suite. Isabelle était la fille du roi de France, Philippe le Bel, dont les trois fils moururent sans laisser de descendance mâle. En vertu de la loi salique invoquée en France, Isabelle étant une femme, elle ne pouvait pas régner sur le pays de son père, ni transmettre à son fils de droit sur la couronne française. Cependant, ni la mère ni le fils ne l’entendirent de cette oreille et ils lancèrent l’invasion de la France. Il y eut des victoires historiques et spectaculaires pour l’Angleterre, mais au moment de la mort d’Edouard III, pratiquement tout le terrain avait été repris par les Français…
L’héritage d’Edouard
Les familles qui s’affrontent dans les deux tétralogies historiques de Shakespeare descendent chacune d’un des fils d’Edouard III. Le fils ainé du roi étant mort avant son père, c’est le fils de ce fils, Richard II qui succéda à Edouard III sur le trône d’Angleterre.
Dans la pièce Richard II, l’on voit le roi bannir d’Angleterre son cousin Henry Bolingbroke et le dépouiller pour financer des opérations de guerre. Bolingbroke revient, renverse son cousin qu’il fait plus tard assassiner dans sa prison, et devient le roi Henry IV.
Ce crime d’Henry IV provoque une série de troubles en Angleterre car la légitimité du nouveau roi est contestée par beaucoup de monde, y compris par ceux qui l’ont aidé à prendre le pouvoir. Ces évènements qui empêchent Henry IV de partir en croisade comme il l’aurait souhaité, sont le sujet essentiel des deux pièces Henry IV. Son fils ainé, Henry V, n’arrive pas au pouvoir par un coup d’état mais, à la fin de la seconde pièce, Shakespeare n’a pas pu se priver du plaisir de représenter Henry V se mettant lui-même la couronne sur la tête alors que son père n’avait pas fini d’agoniser sur son lit de mort.
Dans Henry V, le nouveau roi décide de reprendre à son compte les prétentions de son aïeul Edouard III sur la couronne de France et organise une expédition pour relancer la Guerre de Cent Ans. Après la célèbre victoire anglaise à Azincourt, la pièce se termine par le mariage de Henry V avec Catherine, la fille du roi de France Charles VI, et l’accord qu’Henry V succèdera à son beau-père. Cependant, Henry V étant mort avant Charles VI, il n’a jamais été couronné roi de France.
La mort d’Henry V laisse un vide de pouvoir, d’autant plus que son fils Henry VI n’est alors qu’un bébé. C’est l’occasion pour toutes les anciennes haines de remonter à la surface et les seigneurs d’Angleterre s’entredéchirent dans une lutte d’influence autour du nouveau roi qui s’avère lui-même très faible arrivé à l’âge adulte. Les conquêtes en France sont de nouveau perdues et la Guerre de Cent ans est officiellement finie au milieu du XVe siècle. Cependant la Guerre des Roses qui est le véritable sujet des pièces Henry VI et Richard III, démarre presque immédiatement en Angleterre. Dans cette guerre, deux familles issues d’Edouard III se battent pour le pouvoir : les Lancastre, ou la Rose rouge, qui sont la famille d’Henry VI, et leurs cousins York, la Rose blanche, qui contestent la légitimité des descendants du régicide Henry IV, donc d’Henry VI.
Le duc d’York est tué dans cette guerre, mais son fils aîné finit par renverser son cousin Henry VI et le faire assassiner. Il devient ainsi le roi Edouard IV. Débauché, il meurt de la syphilis quelques années plus tard alors que son fils Edouard V est encore un enfant. Ce dernier est rapidement déposé par son oncle Richard prétextant que la vie dissolue d’Edouard IV « prouve » que ce dernier n’est pas un vertueux Plantagenet mais un bâtard (Richard fait peu de cas de la vertu de sa propre mère), et que par conséquent son fils Edouard V n’est pas légitime. Le nouveau roi Richard III fait discrètement disparaître son neveu. Cependant c’est un tyran détesté et son règne est de courte durée. La pièce Richard III s’achève par sa défaite face à la coalition conduite par Henry Richmond, un lointain cousin des Lancastre. Richmond se fait aussitôt couronner roi Henry VII, épouse la fille d’Edouard IV, Elisabeth d’York et, réunissant ainsi les deux Roses, arrête définitivement la guerre civile.
Dans sa dernière pièce, Henry VIII du nom du fils qui succède à Henry VII, Shakespeare critique ouvertement le fondateur de l’église anglicane responsable de guerres de religions. Ici le dramaturge prend des risques personnels, car il ne s’agit plus d’un passé ancien – la guerre de Cent Ans ou la guerre des Roses – mais bel et bien d’un passé qui touche à son présent. La seconde fois qu’Henry VIII fut jouée, la représentation fut arrêtée par l’incendie du Théâtre du Globe…
Une anomalie dans la chronologie
Nous avons présenté la chronologie ci-dessus, de manière à faire paraître certaines caractéristiques communes à ces Plantagenets concernant leur sens de la solidarité familiale et leur respect de la vie humaine. Il est remarquable que ces princes qui prétendent régner sur la société de leur temps, semblent se comporter comme des sujets très obéissants d’une certaine « tradition familiale », ou d’un certain « principe de la tragédie », qui les dépasse tous. Faisons un pas de plus dans cette direction en nous intéressant d’un peu plus près à la tétralogie Henry VI-Richard III.
La période couverte par cette tétralogie sur la guerre des Roses représente plusieurs décennies, d’où le fait qu’aucun des personnages intervenant au début ne vive suffisamment longtemps pour connaître la fin. Et pourtant, il subsiste quelque chose qui fait que la guerre se perpétue mécaniquement au-delà des disparitions successives de ses protagonistes individuels. Ce « quelque chose » est déjà présent avant que la guerre commence, puisque lorsque le duc d’York décide de lancer son opération contre son cousin Henry VI, la zizanie règne déjà parmi tous les dignitaires du régime.
On peut dire que tout semble clair au début, que la guerre oppose deux clans bien définis, les York et les Lancastre ; mais en réalité, cette séparation disparaît sans que la mécanique ne s’arrête pour autant. L’acte de tuer devient une fin en soi échappant à tout contrôle, comme on le voit par exemple lorsque le père tue le fils, le fils tue le père, ou lorsque Clifford tue l’enfant de York parce que York a tué le père de Clifford avant d’être tué lui-même par les autres fils de York. L’on voit ensuite des transfuges d’un camp vers l’autre comme Warwick ou Clarence qui après avoir juré « honneur et fidélité » d’un côté, font le même serment de l’autre. On pourrait croire que tout va enfin s’arrêter une fois que les Lancastre ont été anéantis. Pas du tout ! Les York survivants, manipulés par le futur Richard III, s’éliminent réciproquement jusqu’à ce que ce dernier se retrouve seul sur le trône. Et la guerre continue au-delà car, arrivé dans de telles conditions au pouvoir, Richard III ne peut en aucune manière prétendre à la légitimité. La guerre serait donc une fatalité ?
La réponse de Shakespeare – implicite comme toujours – est « non ». Dans la chronologie de la période quasi-continue de deux siècles représentée par les neuf pièces historiques de Shakespeare figure une anomalie remarquable : aucune tragédie ne concerne le règne d’Henry VII. L’explication en est fort simple : Henry VII n’est tout simplement pas un personnage tragique, contrairement à tous les autres. Il arrive justement à la fin de Richard III pour arrêter la tragédie :
« Aux désordres civils, la paix succède enfin.Qu’elle vive longtemps et que Dieu dise « Amen » ! »
Enfant, le jeune Henry Richmond a été mis à l’abri de la Guerre des Roses et son éducation s’est faite dans la France de Louis XI à l’écart de la culture délétère des Plantagenets. Or, malgré toutes les calomnies qui ont circulé sur son compte jusqu’à nos jours, Louis XI a porté un rude coup au féodalisme en créant le premier Etat-Nation de l’histoire. Avec l’Etat-Nation et la Renaissance, des idées de république et d’intérêt général développées par Socrate et Platon sont traduites pour la première fois en termes politique et économique. Inspiré par Louis XI, Henry VII décide à son tour de rompre le cycle infernal du féodalisme et de créer un Etat-Nation en Angleterre. Shakespeare est lui-même l’héritier des réseaux humanistes associés à Henry VII et favorisés par lui.
Le principe de la tragédie
Une question politique très importante doit être soulignée ici. La tragédie se produit dans la société parce qu’il y a dans la culture ambiante de celle-ci une certaine « tradition », une certaine « opinion publique » qui la détruit. La tragédie est empêchée parce qu’un individu ose prendre la responsabilité de s’opposer à cette tradition – ce qui lui impose bien entendu d’être relativement seul à un moment donné face à l’ensemble de la société. Par contre la tragédie ne se produit pas parce qu’un individu serait suffisamment maléfique pour en créer les conditions à lui tout seul. Ce n’est pas un individu qui crée la tragédie, c’est la société dans son ensemble qui s’autodétruit. Cependant, celui qui décide seul de sortir du troupeau devient une source d’inspiration pour les autres.
Tout ceci est parfaitement illustré dans Richard III et en particulier dans les scènes qui précèdent la bataille finale. Henry Richmond et Richard III y sont représentés de manière parfaitement symétrique dans leurs camps respectifs. Ils s’endorment en même temps et les fantômes des victimes de Richard III viennent tour à tour les visiter dans leurs rêves. A Richard III ils annoncent la défaite, « Désespère et meurs ». A Richmond, ils apportent leur soutien.
Il semblerait à première vue que Shakespeare veuille signifier que Richard III soit la personnification du mal absolu, l’unique responsable de toutes les horreurs qui se sont produites dans les scènes et les pièces précédentes. En réalité, il n’en est rien, comme cela apparaissait déjà dans ce que nous avions écrit ci-dessus. Richard III est certes un individu horrible, mais il joue ici le rôle de bouc émissaire en qui se concentrent toutes les fautes de la société. A y regarder de près, on se rend compte qu’aucun des fantômes qui viennent le maudire et réclamer justice ne peut se prétendre innocent. Plusieurs de ces fantômes comme le cas extrême de Buckingham ont été ses complices d’une manière ou d’une autre avant d’être éliminés par lui. Lady Anne par exemple, la femme de Richard III, pourrait-elle sérieusement prétendre qu’elle ne savait pas quel monstre il était avant de l’épouser, comme elle l’exprimait au premier acte avant de se laisser séduire ? Dans Richard III, comme dans toutes les autres pièces, ce n’est donc pas simplement le tyran qui est coupable, mais ce sont tous les autres qui l’ont aidé ou qui l’ont laissé faire.
On voit donc clairement sur cet exemple que Shakespeare ne s’adresse pas seulement aux dirigeants politiques de l’époque de Richard III ou de la sienne, mais à tous les hommes de tous les temps.
Ironie et temps relatif
Comme on l’a vu, tous les rois représentés par Shakespeare, à l’exception de la brève apparition d’Henry VII, sont tous déterminés par l’extérieur, par la culture ambiante de la société dans laquelle ils vivent – au lieu de se déterminer eux-mêmes. C’est exactement ce qu’exprime le pauvre Henry VI dans le monologue que nous avons cité ci-dessus. Il se place lui-même dans un temps qui organise l’activité humaine, et de ce point de vue il n’est pas différent des autres. Dans une telle perspective l’homme est bien évidemment incapable de changer le monde dans lequel il vit.
Sans commettre d’anachronisme, on peut donner d’autres noms à ce temps qui détermine l’action : le temps des horloges, le temps mécanique, le temps absolu, ou encore le temps cartésien. Ici la cause d’un évènement se trouve dans l’instant précédent. Cependant, depuis les travaux de Leibniz en dynamique et sa réfutation de Descartes, les physiciens ont appris des philosophes et des poètes que ce n’est pas le temps qui détermine l’action, mais au contraire, l’action qui détermine le temps. Ici l’action est la cause commune de toute la séquence des évènements qui se succèdent. Leibniz n’est pas le premier à avoir découvert la relativité du temps, bien qu’il ait apporté une contribution majeure dans ce débat. Avant lui, Shakespeare avait parfaitement compris l’enjeu de cette question. Illustrons cela par un exemple.
Articulation entre Henry V et Henry VI
L’on ne connaît pas la date précise de l’écriture des différentes pièces de Shakespeare à cause des usages de l’époque : les textes étaient sans arrêt remaniés par les auteurs et même par les acteurs, et n’étaient donc pas systématiquement publiés. Cependant, on sait que les deux tétralogies Richard II-Henry IV-Henry V et Henry VI-Richard III, n’ont pas été écrites dans l’ordre correspondant à la chronologie des évènements historiques représentés, mais dans l’ordre inverse. Les pièces de la tétralogie Henry VI-Richard III sont parmi les plus anciennes œuvres connues du dramaturge, mais un certain nombre de points obscurs subsistent encore.
Tout d’abord les historiens ne savent pas ce qu’a fait Shakespeare entre l’âge de 20 ans (1584) et l’âge de 28 ans (1592). On sait qu’au terme de cette période, il est depuis quelque temps un auteur connu à Londres, et qu’il a déjà écrit et joué, au moins dans une première version, des pièces de Henry VI-Richard III. On sait par ailleurs qu’il n’a pas écrit cette tétralogie tout seul – ce qui est aussi dans les usages de l’époque – comme le montrent des faiblesses évidentes de la première pièce 1 Henry VI (en particulier, les scènes sur Jeanne d’Arc ne seraient pas de lui). Il semble évident que pendant cette période obscure il a fréquenté des milieux instruits qui lui ont donné accès à une bibliothèque et à des connaissances qu’il ne peut pas avoir tirées seulement de ses premières années de formation.
A bien y réfléchir, ce manque de connaissance qu’on a sur cette partie de sa vie n’est pas vraiment surprenant. Sans supposer que Shakespeare fut ou non catholique lui-même, il est connu que le catholicisme était dans sa famille et dans les milieux qu’il a fréquentés au cours de sa carrière. Il est évident compte tenu de la persécution des catholiques sous Elisabeth 1ère dans une époque de guerre de religions, que si Shakespeare a été recruté par des réseaux humanistes œuvrant pour la paix religieuse, une certaine clandestinité lui était nécessaire pour des raisons compréhensibles de sécurité.
Les remarques précédentes sont nécessaires pour montrer que la tétralogie Henry VI-Richard III est le fruit mûrement travaillé d’un projet politique collectif et que les spectateurs qui assisteront quelques années plus tard à l’autre tétralogie, et en particulier sa dernière pièce Henry V, auront gardé celle-ci en mémoire. Ceci est d’ailleurs confirmé par le chœur qui conclut Henry V en s’adressant au public, lui rappelant que les désastres ayant succédé au règne d’Henry V ont déjà été représentés sur « notre scène », un peu comme s’ils avaient déjà eu lieu avant Henry V du point de vue du spectateur. Ce qui suggère, par une sorte d’inversion temporelle, que les causes de la catastrophe du règne d’Henry VI sont déjà en germe dans le règne d’Henry V ! Le temps de la causalité n’est pas celui de l’horloge. Ceci est capital pour saisir l’ironie shakespearienne, car la pièce Henry V qui a toutes les apparences d’un éloge vibrant du vainqueur d’Azincourt en est en réalité une critique sans concession de l’auteur d’une pure guerre d’agression. Mais tâchons d’étoffer un peu plus ces affirmations.
Contraction temporelle
Le but du dramaturge est d’induire le spectateur à rechercher activement les causes des évènements qui lui sont représentés. A supposer qu’une représentation « objective » de l’histoire soit humainement possible – ce qui n’est évidemment pas le cas – elle ne serait, en fait, même pas souhaitable. Car les relations de causalités qui existent entre ces évènements ne sont pas directement perceptibles par l’usage passif des sens. Pour que le dramaturge puisse résoudre ce problème, il devra nécessairement faire des choix subjectifs de ce qu’il représente, rapprocher des évènements éloignés dans une même scène, ce qui lui impose de violer allègrement le point de vue du temps mécanique. Trahison de la réalité historique ? Pas du tout, bien au contraire, car la seule manière dont dispose l’être humain pour découvrir la réalité des causes c’est précisément cette méthode de l’hypothèse.
Dans le prologue de Henry V, le chœur expose cette « contraction temporelle » au spectateur – procédé que non seulement Shakespeare va utiliser dans la pièce qui suit, mais en fait qu’il a utilisé systématiquement dans tous ses travaux antérieurs :
« Qu’un seul homme pour vous en représente mille,Et l’imagination vous créera une armée !Quand nous parlerons de chevaux, voyez-les en espritImprimer leurs fiers sabots sur le sol ameubli,Car ce sont nos pensées qui doivent vêtir nos rois,Les porter ça et là, enjambant les époques,Réduisant ce qui fut l’œuvre de mainte annéeAu laps d’un sablier. »
Remontons alors de quelques années en arrière dans le temps du dramaturge, au moment où commence 1 Henry VI. Lorsque démarre la pièce, tous les dignitaires du régime sont rassemblés autour d’un cercueil et déplorent la mort de « Henry V, ce roi trop glorieux pour vivre vieux ». Chacun y va de son éloge : « C’était un roi qu’avait béni le Roi des rois. », etc. Immédiatement éclate une dispute entre les différents protagonistes de la scène. Un cartésien en déduirait mécaniquement que l’ordre régnait tant que le roi vivait, mais que son absence crée le désordre. Cependant, des messagers arrivent de France porteurs de mauvaises nouvelles :
« Le Messager. – Honorables seigneurs, longue vie à vous tous !Bien triste est le message que j’apporte de France,De pertes, de massacres et de déroute complète :La Guyenne et Compiègne, Rouen, Reims, Orléans,Paris, Gisors, Poitiers, nous avons tout perdu.Bedford. – L’ami, que dis-tu là, devant le corps d’Henri ?Parle bas ! S’il entend qu’on a perdu ces villes,Arrachant le plomb du cercueil, il va surgir.(…)Exeter (au messager). – Comment ont-elles été perdues ? Par quelle traîtrise ?Le Messager. – Pas par traîtrise : par manque d’argent et de soldats !Voici les bruits qui se murmurent parmi la troupe :Qu’ici vous entretenez des factions rivalesEt qu’alors qu’il faudrait dépêcher une arméeEt se battre, vous en êtes au choix des généraux.(…)2e Messager. – Seigneurs, voyez ces lettres, pleines de calamités.La France entière se soulève contre les Anglais,A part quelques bourgades dénuées d’importance.On a couronné roi le dauphin Charles à Reims.(…)3e Messager. – Gracieux seigneurs, il me faut ajouter aux larmesQu’ici vous répandez sur le cercueil d’Henri.Sachez qu’un combat effroyable a opposéLe valeureux seigneur Talbot et les Français.Winchester – Ah bon ! D’où Talbot est sorti vainqueur n’est-ce pas ?3E Messager. – Oh ! Non ! Où Talbot a subi la défaite.(…) »
Il serait difficile de contracter davantage le temps que dans ces quelques lignes. Henry V est mort en 1422, Charles VII a été couronné à Reims en 1429, la bataille de Patay où Talbot a été fait prisonnier a été livrée la même année, et la Guyenne fut perdue par les Anglais lors de la bataille de Castillon en 1453. Ainsi tous les fruits de l’invasion de la France sont comme anéantis d’un coup quand la pièce commence. Le parti pris du dramaturge semble donc clair : il serait difficile pour le spectateur d’imaginer que les processus conduisant à ces défaites annoncées devant le cercueil aient pu se développer en seulement quelques heures. Autrement dit les véritables causes de ces catastrophes – qui ne sont pas énoncées par les personnages, mais sur lesquelles le spectateur est invité à réfléchir – sont à rechercher non pas après, mais pendant le règne d’Henry V !
Ainsi, pour juger d’une dynamique historique et politique, il ne faut pas seulement s’intéresser à la manière dont les évènements s’enchaînent immédiatement (mécaniquement) les uns aux autres, mais se placer dans le temps de tous les temps pour avoir une vision longue. On ne peut pas simplement juger d’un évènement hors de son contexte général.
Cette remarque vaut également pour la manière de comprendre une pièce de Shakespeare. En fait, pour percevoir l’intention de Shakespeare dans l’une de ses pièces, il faut au moins connaître toutes les autres. Ceci est très important lorsque l’on aborde l’étude d’Henry V qui est la dernière dans l’ordre d’écriture, et la plus achevée des huit pièces des deux tétralogies. En traitant le sujet de ce roi qui a relancé la guerre de Cent ans, Shakespeare s’attache à détruire un mythe particulièrement tenace dans la culture féodale de son temps : Henry V était un tueur rendu très populaire à l’époque de Shakespeare par un autre tueur Henry VIII pour des raisons de propagande personnelle – triste ironie lorsque l’on pense que le véritable héros de l’histoire de l’Angleterre n’était autre que le père d’Henry VIII.
L’idée que la pièce Henry V soit écrite pour faire l’éloge de l’auteur d’une guerre d’agression n’est rien d’autre qu’une fraude grossière qui ne résiste pas à un examen sérieux. Le fait est que de telles fraudes ont été commises à plusieurs reprises. Un exemple : quelques mois avant la première guerre d’Irak sous la présidence de George Bush senior, le cinéaste Kenneth Branagh a filmé sa propre version d’Henry V dans un but de propagande militaire, en supprimant délibérément certaines scènes contredisant une telle interprétation. Une intention diamétralement opposée à celle de Shakespeare.
Shakespeare à l’assaut de la culture féodale
Henry V réfuté par lui-même
L’on voit dans Henry V un roi préoccupé à plusieurs reprises de donner les apparences que sa guerre est juste et légitime : manifestement il n’en croit rien lui-même, mais il est important pour lui d’entretenir cette illusion, s’il veut bénéficier du soutien sans faille de ses collaborateurs. Certains de ses arguments sont réfutés par des ironies de la pièce elle-même, mais il en est un, le principal, qui est réfuté par une ironie « extérieure ».
Pour justifier sa guerre, Henry V reprend à son compte le même argument formel que son aïeul Edouard III : comme Edouard III est le seul descendant en ligne directe du roi français Philippe le Bel par sa mère Isabelle, et comme l’on peut montrer que dans certains cas de leur histoire, les Français ont permis que leur couronne soit transmise par une femme, alors il n’est que « justice » que de leur déclarer la guerre pour reprendre la couronne. Henry V étant l’héritier direct d’Edouard III, il est donc, pour les mêmes raisons le roi « légitime » de la France.

Cependant, le duc d’York déclare dans Henry VI, que c’est lui le roi légitime de France et d’Angleterre et non pas le fils d’Henry V. Son raisonnement s’appuie sur la Figure 2. Nous avons représenté sur cette généalogie quatre fils d’Edouard III dans l’ordre du plus vieux au plus jeune en allant de gauche à droite. L’ainé, Edouard « le Prince noir » transmet la couronne de son père à son fils Richard II. Ce dernier est renversé et assassiné par son cousin Henry IV le fils de Jean du Gand de qui sont issus les Lancastre. Les York sont des descendants d’Edmond, lui-même plus jeune que son frère Jean. En conséquence, par le droit d’ainesse, ce sont apparemment les Lancastre qui héritent de la couronne d’Angleterre (et de France) plutôt que les York. Oui mais si l’on admet comme Henry V que la couronne se transmet aussi par les femmes, alors il faut tenir compte de Lionel, un autre fils d’Edouard III, plus âgé que ses frères Jean et Edmond, et qui a eu une fille, Philippa. Il se trouve que le duc d’York descend également de cette Philippa. Ainsi, en appliquant le même raisonnement par lequel Henry V revendique la couronne de France, York « prouve » que les Lancastre en général et Henry V en particulier ne sont pas légitimement rois d’Angleterre… ni de France.
Imaginez maintenant ce qui se passe dans l’esprit d’un spectateur londonien qui assiste à la première représentation d’Henry V dans laquelle il est question de « droit », de « justice » de « légitimité », et qui a en mémoire une représentation antérieure d’Henry VI…
L’éducation du prince
L’idée de république, telle qu’elle se développe au moment de la Renaissance, repose sur l’éducation du citoyen. Pour un humaniste vivant dans une époque féodale, imaginer qu’un tel projet puisse voir le jour, demande comme première condition que la société soit dirigée par des individus eux-mêmes éduqués – ce qui n’allait absolument pas de soi avant Louis XI et Henry VII. L’éducation du prince est donc l’une des priorités majeures des humanistes dès la fin du XVe siècle. Cependant, un paradoxe se pose pour Shakespeare et ses associés : bien qu’Henry VII ait veillé à ce que ses enfants soient éduqués et conseillés par les plus grands humanistes de l’époque, comme Thomas More, le règne d’Henry VIII est une catastrophe. Pour avoir osé s’opposer sans compromis à la corruption morale d’Henry VIII au moment du schisme anglican, Thomas More a été exécuté. Henry VIII a préféré les conseils de ceux qui savaient le manipuler en flattant son hédonisme. Comment est déterminé le caractère d’un futur monarque ? C’est une question fondamentale posée de manière ironique par Shakespeare dans Henry IV.
Dans les deux parties d’Henry IV, le prince qui joue le rôle de reflet pour Henry VIII n’est autre qu’Henry Monmouth, le futur Henry V. Or, où va-t-il chercher à former son caractère ? Il va s’encanailler auprès d’une bande de voleurs et d’ivrognes dirigés par un chevalier particulièrement lâche : Sir John Falstaff. Bien entendu, lors de son premier monologue, le prince Henry explique au spectateur que tout ceci n’est qu’un jeu, qu’il fait semblant d’être le complice de leurs rapines pour mieux les étudier, mais qu’intérieurement il reste vertueux et que sa vertu paraîtra d’autant plus admirable lorsqu’il aura jeté le masque, qu’il semblera avoir changé aux yeux de tous :
« Ainsi quand je dépouillerai cette conduite dissolue,Et je payerai ma dette sans m’y être engagé,D’autant je deviendrai meilleur que ma parole,D’autant je déjouerai les pronostics des hommes ;Et tel l’éclat d’un métal sur un fond de teinte sombre,Ma régénération éclipsant toutes mes fautes,Se montrera plus belle, plus attrayante pour l’œil,Que celle sans repoussoir qui la mette en valeur.J’utiliserai mes fautes pour faire mon salut,En rachetant le temps quand on n’y croira plus. »
Curieuse conception de la vertu qui a besoin de se cacher pour mieux apparaître ! La question se pose de savoir si Henry Va vraiment apprendre la vertu en fréquentant des débauchés. Va-t-il étudier la nature humaine auprès de Falstaff et en tirera-t-il un enseignement utile lorsqu’il deviendra roi ? Ou ne risque-t-il pas plutôt « d’apprendre » à se faire manipuler tout en s’imaginant manipuler les autres ? La réponse définitive à ces questions se trouvera bien sûr dans Henry V.
Il y a cependant dans Henry IV un certain nombre d’indications qui ne laissent rien présager de bon pour la personnalité du futur roi d’Angleterre. On y trouve en particulier un face à face permanent entre le prince et Falstaff. Or il apparaît que dans leurs joutes oratoires, par exemple lorsque Henry s’efforce de coincer Falstaff en essayant d’exposer sa lâcheté devant l’auditoire, le gros chevalier réussit toujours à lui glisser entre les mains comme une anguille. Le cas extrême de cette situation, c’est lorsque, après qu’Henry eut tué « Hotspur » le chef de l’armée ennemie au cours d’un combat singulier alors que Falstaff faisait le mort juste à côté, ce dernier resté momentanément seul à coté du cadavre de l’ennemi, réussit à se faire passer pour le vainqueur de ce combat sans qu’Henry, pris de court, ne trouve rien à répondre à cela.
De manière plus grinçante, l’on voit Henry ordonner à Falstaff de lever des troupes pour aller à la bataille. Que fait Falstaff ? Il enrôle de force tous les malheureux, vagabonds et simplets qu’il trouve sur son chemin sachant parfaitement qu’ils sont incapables de se battre et qu’ils seront massacrés à la première occasion – ce qui arrive d’ailleurs un peu plus loin. Henry s’en rend compte au premier coup d’œil sur les « troupes » de Falstaff, mais le laisse faire. Ceci en dit long sur la capacité du futur Henry V à mener une « guerre juste ».
Enfin le grand jour arrive, Henry IV meurt et son fils monte sur le trône. Falstaff accourt espérant que grâce à l’amitié du nouveau roi, il va devenir l’un des personnages les plus importants du royaume. Hélas pour lui, Henry V le rejette et il ne lui reste plus qu’à se laisser mourir de désespoir. Bien entendu, Henry V avait annoncé ce changement dans les apparences au moment de son premier monologue, mais pourquoi a-t-il rejeté Falstaff de la sorte ? Est-ce parce qu’il a jeté le masque de la débauche pour montrer sa vertu ? Ou n’est-ce pas plutôt parce qu’il vient d’enfiler le masque de la vertu et que la présence de Falstaff pourrait le faire tomber ?
Le prince devenu roi
Les deux premières scènes du premier acte d’Henry V montrent discrètement le mensonge sur lequel toute la tragédie va être bâtie. Dans la première scène, l’Archevêque de Cantorbéry et l’évêque d’Ely discutent avec inquiétude d’un projet de loi en discussion qui vise à taxer les possessions de l’Eglise en Angleterre au bénéfice de la couronne. Heureusement, reconnaissent les deux prélats, le jeune roi est un ami sincère de la sainte Eglise contrairement à ce qu’avaient laissé présager ses anciens écarts de jeunesse. Si on lui propose donc un autre projet lui permettant des rentrées plus importantes, il n’y aura aucune difficulté à lui faire rejeter celui-là. Le contre-projet en question concerne bien évidemment la possession de la couronne de France.
Dans la seconde scène, les deux ecclésiastiques se retrouvent face à la cour et le roi leur demande si une invasion de la France, qui tuerait des milliers de personnes, serait une guerre juste. Ils le « rassurent » alors et lui expliquent que la couronne française lui revient « de droit » en s’appuyant sur l’argumentaire d’Edouard III mentionné ci-dessus dont nous avons vu ce que le public de Shakespeare pouvait en penser. Ces deux hommes qui avaient un intérêt très personnel à trouver de bons arguments pour « prouver » au roi la « justice » de son projet n’apparaîtront plus dans le reste de la pièce. Et le roi qui ne demandait que cela pour sauver les apparences, n’a aucun problème à se laisser convaincre.
De même, en d’autres temps, Henry VIII n’aura pas non plus beaucoup de mal à se laisser convaincre par des prélats ambitieux, que la « loi divine » lui impose de se séparer de sa première femme.
La dernière scène du dernier acte d’Henry V annonce le mariage du roi avec Catherine de France. La paix serait-elle fermement établie par cet acte de réconciliation, comme cela était le cas à la fin de Richard III par le mariage d’Henry Richmond et d’Elisabeth d’York ? Ceci est immédiatement contredit dans les derniers mots de l’épilogue prononcé par le chœur :
« Peu d’années mais, de cet astre d’AngleterreCe peu vit la grandeur. Forgée par la FortuneSon épée conquit le plus beau jardin de la terreDont il laissa son fils l’impérial suzerain.Henry VI, au maillot couronné roi d’AngleterreEt de France, à ce monarque succéda, mais tantDe gens eurent la direction de son étatQu’ils perdirent la France et mirent l’Angleterre en sang,Ce que notre scène a souvent représenté,En souvenir de quoi, que votre aimable espritAccorde bon accueil à ce spectacle-ci. »
Ces dernières lignes montrent la différence fondamentale qui existe entre la fin des deux tétralogies. A l’évidence, le spectateur qui assiste à la fin d’Henry V se rappellera de la fin de Richard III : les deux finissent apparemment par un mariage qui scelle la réconciliation entre deux camps ennemis. Cependant la différence est de taille. Le mariage d’Henry VII et d’Elisabeth York conclut une guerre juste ; celui d’Henry V et de Catherine de France conclut une guerre d’agression. On ne peut pas établir une paix durable sur la base d’une agression.
Conclusion
Les humanistes du XVIe siècle ne sont pas parvenus à empêcher les guerres de religion. A la mort de Shakespeare, les bases sont jetées pour ce qui va devenir l’Empire britannique – héritier de la tradition vénitienne de « diviser pour régner ». Shakespeare et ses associés auraient donc échoué dans leur rêve de république universelle ? Si l’on se place du point de vue du temps mécanique, on serait sans doute tenté de répondre « oui », mais l’univers dans lequel nous vivons n’est pas mécanique. La guerre dans laquelle Shakespeare s’est engagé ne s’est pas arrêtée au moment de sa mort. Les idées de Shakespeare ont traversé le temps et ont permis à Lincoln de gagner une bataille décisive dans la même guerre. Lincoln est mort à son tour, mais ses idées ont survécu et la guerre s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui. Il est encore trop tôt pour dire si Shakespeare et Lincoln ont gagné ou perdu. La suite dépend de nous ici et maintenant.
Annexe : Macbeth piégé par le temps des horloges
Dans Macbeth, Shakespeare invite son spectateur à réfléchir sur les « ancêtres » d’un roi écossais qui arbore « un globe double et un triple sceptre ». Il s’agit bien entendu d’une référence au roi d’Ecosse Jacques Stuart, devenu en 1603 le roi d’Angleterre Jacques 1er. Tout comme les personnages de la pièce, Macbeth et Banquo, Jacques 1er est autant sanguinaire que superstitieux. En effet, ce dernier croit aux sorcières : il a même écrit un traité de démonologie. Quelle est la nature du danger que représente l’arrivée au pouvoir d’un tel homme ? That is the question !
Au début de la pièce, les deux fidèles généraux du roi Duncan, Macbeth et Banquo, rencontrent trois sorcières qui prédisent au premier qu’il sera roi, et au second que ses enfants seront rois. La prédiction qui lui est ainsi adressée décide Macbeth à assassiner Duncan et à prendre le pouvoir par un coup de force. Ceci fait, la prédiction adressée à Banquo lui fait craindre que son règne finira mal. Il décide donc de faire assassiner Banquo et son fils dans une embuscade. Banquo est tué mais le fils de celui-ci réussit à s’échapper. Terrorisé, Macbeth retrouve les sorcières et leur demande de nouvelles prédictions. Hélas pour lui, ces dernières sont très ambigües : d’une part, elles disent à Macbeth de se méfier d’un autre général du nom de Macduff et en même temps que Macbeth n’a rien à craindre de « l’homme qui est né d’une femme », d’autre part elles confirment que la descendance de Banquo aura le pouvoir. Décidé cette fois-ci à ne rien laisser au hasard, Macbeth fait assassiner toute la famille de Macduff, tandis que ce dernier part en Angleterre rejoindre Malcolm, le fils aîné de Duncan, pour lever une armée contre le tyran. Au fur et à mesure que l’armée ennemie avance vers lui, Macbeth s’enfonce dans la folie considérant à la fois qu’il est condamné, et qu’il est invulnérable puisqu’il n’existe aucun homme qui ne soit né d’une femme. Ironie suprême : au moment du combat singulier final entre lui et Macduff, ce dernier lui révèle qu’il a été retiré avant terme du ventre maternel. Démoralisé, Macbeth est tué. La pièce s’achève ainsi sur le couronnement de Malcolm avec la mort du dernier personnage qui savait que la couronne est promise non pas aux descendants de Duncan et Malcolm mais à ceux de Banquo…
Il n’existe peut-être pas d’autre pièce de Shakespeare où la relativité du temps soit présentée de manière aussi brillante. La tragédie qui scelle le destin de Macbeth est que ce dernier est superstitieux : il croit que le temps est mécanique. L’on pourrait rétorquer qu’il a raison de penser cela, puisque les prédictions des sorcières se sont réalisées à la lettre sans lui laisser la moindre chance d’échapper à ce destin mécanique et implacable qui l’écrase. Il y aurait donc à première vue une fatalité objective des évènements historiques contre laquelle l’homme ne pourrait rien.
Évidemment, cette impression est immédiatement contredite dans l’esprit du spectateur par une ambiguïté incontournable : Macbeth est l’instrument volontaire de son propre destin car à tout moment il aurait pu faire mentir les prédictions. Pourquoi pendre le pouvoir alors qu’il sait dès le début que son coup d’Etat entrainera sa perte ? Pourquoi envoyer des tueurs contre Banquo alors que ce n’est pas ce dernier mais ses descendants qui représentent un danger contre lui ? Inversement, pourquoi faire assassiner les enfants de Macduff qui, eux, ne le menacent pas, alors que c’est justement ce crime qui va donner à Macduff la rage pour les venger ? Macbeth croit aux prédictions, il n’essaie pas d’y échapper mais, étant donné qu’elles sont volontairement formulées de manière ambigüe, il tente de les interpréter d’une manière qui lui soit favorable – ce qui est absurde puisqu’il considère par ailleurs qu’elles viennent de puissances maléfiques. Sa folie s’accroît au fur et à mesure qu’il est confronté à la réalité. Le comble est atteint à la fin quand il veut croire qu’il est protégé alors qu’il est seul face à l’armée ennemie. Bref : tout comme pour les autres tyrans des pièces de Shakespeare, bien qu’à des niveaux différents, l’aspect essentiel du caractère de Macbeth est sa stupidité ! C’est là un renseignement politique fondamental que nous livre le dramaturge (et, bien entendu, ce trait ne concerne pas seulement le personnage principal, mais également l’ensemble de la société qui accepte la même manière de penser que lui).
Contrairement à ce que croit Macbeth, le déroulement de l’histoire est une affaire totalement subjective. Ce n’est pas le temps, autrement dit l’enchaînement mécanique des évènements, qui organise l’action de l’homme, mais c’est au contraire l’action de l’homme qui organise l’enchaînement des évènements historiques. Le temps n’est pas un cadre prédéfini dans lequel se produisent les choses ; le temps est plutôt comme la trace des pas qu’un animal laisse dans le sol : c’est la trace de l’action.
Reprenons donc le problème dans le bon sens : les sorcières savent que Macbeth est un imbécile, ce qui signifie que son comportement est mécaniquement prédictible pour qui est capable de se situer dans le temps relatif. Sans la certitude d’être roi que lui donnait la première prédiction, Macbeth n’aurait pas entrepris ses crimes. Autrement dit, il n’y a rien de nécessaire dans l’enchaînement des évènements puisque c’est la prédiction des sorcières qui est la cause première de tout ce qui suit. Et elles n’ont pas fait cette prédiction à n’importe qui : elles l’ont faite à quelqu’un qu’elles savaient manipulable. Un individu réellement créatif ne serait pas tombé dans le piège, car il aurait su que l’homme peut découvrir les lois de l’univers, et à partir de là de changer les conditions extérieures et le cours de l’histoire. Par définition, le comportement d’un découvreur n’est pas mécaniquement prédictible. Par contre, il n’est pas bon pour un adulte de croire aux sorcières…
Ceci nous ramène bien entendu à Jacques 1er. Le premier des Stuart qui règne sur l’Angleterre entretient des relations rapprochées avec bon nombre de personnages douteux. Parmi ces derniers figurent les membres d’une secte vénitienne héritière de Paolo Sarpi et dont le chef de file est le chancelier Francis Bacon. Cette secte s’appelle l’empirisme. Elle a été lancée pour contrer la Renaissance du XVe siècle. Au Moyen-âge, le féodalisme aristotélicien reposait sur le principe que la connaissance ne doit pas être enseignée à la population. Héritière des idées de Platon, la Renaissance prend le parti opposé et provoque l’une des plus grandes révolutions scientifiques de l’histoire. Comprenant que l’aristotélisme est fini, les empiristes néo-platoniciens organisent alors une subversion du platonisme. Pour Sarpi et Bacon, il ne faut pas s’opposer à l’utilisation des avancées de la science, mais il faut les contrôler de manière à étouffer l’esprit de découverte. Le but de la science est de chercher les causes des évènements et de répondre à la question : « Pourquoi ? ». Le but de l’empirisme sera d’empêcher qu’une telle question soit posée. Il décrète donc la recherche des causes comme « hors de portée de l’homme » et qu’il faut se contenter de décrire mathématiquement les évènements sans les comprendre : c’est-à-dire répondre seulement à la question : « Comment ? ».
Naturellement ce contrôle de la connaissance s’accompagne d’un contrôle politique puisque les deux reposent sur l’abêtissement de l’homme. Ceci explique pourquoi les mots « empire » et « empirisme » sont de la même origine…
Bibliographie
- Shakespeare, Œuvres complètes, Robert Laffont
- Platon, La République, Garnier Flammarion
- Correspondance Leibniz Clarke, Presses Universitaires de France
- Voltaire, Lettres philosophiques, Garnier Flammarion
- Schiller, Marie Stuart, Aubier
- Schiller, Don Carlos, Aubier
- Schiller, Histoire de la révolte qui détacha les Pays Bas de la domination espagnole, Hachette
- Michel Duchein, Elisabeth 1ère d’Angleterre, Fayard
- Peter Ackroyd, Shakespeare, Points
- Keith W. Jennison, The Humorous Mr. Lincoln, Bonanza Books, New York
- Stanley Ezrol, « Will Shakespeare’s Mission Be Ours », Fidelio Vol. XIII, n°3, fall 2004
 COMMENTAIRES
COMMENTAIRES