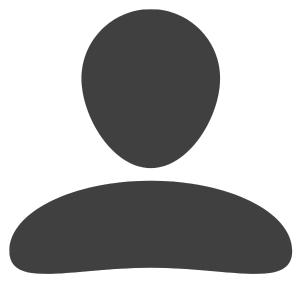Le 17 juin, pour la rédaction de notre mensuel Nouvelle Solidarité, Karel Vereycken s’est entretenu avec l’infirmier David Garcia. Après une analyse des origines du désastre, ce dernier esquisse des pistes intéressantes pour un nouveau paradigme.
Bonjour David Garcia. Merci d’avoir accepté cet entretien. Pour mieux comprendre ce que vous allez nous dire ici, pourriez-vous vous présenter brièvement ?

David Garcia : Bonjour. Je suis infirmier depuis 25 ans et je travaille pour les établissements français du sang dans l’Hérault (34). J’ai exercé mes fonctions à peu près dans tous les secteurs sanitaires et médico-sociaux, sauf dans le secteur libéral où je n’ai pas souhaité le faire. J’ai pu exercer au sein de la fonction publique hospitalière, j’ai une expérience de 10 ans cumulés dans différents services d’urgence. J’ajouterais que j’ai travaillé un peu partout en France, en Région parisienne, à Marseille (quartiers nord et centre ville) et aussi dans le Cher. J’ai travaillé également en établissement privé, établissements médico-sociaux de type EHPAD ou maisons d’accueil spécialisées, dans le secteur du handicap. J’ai été deux ans infirmier contractuel de l’Education nationale, avec des missions d’infirmier scolaire dans les établissements de second degré et auprès des écoles.
De quoi se familiariser avec tous les étages des systèmes de soin proposés en France ?
Mon parcours m’a effectivement permis d’apprécier l’ensemble du système de soins français.
Aujourd’hui, les Français s’inquiètent de ce qu’ils découvrent. Martin Hirsh vient de quitter le Titanic. Juste avant l’été, la France se retrouve avec 120 de ses 620 services d’urgence (20 %) dans l’incapacité de fonctionner correctement et cela comprend 14 des 32 plus grandes structures (CHU). Pas besoin de Covid pour voir les plans blancs et les fermetures s’enchaîner. Au CHU de Bordeaux (et d’autres suivront), l’accès aux urgences est désormais « régulé », c’est-à-dire filtré en amont. Pour le chef des services d’urgences de l’Hôpital Avicenne de Bobigny, « il y aura donc des morts ». Confirmez-vous ce tournant dramatique ?
Je le confirme d’autant que j’ai pu le mesurer sur le terrain tout au long de la carrière. Cette crise vient de loin, elle atteint aujourd’hui son apogée. On va effectivement avoir des morts directes ou indirectes du fait du dysfonctionnement de nos services d’urgence, qui sont la porte d’entrée de toutes les personnes qui ressentent le besoin de consulter rapidement pour des problèmes extrêmement différents. C’est une évolution exponentielle depuis 20 ans. Je crois me rappeler qu’en 2000, on était à 10 millions de passages [aux urgences] par an, aujourd’hui on en est à 20 millions. C’est le fait d’une désorganisation du système sanitaire, parce que les patients ont de plus en plus du mal à accéder à un médecin traitant.
Je suis assez d’accord avec André Grimaldi, professeur émérite au CHU Pitié-Salpêtrière et membre du Collectif Inter-Hôpitaux, qui rappelle que notre système de santé est très incomplet, parce qu’en gros, on a deux piliers, la médecine libérale, régie depuis 1927 par la charte de la médecine libérale, et la médecine de ville, et de l’autre côté, le système hospitalier complété par le secteur privé, qui a gagné en parts de marché, aussi bien dans le secteur sanitaire que dans le secteur médico-social, avec en plus des évolutions problématiques comme on a pu le constater avec les affaires Orpéa et Korian, mises en lumière par le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet.
On est donc devant cette évolution, et aussi devant le fait qu’il est difficile à certaines heures, en particulier en nuit profonde mais aussi en fin de soirée, après le travail, d’accéder à un médecin. Si l’on veut faire consulter son enfant parce qu’il a une forte fièvre ou d’autres symptômes, il est difficile d’accéder à un pédiatre. Il existe des services d’urgence pédiatrique, mais ils sont relativement peu nombreux et très dispersés sur l’ensemble du territoire.
Avec les fermetures de centres hospitaliers, dits locaux, et des maternités également, tout cela fait qu’on va engorger les urgences. Dans le même temps, durant ces vingt dernières années, s’est accéléré le virage libéral de l’hôpital, le virage marchand de ce qu’on appelle « l’hôpital-entreprise », avec la mise en place de la tarification à l’acte (T2A) : le fait que l’hôpital et les soins doivent être rentables.
Cela a suivi une première évolution dans les années 1970-80, visant à réduire le nombre de médecins avec l’instauration du numerus clausus. Pourquoi ? Parce qu’on a une « offre de soins », qui est exponentielle et génère des dépenses de santé, exponentielles elles aussi. C’est donc pour réduire ces dépenses de santé qu’on va réduire l’offre ! Un raisonnement assez basique, assez libéral ! C’est pour cela qu’on a essayé de limiter l’entrée en première année à la faculté de médecine, avec le numerus clausus. On a essayé de réduire l’effectif par spécialité. C’était dans les années 1970-80.
On a vraiment cru qu’en réduisant l’offre, on aurait moins de malades ?
En fait, comme je le disais tout à l’heure, nous avons un système de santé très imparfait. Jusqu’aux années 2000, on avait un système performant, du fait d’une formation d’excellence, et qui n’était pas encore entré dans la tarification à l’acte : c’était le meilleur du monde. En 20 ans, on a rétrogradé à la dixième place… En réalité, la France a toujours été relativement mauvaise sur le plan de la prévention, de la promotion, de l’éducation à la santé, c’est-à-dire de la « santé publique ».
Pour répondre à votre question, le raisonnement du technocrate était : on va réduire l’offre de soins, donc on va réduire les dépenses de santé. Mais comme on ne s’attaquait pas à la racine du mal, ou très partiellement, les dépenses de santé n’ont fait que croître, d’autant plus qu’elles sont générées par des causes environnementales, par les conditions d’hygiène de vie, notamment pour les populations précaires qui sont les plus éloignées du soin et dont la couverture sociale est très imparfaite.
Il y a aussi la médecine scolaire et celle du travail qui ont été totalement délaissées…
Je dirais plutôt dépouillées peu à peu. Les différents plans de restriction budgétaire ont impacté tous les secteurs, donc effectivement la médecine de travail, et scolaire aussi. Un seul exemple, sur Béziers (34), lorsque j’étais infirmier scolaire, il y avait un médecin pour 13 000 élèves. Je doute fort qu’un médecin puisse voir 13 000 élèves dans une année... C’est pour ça que les missions sont déléguées à des infirmières et infirmiers qui, eux-mêmes, ont un panel d’environ 6000 élèves à voir, ce qui est aussi énorme. On voit bien que ça ne peut qu’être dysfonctionnel. D’un côté, on a une raréfaction de la ressource humaine, avec moins de médecins, mais aussi moins de paramédicaux : infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie et aides à domicile.
Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui s’épuisent énormément au travail, leurs conditions de travail font qu’ils partent. C’est le grand mouvement qu’on l’on constate aujourd’hui après la pandémie. Pourquoi ? Parce que ce sont essentiellement des femmes à qui on demande de sacrifier leur vie professionnelle et personnelle, dans des rythmes de travail inadéquats avec une vie familiale, ou à qui on demande de faire plus de douze heures d’affilée, et cela deux, trois jours de suite ; à qui on demande de travailler la nuit, le week-end, les jours fériés depuis l’instauration de la continuité des soins en 1966. Ce sont essentiellement des femmes qui sont mal rémunérées parce que l’on considère que c’est « une vocation », alors qu’elles exercent une profession, des métiers pour lesquels il faut obtenir une qualification, elles suivent des études, des formations qui sont payantes, pour certaines. On rémunère très mal des personnes absolument essentielles, et ce personnel finit par craquer et par abandonner la profession.
Pour aggraver la saturation des services, on procède à la réduction des lits d’hospitalisation pour basculer sur le virage de l’ambulatoire au profit du privé. Alors certes, le privé a récupéré de grosses parts de marché sur l’ambulatoire, mais tout ce qui est les soins aigus et chroniques, puisque c’est là le cœur du problème aujourd’hui, est laissé aux centres hospitaliers qui, du coup, ne peuvent plus absorber cette masse de patients, ni la repartir sur les lits d’hospitalisation puisqu’on les a réduits.
On est donc dans un système extrêmement dysfonctionnel, qui va vers l’effondrement, avec des conséquences comme celle qu’évoque le médecin des urgences de l’hôpital Avicenne : la probable augmentation des décès, directs ou indirects.
Prenons le risque de canicule. On ne sait pas encore comment se passera l’été. On a eu un épisode caniculaire. Va-t-on en avoir d’autres d’importance, durant tout l’été ? On n’en sait rien. Si c’est le cas, ça sera très problématique, parce que pendant une canicule, on ne meurt pas de soif mais essentiellement d’isolement !
Ceci pour dire que de nombreuses causes sociales n’ont pas été endiguées par les différentes politiques des 44 dernières années, ce qui génère des problématiques de santé, dont pas mal de maladies chroniques.
A côté de ce cela, il y a le vieillissement de la population qui entraîne davantage de maladies chroniques, de problèmes de santé. Surtout parce que dans les pays occidentaux, en France notamment, on a ce paradigme où le soin est vu à travers le prisme de la santé : on va consulter lorsqu’on est malade, alors que dans les pays asiatiques et dans certains pays africains, on voit son médecin pour rester en bonne santé.
Il paraît que dans certaines régions chinoises, si vous êtes malade, vous cessez de payer votre médecin parce qu’il a mal fait son boulot...
En Chine, un médecin qui consulte beaucoup de patients parce qu’ils sont malades, c’est un médecin qui fait très mal son travail et vous ne le payez pas. Vous payez pour rester en bonne santé.
C’est à la fois notre système de protection sociale qu’il faut revoir. La Sécurité sociale est un acquis certain, mais la protection du risque social est très incomplète aujourd’hui.
En gros, on a trois ou quatre branches dans la sécurité sociale. On dit qu’il en manque une. Moi, je dirais qu’il en manque deux. Deux risques ne sont pas pris en compte : l’indépendance ou l’autonomie (selon le point de vue d’où l’on se place), et la mort.
La mort, c’est le risque social de la vie, comme on l’a vu ces deux dernières années. Or elle coûte cher à ceux qui perdent quelqu’un. La mort, aujourd’hui en France, c’est privatisé. On doit faire appel à des pompes funèbres, qui sont privées et dont la plupart ont une délégation de service public. La mort a un coût. Et ça, ce n’est pas pris en charge par la Sécurité sociale.
Quant à l’indépendance, il existe bien la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie, mais ce n’est pas une branche à part entière de la Sécurité sociale. Elle a vu ses budgets réduits ces dernières années et elle n’a pas pleines compétences. Du coup, les missions sont très partielles.
On m’a rapporté que dans l’Hérault, une personne décédée sur sa chaise est restée ainsi 24 heures car il manque de généralistes pour constater le décès.
Absolument. Cette personne est décédée à Mèze, dans sa salle de bain. Son mari a effectivement attendu toute la journée qu’un médecin vienne constater le décès. C’est encore une évolution de la surmédicalisation. Autrefois, les officiers d’Etat civil étaient habilités à faire le constat. Aujourd’hui, il faut un certificat de décès rédigé par un médecin. Si vous n’avez pas de médecin, vous êtes dans un désert médical. Les déserts médicaux, ce n’est pas seulement dans ce qu’on appelle « la diagonale du vide ». C’est 12 % de la population, soit 7 à 8 millions de Français qui n’ont pas de médecin traitant. Cela couvre tous les territoires, aussi bien en ville, avec les quartiers définis comme prioritaires, qu’en zones rurales périphériques. Cela peut aboutir à ce type d’évènement, où l’on doit attendre qu’un médecin vienne constater le décès pour faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui prendra en charge le défunt. C’est effectivement assez traumatisant.
C’est révélateur d’un système de déshumanisation, qui est au-delà du privé ou du public. On est entré dans un monde déshumanisé.
Absolument. Sortons un peu du champ. Les morts de la pandémie, ils sont bien réels, mais on ne les a pas vus, on ne connaît pas leurs noms, on ne sait pas qui c’est... Et pourtant quand les sociologues, les anthropologues, les historiens passeront après nous dans quelques décennies, ce sera un vrai sujet de préoccupation et d’interrogation. Ça l’est déjà pour certains. C’est-à-dire que la mort a été à ce point « invisibilisée » qu’on ne la voit plus, on ne voit que le nombre de morts, mais pas en tant qu’êtres humains. On a fait disparaître la mort de l’espace public et de l’espace privé, et on l’a confiée à l’hôpital. Je vous rappelle qu’en France, 80 % des décès surviennent en institution et 80 % d’entre eux sont des personnes qui meurent seules. Je l’ai vécu personnellement car c’est au cours d’une tournée, quand on entre dans la chambre, qu’on constate le décès. La personne est morte en institution, et seule. C’est un phénomène qui s’est généralisé.
On comprend mieux le dégoût et le découragement des soignants, qui ne quittent pas simplement le public pour le privé, mais abandonnent carrément la profession à cause de cette situation de « travail empêché », un concept sur lequel Jacques Cheminade insiste particulièrement. Forcément, si vous avez une tâche à accomplir et qu’on ne vous donne pas les moyens de le faire dans des conditions optimales, vous vous retrouvez à faire de la maltraitance, alors que vous ne le vouliez absolument pas.
On est dans la maltraitance institutionnelle. Si l’on prend l’exemple d’une aide-soignante qui doit faire 12 toilettes dans la matinée, c’est réellement de l’abattage. Je l’ai vu moi-même, et ça génère une vraie souffrance. Je peux dire de mon vécu que je n’ai vu quasiment que des gens en souffrance, notamment en EHPAD. Les aides-soignantes, à 92 % des femmes, sont dans une grande souffrance parce qu’elles ne peuvent pas pleinement accompagner la personne.
A côté de cela, vous avez des injonctions technocratiques. On vous parle de bienveillance, de bientraitance, d’« humanitude », du care, etc. Or, ces injonctions sont impossibles et empêchées à cause d’une organisation du travail littéralement libérale, qui fait que vous devez faire tant de toilettes dans la matinée, ce qui veut dire que vous avez tant de temps à passer par personne. Ça va jusqu’à fixer le nombre de gants à utiliser, de protections par personne, parce que c’est comptabilisé comme ça. Je dirais presque, et je l’ai vu, que pour laver le visage d’une personne ou le brossage des dents, tout est chronométré ! C’est la dérive qui a été dénoncée chez Orpéa et Korian, où tout est rationalisé, minuté : on n’est plus du tout dans le prendre soin de quelqu’un.
Mon père qui est décédé dans un EHPAD me disait, lorsque je lui rendais visite, qu’il se sentait comme une voiture sur un parking : « De temps en temps on nous fait le plein et d’autres jours, on nous lave. »
C’est une image assez juste. On rationne le nombre de douches comme en prison. Ça devrait vraiment nous interroger. Je rappelle que la France est condamnée tous les ans pour les conditions de vie dans les lieux dit de « privation de liberté » (système carcéral). Aujourd’hui, elle est aussi condamnée pour les traitements infligés aux personnes en établissement de soin. La France est condamnée pour ces conditions indignes. Sont institutionnalisées : deux douches par semaine aussi bien pour le régime carcéral qu’en EHPAD, qu’on retrouve également dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance ou encore dans les maisons spécialisées pour personnes handicapées. On en est arrivé là, à force de tout rationaliser. Les personnes ne peuvent pas prendre de douche tous les jours si elles le souhaitent.
Face à de telles contradictions, à quoi bon mettre des personnels formés à des règles professionnelles déontologiques pour prendre soin des personnes ? C’est intenable. En même temps on ne cesse de nous parler d’éthique, ce qui est juste. C’est bien, mais on ne peut pas parler d’éthique et ne pas donner aux personnes les moyens de remplir leur mission. C’est vrai dans tous les établissements et les services de santé.
En France, à la différence de la plupart des autres pays européens, il n’y a pas de ratio patient/soignant dans le secteur du soin, à part en réanimation. Ce qui fait que vous pouvez avoir tout type de dérives.
A-t-on tenté de calculer les proportions, par rapport à l’Allemagne et à l’Italie par exemple ?
Les autres pays, en fonction des services, ont un ratio autour de 8, 10 ou 12 patients par soignant. Au-delà, c’est illégal. En France vous n’avez pas ça.
On peut avoir une infirmière ou un infirmier pour 50 personnes ?
Oh oui, ça m’est arrivé d’avoir une clinique à moi tout seul ! J’avais 80 résidents dans une clinique privée dite SSR (Soins Suite Réadaptation). J’étais le seul infirmier avec une aide-soignante pour faire tous les changes à 80 patients pendant la nuit...
N’oublions pas le scandale des salaires. Je l’ignorais. Je découvre que selon le code du travail, la prime de nuit pour les heures travaillées de 21h à 5h du matin est de 1,07 € brut de l’heure…
C’est scandaleux quand on connaît l’impact retentissant du travail de nuit sur la santé : troubles du sommeil, prise de poids, déclenchement d’hypertension artérielle, diminution de l’espérance de vie, qui peut aller de 8 à 10 ans. On estime normal que ce soit rémunéré 1 € de l’heure.
Notre ministre de la Santé, Madame Bourguignon [1], ne propose absolument pas de revaloriser les heures de nuit, mais seulement les heures supplémentaires. Mais comme lui a répondu le Dr Christian Prudhomme, le porte-parole de l’Association des médecins urgentistes (Amuf) et délégué CGT : « Qui va aller faire des heures supplémentaires ? On ne trouve plus personne pour en faire ! »
Un seul exemple à Béziers, le cas de cette infirmière, qui se trouvait être la candidate de la NUPES. Une nuit elle s’est résolue à accepter d’effectuer une garde à l’hôpital de Béziers. Or, elle était la 31ème personne que la cadre de santé de garde avait appelée pour venir faire la nuit. La 31ème ! Je crois que cela exprime le profond malaise qui existe dans nos établissements de santé.
Je découvre également que beaucoup de soignants se plaignent des loyers qui sont totalement déconnectés de leurs revenus. Pour avoir un loyer abordable, ils habitent loin et font de longs trajets. On évoque une contractualisation avec les mairies pour libérer des logements à bas prix pour les soignants. Une piste intéressante ?
Oui, ça peut l’être. Il a existé un temps un pool de logements dans les établissements eux-mêmes. Malheureusement ce genre de logements se dégradent assez vite. Je l’ai vécu. Finalement on ne sait pas très bien qui s’en occupe, il n’y a pas d’opérateur fixe identifié, et c’est très difficile à maintenir en état car il y a un gros turn-over. Après, toutes les propositions sont les bienvenues. Cependant, il faudrait déjà payer correctement les soignants et les former sérieusement. Le soin et la santé, c’est un énorme chantier aujourd’hui. Du sol au plafond, il y a tout à refaire.
Pour conclure, quelles mesures préconisez-vous ?
Il y a la formation. Celles aujourd’hui dispensées par l’Institut de formation en soins infirmiers sont obsolètes parce qu’elles sont basées sur un ancien modèle. On continue à former des professionnels, à qui on confie de plus en plus de tâches administratives, en même temps que de soins. Sans oublier le glissement des tâches qui fait en sorte que chaque année, le référentiel des compétences augmente.
Dans le système dit de « Bologne », le système Licence-Master-Doctorat (LMD), la France ne parvient pas à construire des parcours de carrières. On n’a pas une ingénierie qui tient compte des évolutions du monde actuel, en particulier dans la sociologie, à savoir le vieillissement et l’explosion des maladies chroniques. Du coup, on n’arrive pas à construire des parcours de carrière qui soient bien identifiés.
Si vous demandez à des bacheliers : « Quelles sont les filières de la santé ? », aucun ne pourrait correctement vous répondre ! C’est même le cas pour les adultes soignants. Parce que c’est vraiment éclaté en plein de secteurs. Parlons des formations délivrées par les lycées agricoles, privés ou publics, qui viennent d’une ancienne tradition.
On y apprend à faire « du soin » ou « du service à la personne ». Cela donnera des sortes d’aides à domicile et d’auxiliaires de vie pour le milieu rural. Ces établissements, qui dépendent du ministère de l’Agriculture, ne sont pas rattachés à part entière au ministère de l’Enseignement supérieur.
Il est impossible de dire à un bachelier : « Si tu es infirmier, tu as un grade licence, si tu es infirmière anesthésiste ou bloc opératoire ce sera tel master. » On ne sait pas le dire parce qu’on ne l’a pas construit.
Je pense qu’il faut vraiment revoir toute la formation, en la rapprochant du monde universitaire, au sens réel du terme, c’est-à-dire reconstruire une ingénierie complète des métiers de la santé, quitte à en « supprimer » certains.
Pour ma part, je plaide pour la suppression des métiers trop mal payés. Rassurez-vous, je ne veux absolument pas faire disparaître les personnes, mais je voudrais qu’on aille davantage vers le système anglo-saxon, avec des infirmières dites « techniques », pour certaines plus spécialisées dans les soins techniques et d’autres dans les soins à la personne, les soins d’hygiène, de confort, et qu’on puisse effectivement se former en spécialités à part entière.
Cela fait une licence professionnelle avec, comme cela se fait en université, par exemple, un parcours « soins palliatifs », un parcours « maladies chroniques », etc. Qu’on puisse donner le choix. Et si dans votre vie, dans votre carrière, vous désirez acquérir d’autres compétences, vous retournez en formation pour faire le module qui vous manque.
En partant d’un tronc commun ?
Un tronc commun ? La suppression pure et simple du métier d’« auxiliaire de vie », en leur donnant un diplôme d’État, une qualification réelle et surtout des salaires décents ! La rémunération versée aux auxiliaires de vie est proprement indécente, alors que ce sont elles qui font les tâches les plus ingrates (mais qui sont, dans un sens, les plus nobles) auprès d’un public âgé, poly-pathologique, atteints de maladies chroniques, en surpoids – avec une pénibilité du travail qui n’est pas reconnue, il faut le dire aussi.
Vraiment, il y a tout à repenser, urgemment, notamment le fait de la différentiation. Peu de gens en parlent, mais l’idée commence à faire son chemin, notamment chez les premiers concernés – je parle par exemple des pompiers.
Le 15, c’est la plateforme de référence. On appelle le 15 quand on a un problème, on l’appelle pour tout et n’importe quoi, c’est la première porte d’entrée, même pour être admis aux urgences du CHU de Bordeaux, comme on le disait tout à l’heure. Ensuite, c’est le 15 qui a la main pour envoyer tel ou tel service de secours – une ambulance privée, les pompiers, etc. Aujourd’hui, les pompiers font énormément de secours à la personne. Et ça, il faut que ça cesse, car leur métier, c’est de s’occuper de ce pourquoi ils ont été formés : les incendies, les catastrophes naturelles, les accidents de la route et les catastrophes industrielles. Or on les éloigne de leurs missions et ils sont mal préparés. C’est aussi une des raisons de leur désaffection.
Si je vous comprends bien, on a maintenu toute une catégorie de gens dans des activités non qualifiées pour éventuellement les priver d’une juste rémunération ?
Il y a cela, et on a prôné la polyvalence. Mais aujourd’hui, cela dysfonctionne complètement. Si demain, honnêtement, on se trouve face à des gros incendies, avec les périodes de sécheresse que l’on connaît dans le midi de la France, on n’est plus capables de mobiliser, comme autrefois, nos unités de sécurité civile. Je me souviens que quand j’ai commencé ma carrière, les gradés nous parlaient du danger qu’ils voyaient arriver : « On va nous dépouiller de nos missions, on va nous enlever nos budgets, et finalement, on va perdre notre savoir-faire. »
Dans les années 1980, les unités de sécurité civile françaises étaient reconnues dans le monde entier ! On a été appelé sur toutes les grandes catastrophes : le tremblement de terre de Mexico, les grandes inondations en Colombie qui avaient entraîné des éboulements de terrain, on était appelé partout. Avec un savoir-faire reconnu mondialement.
Aujourd’hui, nos unités de Sécurité civile sont maintenues sur le territoire parce qu’elles sont le derniers recours en cas de grands incendies. Elles sont donc postées préférentiellement en Aquitaine, dans les Landes, en Corse et en Provence. Pourquoi ? Parce qu’on n’a plus assez de ressources, parce qu’on a, là aussi, grevé les budgets. Au fur et à mesure, on dépouille tout notre savoir-faire, tout notre système de soin.
Le responsable de l’Hôpital Avicenne alerte justement, il n’est pas le seul. Il y aura probablement des morts du fait de cette désorganisation et après ça, peut-être des morts indirects.
Je disais que l’isolement social est la première cause de mortalité lors d’une canicule. Ça s’est vérifié en 1995 à Chicago. Un sociologue a fait une étude là-dessus et il s’est dit : « On ne meurt pas de soif, ce n’est pas possible ! » Non, les gens sont morts d’isolement, et lors de la canicule de 2003, je le rappelle, 80 % des gens sont décédés sur un seul week-end, celui où il a fait le plus chaud. Ils sont morts essentiellement à Paris. Et ce n’était pas des personnes nécessairement âgées, 50 % d’entre elles avait moins de 50 ans. Simplement, elles étaient seules. Il est clair que l’isolement social, c’est vraiment une cause de mortalité importante.
Si je devais donner un exemple concret d’une préfiguration intéressante pour la formation, c’est ce qui existe à Toulouse avec le Pôle régional d’enseignement des métiers de la Santé (PREFMS). [2]
C’est une vraie piste sérieuse qu’il faut creuser. Cependant, il faut aller encore plus loin, il y a vraiment tout à repenser. C’est pour ça que je me suis engagé dans une réflexion éthique profonde sur « aujourd’hui qu’est-ce qu’on pourrait faire pour inverser, changer de paradigme ? »
A l’instar de quelques expériences qui se déroulent en France, je veux créer effectivement un « Centre de santé communautaire », au sens où il est défini dans la loi française, dans les textes d’orientation du ministère de la Santé qui suivent les préconisations de l’OMS, notamment la déclaration d’Alma Alta de 1978 qui dit que la santé communautaire, c’est de faire « par et avec les habitants », de partir de leurs besoins de santé, de les intégrer dans le parcours et de les convier à évaluer les politiques de santé qu’on met en place. Cela permet d’avoir une réelle « démocratie sanitaire », des mots qui sonnent quand même très creux en France. La démocratie sanitaire, cela n’existe plus puisqu’en gros, les médecins des services et des pôles ont été sortis des Commissions médicales d’établissement (CME), où siègent essentiellement des élus des services fonctionnels, des gestionnaires et des technocrates – dont on se demande bien ce qu’ils font à ces CMEs, il faudra un jour me l’expliquer…
Cette mise sous tutelle remonte à la création des Agences régionales de santé (ARS), si je ne me trompe ?
Les ARS, c’est ce qui a permis de déconcentrer l’État, ce ne sont même pas des fonctionnaires, ce sont des gestionnaires. L’ARS, son premier pôle d’activité, c’est « l’offre de soins ». C’est elle qui régule l’offre de soins, le nombre de médecins par secteur, le nombre de médecins conventionnés, le nombre d’infirmiers en activité libérale, c’est la première activité de l’ARS. Ce n’est pas de construire un système de santé sur le territoire...
Ils ne vont pas chercher à connaître les besoins réels d’un territoire ?
Si, ils font d’excellentes fiches synthétiques, il faut leur reconnaître cela. Il y a vraiment des articles très intéressants sur lesquels on peut s’appuyer, justement pour mener des politiques de santé publique. Mais ensuite, quand il s’agit de déployer les services de santé publique, là par contre ils sont quasiment inexistants. Ou alors, on vous demande de répondre à des appels à projet, c’est très technocratique. Ces appels aux projets se sont multipliés de façon exponentielle ces dix dernières années.
Votre proposition de Centre de santé communautaire, cela marchera comment ? En quoi cela comblera les déserts médicaux ?
Lorsque vous renversez le paradigme et que vous partez des besoins de santé des populations comme axe d’orientation, et non du symptôme, vous allez tenter d’y répondre, par exemple par des actions comme l’éducation à l’alimentation. Et cela peut aller très loin, comme chercher à faire du jardin partagé, des jardins maraîchers en quartier prioritaire en politique de la ville. Ça commence à se faire, mais très à la marge. Ce n’est pas du tout dans la culture française de se dire qu’en bas des barres d’immeubles, on pourrait produire des cultures vivrières, de manière à ce que les gens réapprennent à cultiver le sol. Et ensuite on va les accompagner à composer des menus ! Selon leurs besoins et peut-être leurs pathologies. On peut également les inviter à se former davantage, non seulement aux soins de premiers secours, mais à la reconnaissance des signes précurseurs de pathologies.
C’est le retour de la prévention ?
Le retour ? En fait, en France, on n’en a jamais réellement fait ! Ou seulement de façon trop partielle et partiale.
En plus de la formation en premiers secours délivrée par les organismes compétents, on pourrait leur demander de travailler sur des formations à la reconnaissance et la prise en charge de signes de type AVC ou infarctus : savoir reconnaître un AVC et prendre les premières mesures pour y faire face. Il ne s’agit évidemment pas de prendre des mesures médicales, mais d’identifier à quoi on a affaire, d’apprendre à passer un appel correct auprès du centre 15, à lui donner un bilan correct pour lui faire gagner du temps et être tous efficients. Se former à ça.
Ce genre d’actions est beaucoup plus efficace que de remplir une ordonnance avec six médicaments et d’aller les retirer à la pharmacie. On aura simplement traité le symptôme, mais pas les causes de pourquoi vous êtes malade, et vous aurez nourri l’industrie pharmaceutique qui n’a jamais été aussi florissante qu’aujourd’hui.
Le technocrate français vous dira que vous proposez le modèle cubain ou celui du Nicaragua !
Je lui répondrai que le système cubain n’est certainement pas le meilleur système de soin au monde, parce qu’ils ont des infrastructures avec les moyens du bord, compte tenu des conditions. Par contre ce système est reconnu comme étant le meilleur système de santé.
Oui, ils font très bien et ils vont très bien, parce qu’ils ont dans chaque village des infirmiers, des médecins qui vivent avec la population et qui voient ce que mangent les gens, ce qu’ils prennent comme risques en travaillant, et peuvent donc intervenir en amont sur les comportements et voir les signes précoces, au lieu d’attendre que ça s’aggrave et devoir aller à l’hôpital.
Bien sûr, et c’est l’exemple du saturnisme en France. Pendant très longtemps, il a été invisibilisé du fait de biais cognitifs, sociaux, discriminatoires. Ainsi (et il y a eu sur France Culture toute une série du Collège de France sur le sujet), on soupçonnait les enfants d’origine subsaharienne d’avoir attrapé le saturnisme en consommant des préparations cosmétiques préparées par leur mère, alors qu’en fait, c’était l’ingestion d’écailles de peinture au plomb qui se détachaient des murs de leurs maisons qui les rendait malades. On ne s’intéressait pas du tout aux conditions de logement ni aux conditions de vie de ces populations primo-arrivantes, avec une difficulté quant à la langue, etc.
Il y a une sorte de maladie, aristotélicienne, qui postule que la santé, c’est un hôpital et des médicaments. Pour vous (et je suis tout à fait d’accord avec cette approche), la santé, c’est avant tout une culture, c’est une aptitude à la vie, à faire attention à un ensemble de choses, de causes et d’effets, et pouvoir intervenir sur ces chaînes de causalités.
Oui, je pense qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre l’utilisation de la haute technologie pour soigner de mieux en mieux et le fait de faire davantage de santé publique et communautaire. La santé communautaire se définit par rapport à un groupe, qui peut être un groupe géographique, un groupe sociologique, un groupe de patients. Par exemple, les patients VIH, qui sont finalement devenus les référents de santé pendant les années fortes du sida, faisaient de la santé communautaire et ils en font toujours, s’adressant à un public ciblé de personnes ayant parfois des conduites à risques et/ou des conduites à risques liées à l’utilisation de drogues. Cela s’adressait donc à un certain groupe, et ce sont eux-mêmes qui ont finalement construit une politique de santé devenue une référence, dont les politiques publiques se sont ensuite saisies pour la diffuser le plus largement possible dans la population.
C’est une santé citoyenne « de bas en haut » plutôt qu’un système d’Etat « du haut en bas ».
Exactement, et c’est quand même par eux que le préservatif s’est généralisé, et c’est fort heureux.
Il y a aujourd’hui à repenser effectivement la totalité de notre paradigme quant à notre système de soin. C’est ce que je m’étais attaché à faire sur un territoire où, de plus, je voudrais déployer une unité mobile, comme le préconisent les politiques publiques, pour aller vers les populations des zones rurales isolées, où les médecins ne viennent pas s’installer avec leur famille, où il n’y a donc pas d’offres de soin. Aller vers ces populations pour s’assurer aussi qu’elles ont une couverture sociale et médicale appropriée.
Dans le cadre de la COVID, n’est-on pas allé trouver les personnes âgées pour les vacciner chez elles ?
On a surtout installé des centres de vaccination sur de grands axes de circulation ou dans de grandes villes, et plutôt en intra ou en infra urbain. Mais dans les zones rurales, ce fut beaucoup à l’initiative des maires, qui sont toujours le premier relais des habitants sur le territoire. C’est surtout grâce à eux que cela a pu se faire, et certainement pas grâce à une action étatique forte. On n’a pas construit d’unité de brigades mobiles pour aller dans les zones désertifiées vacciner les personnes. Non, en France, on attend que les gens viennent aux soins !
C’est un peu comme les urgences, vous êtes là, à la porte d’entrée de l’hôpital. Mais aujourd’hui tout le monde vient et les urgences dysfonctionnent complètement.
Honnêtement, je ne pensais pas que de mon vivant, ça irait jusque-là, bien que j’aie vu le mal s’installer. En effet, de tous les problèmes qu’on dénonce aujourd’hui, on en voyait déjà poindre un certain nombre il y a déjà vingt ans. Mais à un point aussi critique, je ne pensais pas le voir un jour.
Quand vous avez un service d’urgence comme celui du CHU de Bordeaux qui ferme partiellement en vous disant : maintenant ça sera régulé par le 15, cela veut dire que lorsque vous vous présentez devant la porte du service d’urgence, il ne vous reste plus rien !
C’est vraiment ça qu’il faut dire : c’est la fin du service public, et c’est surtout la fin de l’accès aux soins. Si, en plus, le centre 15 est débordé et n’est pas en mesure de vous répondre, vous n’avez plus aucun recours. C’est vraiment quelque chose de très parlant, et je pense que la population ne le mesure pas encore : quand vous en êtes là, vous n’avez plus aucun recours, il n’y a plus rien.
Disposer un numéro unique où les gens pourraient appeler en disant, j’ai tel et tel problème, et qu’on leur réponde, plutôt que d’aller aux urgences, on va vous envoyer un médecin ou vous pouvez vous rendre dans ce dispensaire, cela peut orienter ?
Que le centre 15 régule, c’est une bonne chose, mais encore faut-il lui en donner les moyens, avec suffisamment de médecins régulateurs et de permanenciers pour répondre aux appels !
Qu’il régule le soin à la victime (encore une fois, il faut revenir sur la différenciation), oui.
Mais que le centre 15 aille chercher des ambulances privées (je n’en ai pas parlé, mais quand je disais qu’il faut tout repenser), alors que les compagnies d’ambulances fonctionnent toujours sur le même modèle, c’est incompréhensible. Si l’on veut correctement faire des missions de transports sanitaires ou de secours à la personne, il faut que les gens soient correctement formés, qu’on leur donne des missions clairement définies. Or, aujourd’hui, les ambulances privées sont censées faire du transport sanitaire et elles sont également envoyées pour prendre en charge des personnes qui peuvent avoir tous types de pathologies, parce que ce seront les seules ambulances disponibles quand la ligne de SMUR a déjà envoyé toutes les siennes, souvent pour des cas plus graves.
Si vous avez quelqu’un qui fait un AIT [Accident ischémique transitoire] ou quelqu’un qui a été brûlé ou qui ressent une grosse douleur qui peut être le signe d’une endocardite ou d’une embolie pulmonaire, et que vous êtes le seul véhicule disponible à pouvoir y aller, vous allez prendre en charge la victime pour l’amener jusqu’au service d’urgence. Là, il y a une vraie perte de chance, du fait que les personnes que vous allez envoyer ne sont pas correctement formées, elles ont juste l’attestation de formation de premiers secours, c’est-à-dire la formation de base de premier niveau, et elles ne sont mêmes pas formées à faire correctement du brancardage, du levage etc.
A tout prendre, mieux vaut encore les pompiers !
Oui, c’est comme ça que raisonnent finalement les médecins, mais les pompiers, encore une fois, si on les éloigne trop de leurs missions… on a déjà parlé du problème !
Comme les soignants se détournent de leurs métiers parce qu’ils ne peuvent plus le faire dans la plénitude de leur exercice, et qu’en plus, on met en danger la population en envoyant les pompiers sur toutes sortes de missions et qu’ils ne sont pas là où ils devraient être, quitte à attendre un peu, je préfère des pompiers bien formés et qui, le jour où ils sont appelés pour un grand incendie, sont prêts à y aller, avec suffisamment de ressources.
Parce que le jour où il y a une explosion dans une zone Seveso, s’il n’y a pas suffisamment de ressources, on a une vraie perte de chance, parce que des zones Seveso en infra ou en intra urbain, on en a un certain nombre en France. Il n’y a pas si longtemps, on a eu Lubrizol (à Rouen) et il y a quelques années, on a eu AZF (à Toulouse). Cela arrivera nécessairement. Le jour où une centrale nucléaire va surchauffer parce qu’on n’a plus assez d’eau pour la refroidir, à cause des épisodes de sécheresse qui vont se multiplier, cela posera un problème...
C’est pourquoi je préfère que les pompiers soient formés au risque nucléaire, au risque chimique et au risque industriel, plutôt que de les envoyer aux quatre coins d’une ville ou d’une zone rurale à faire du secours à la victime quand on n’a pas su organiser un vrai service pour cela.
Merci pour cet entretien très riche en propositions !

 COMMENTAIRES
COMMENTAIRES