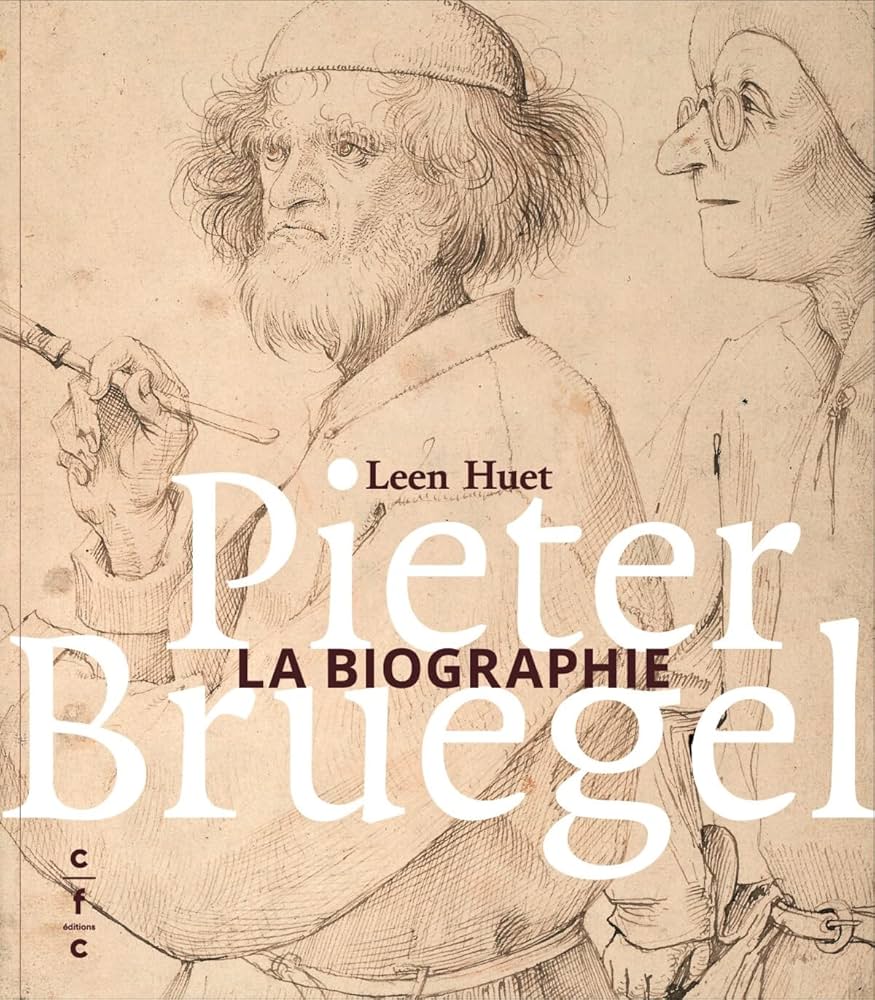Pieter Bruegel l’ancien, commentateur politique et pacifiste
Par Karel Vereycken
Cinq siècles après sa naissance, la publication de nouvelles recherches semblent (enfin) rendre justice au grand peintre flamand « Pierre Bruegel le drôle », dit l’ancien (1525-1569).
Jusqu’ici, on entendait trop souvent dire de lui qu’il « apparaît comme une figure inclassable ». En 2024, l’historienne de l’art Mónica Ann Walker Vadillo n’hésite pas à écrire dans les pages Histoire du quotidien Le Monde que, vu que Bruegel a peint des fêtes paysannes, les critiques d’art « en sont arrivés à le considérer comme un homme peu raffine et l’ont surnommé avec dédain ‘Bruegel le Paysan’ », tout en s’étonnant qu’il ait fréquenté bon nombre « d’universitaires, d’humanistes et des hommes d’affaires fortunés – qui appréciaient son œuvre et collectionnaient ses tableaux ». [1]
Chute des anges rebelles

En 2014, le livre de Tine Luk Meganck, « Pieter Bruegel, la chute des anges rebelles. Art, savoir et politique à l’aube de la révolte des Gueux », surtout avec la dernière phrase de son titre, avait néanmoins rouvert le débat sur la dimension politique de son œuvre.
Meganck s’y risquait à une hypothèse hautement improbable à propos du tableau La chute des anges rebelles (1562, Musée de Bruxelles) : les anges jaloux, que Dieu punit pour avoir conspiré contre lui, représenteraient l’alliance des nobles, des classes moyennes et du peuple, menée par Guillaume le Taciturne contre la férule de l’Empire espagnol. Du coup, le commanditaire de l’œuvre, toujours selon l’experte, serait probablement le fameux cardinal Antoine Perrenot de Granvelle, un des conseillers de la régente Marguerite de Parme et fervent partisan de la chasse aux hérétiques.
Nous avons documenté dans un autre article pourquoi cette interprétation nous semble irrecevable, le cardinal de Granvelle, un des membres du « gouvernement secret », étant universellement détesté par les humanistes de l’époque pour son zèle aveugle endossant tous les crimes de ses maîtres. De plus, aucune preuve tangible n’existe qu’il ait commandité une quelconque œuvre à Bruegel. Certes il en possédait, mais, à part une « Fuite en Egypte » (1563), œuvre dépourvue de la moindre polémique, et une « Vue sur la baie de Naples », belle étude inspirée des dessins réalisés lors de son voyage en Italie, Granvelle était loin d’être « un des plus grands collectionneurs » d’œuvres de Bruegel, comme on le répète un peu partout.
Landjuweel
Ceci étant dit, l’apport nouveau et important du livre de Meganck, c’est (on l’avait oublié) la reconnaissance de l’influence déterminante, pour comprendre le langage visuel de Bruegel, des Chambres de rhétorique et du Landjuweel d’Anvers de 1561.
Mon ami le regretté critique d’art américain Michael Gibson m’avait parlé de cette piste lors d’un entretien que j’avais réalisé avec lui. Il l’évoque dans son livre Le portement de croix (Editions Noêsis, Paris 1996), qui servira en 2011 à la réalisation du film « Bruegel, le moulin et la croix ».
En 1561, Anvers, où Bruegel résidait, se fit le siège d’une réjouissance exceptionnelle,le Landjuweel, ou concours national des Chambres de rhétorique. Or, la Chambre anversoise « La Giroflée » (De Violieren), chargée de l’organisation d’une fête qui coûta cent mille couronnes à la ville, était en quelque sorte la division littéraire de la Guilde de Saint-Luc, qui regroupait les peintres, graveurs, sculpteurs, cartographes, orfèvres et imprimeurs.
C’est là qu’on lisait en flamand aussi bien qu’en latin ou en français, Platon, Homère, Pétrarque, Erasme et Rabelais. La première Bible en français ? Imprimée à Anvers en 1535 par Jacques Lefèvre d’Etaples, qui publia les premières traductions de l’œuvre complète de Nicolas de Cues à Paris en 1514, trois ans avant la parution, dans la même ville, de la première édition de L’éloge de la folie d’Erasme.
Le Landjuweel d’Anvers fut une fête grandiose. Venus de dix cités, deux mille rhétoriciens à cheval, passant par quarante arcs de triomphe, aux stridences des fifres, pénétrèrent dans une ville en fête. Tout un mois durant, orateurs et poètes, chansonniers et acteurs concoururent sans reprendre haleine.
Bruegel dut les suivre d’autant plus que son cher ami Hans Frankert, son ami et maître Peeter Baltens, très introduit auprès des grands financiers locaux qui préféraient le commerce à la guerre, ainsi que son premier patron, le graveur Jérôme Cock, furent tous impliqués dans l’organisation de cet événement dont le thème était la paix et, deux siècles avant Kant et Schiller, cette brûlante interrogation philosophique : « Qu’est-ce qui conduit le plus l’homme vers les arts ? » Voilà donc la marmite bouillonnante de culture citadine dans laquelle Bruegel fut plongé dès ses débuts.
Par ailleurs, comme le détaille l’historienne Leen Huet, dans sa somptueuse biographie de l’artiste (parue d’abord en néerlandais en 2016 chez Polis, puis en français chez CFC à Bruxelles en 2021), lorsqu’il traversa les Alpes, Bruegel était probablement accompagné par le peintre Maarten de Vos et le cartographe Abraham Ortelius, ami proche de Christophe Plantin, le patron de la plus grande imprimerie d’Anvers, l’équipe disposant de milliers d’adresses de collectionneurs en relation avec l’imprimerie Les Quatre Vents de Jérôme Cock, à Anvers.
Le « Bruegel code »
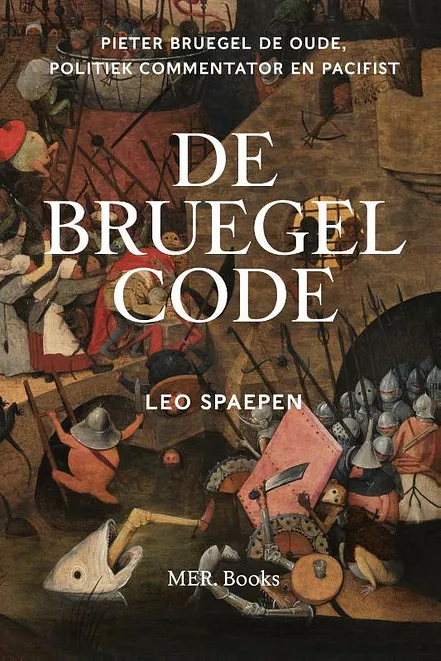
L’image d’un Bruegel commentateur politique, brouillant volontairement son message pour déjouer les gestapistes du régime qui le guettaient, s’inscrivant dans la philosophie toute érasmienne du Landjuweel pour défendre la paix et la compréhension mutuelle, est encore plus étoffée par l’historien Leo Spaepen, dont le livre récent, Pieter Bruegel de oude, politiek commentator en pacifist. De Bruegel Code (publié en néerlandais chez MER Books, 2025), fait sensation.
Bon pédagogue, Spaepen y établit une sorte de code permettant de déchiffrer, ou du moins d’aborder fructueusement, le langage visuel bruegélien. S’échappant du bocal aristotélicien, il s’agit d’écarter d’emblée les représentations formelles et symboliques au bénéfice d’une approche que je qualifierais de métaphorique.
Narratif A et B
Dans chaque tableau, il y a un « narratif A » et un « narratif B ». Le premier traduit généralement une préoccupation partagée par la communauté humaniste et érasmienne face aux événements socio-politiques de l’époque, où la corruption et la violente répression espagnole conduisent les Pays-Bas hispano-bourguignons au bord de la révolte. Le « narratif B » évoque souvent une scène tirée de la Bible ou des écritures.
Comme dans toute métaphore, le paradoxe résultant de la mise en analogie du narratif A avec le B fait émerger, non pas sur le tableau mais dans l’esprit du spectateur, une palette d’indications lui permettant de saisir vers quoi le peintre veut le conduire. Spaepen, dont il faut saluer le courage, la rigueur et la témérité, a suffisamment approfondi l’histoire politique et culturelle de l’époque de Bruegel pour émettre des hypothèses probantes éclairant ses principales œuvres. En mettant à l’épreuve, dans un tableau après l’autre, cette approche cognitive, l’auteur génère non pas une somme savante de faits ou de preuves, mais une « gestalt » extrêmement intéressante du peintre, dont on a souvent refusé d’identifier le vrai génie. Impossible donc dans un simple article comme celui-ci de reproduire toute la richesse de la démarche.
Margot l’enragée
Regardons tout de même une œuvre emblématique de Bruegel, connue par son surnom, Dulle Griet (« Margot l’enragée » ou « Margot la folle »), une œuvre peinte en 1563, non pas pour satisfaire un commanditaire, mais pour susciter des discussions avec ses proches lors de repas chez lui, comme cela se faisait à l’époque.
Le tableau frappe par ses contradictions. Au premier plan, devant un paysage urbain en flammes, une femme folle de rage, l’épée à la main, emportant avec elle un panier rempli de bijoux et d’orfèvrerie. Derrière elle, une cohorte de femmes sans armes s’acharne courageusement à maîtriser et repousser une armée de monstres et de diables. Enfin, à l’intersection des diagonales de l’œuvre, une étrange créature reprise du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Un homme portant sur le dos une vaste bulle, touille son derrière d’où tombent des pièces d’argent que certaines femmes s’empressent de ramasser.
Pour ce qui est du narratif B, on retrouve en gros l’image que Bruegel avait élaborée dans un dessin ayant servi à une gravure de 1557 représentant l’un des péchés capitaux, ici la rage (Ira en latin), représentée là encore par une femme géante, avec pour sous-titre : « La rage bouffit les lèvres et aigrit le caractère. Elle trouble l’esprit et noircit le sang. »
Spaepen rebondit également (p. 131) sur une belle trouvaille de Leen Huet. L’historienne a découvert que lors du Landjuweel d’Anvers de 1561, la chambre de rhétorique de Malines avait évoqué une « Griete die den roof haelt voor den helle » (une fille qui va piller l’enfer), figure peut-être tirée d’une pièce de théâtre aujourd’hui perdue.
Huet évoque également (p. 35) le proverbe flamand disant d’une vieille harpie qu’elle « pourrait aller piller l’enfer et en revenir saine et sauve ». A la même époque, constate Huet (p. 48), l’auteur Sartorius, dans un recueil d’adages inspiré d’Erasme, énonce un dicton proche, dans son esprit, du panneau Dulle Griet :
En réalité, le statut des femmes citadines dès le XVe siècle en Flandres, avec les béguinages, et surtout au Brabant au XVIe siècle, était l’un des plus avancés d’Europe [2], expliquant sans doute en partie les inquiétudes de certains membres de la gent masculine face au pouvoir grandissant des femmes.
Granvelle petit esprit

Mais Spaepen, bon observateur, dédouane Bruegel de ce genre de réaction masculiniste en ramenant la réalité du narratif A, l’actualité politique du moment.
Le peintre, pense Spaepen, dénonce ici le cardinal de Granvelle, zélé conseiller de la régente Marguerite de Parme, une femme tiraillée entre l’intérêt général et la soumission à la tyrannie de l’Église catholique, dont les dogmes furent instrumentalisés par Madrid pour piller le pays afin de rembourser la dette colossale de Charles V et Philippe II envers les banquiers Fugger.
Personnellement, j’ai pensé un moment que Bruegel avait inventé pour l’occasion un 8e péché capital, « l’incitation à la guerre » (Oorlogstokerij), mais je suis sans doute trop dans le présent.
En août 1561, faisant fi de l’avis de Granvelle, Marguerite avait autorisé la Guilde de Saint-Luc et les Violieren à organiser le Landjuweel d’Anvers pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle. Mais immédiatement après, elle céda à la pression de Madrid en interdisant la publication des comptes-rendus des Chambres de rhétorique, accusées d’avoir coalisé tout le pays contre l’Empereur.
En 1563, année où Bruegel peint sa Margot, le Concile de Trente décide de brider l’art polyphonique en rétablissant dans la musique la primauté du texte chanté et en interdisant toute ambiguïté dans une peinture, reliée à un rôle de propagande, exactement comme le souhaitait Granvelle.
Dans le tableau « Margot l’enragée », l’étrange créature au centre, drapée d’un manteau rouge, pourrait donc bien être le cardinal de Granvelle en personne. Comme le rappelle Spaepen, ce dernier venait d’instaurer un vaste système d’informateurs afin de traquer les hérétiques « jusque dans les toilettes ». Cela visait tous ceux, luthériens, calvinistes, érasmiens ou anabaptistes, qui contestaient la mainmise prédatrice du régime. Or, l’argent « chié » par Granvelle est récupéré par des femmes prêtes à aller piller l’enfer ! Pas tendre pour Margot l’enragée (Marguerite de Parme), Bruegel pourrait donc exprimer ici son effroi devant cette régente ayant perdu la tête, et surtout à l’idée que les Flamandes, devenues si libres et éduquées, puissent finir comme indics d’un régime totalitaire !
Familia Caritatis
Spaepen (p. 194) rend plausible, s’il n’y adhère pas explicitement, la forte influence exercée sur Bruegel par la Familia Caritatis (Famille de la charité), un courant philosophique et religieux fondé et dirigé par Hendrik Niclaes (1502-1570), figure prophétique et charismatique prônant la paix et la tolérance dont on sait assez peu mais apparaissant sans doute pour beaucoup, sans atteindre sa sagesse et son érudtion, comme une sorte de successeur d’Erasme.
De nombreux humanistes et bon nombre des fréquentations de Bruegel étaient en contact avec ce courant qui, en passant par l’Angleterre, se dissoudra dans la révolte Quaker contre l’Église anglicane. Il s’agit notamment des imprimeurs Christoffel Plantin, John Gailliart, des humanistes Abraham Ortelius, Justus Lipsius, Andreas Masius, Goropius Becanus, Benito Arias Montano, des poètes Peeter Heyns, Jan van der Noot, Lucas d’Heere, Filips Galle, Joris Hoefnagel, du théologien Hubert Duifhuis, de l’écrivain Dirck Volkertsz, de Coornhert (bras droit de Guillaume le Taciturne), des « familistes » Daniel van Bombergen, Emanuel van Meteren, Johan Radermacher et des marchands anversois Marcus Perez et Ferdinando Ximines.
Plantin, considéré comme l’imprimeur officiel du régime espagnol, faisait imprimer (de nuit) les livrets (qualifiés d’hérétiques par le régime) de la Familia Caritatis, moyennant une aide financière pour son imprimerie de la part de Niclaes. L’œuvre majeure de Niclaes, la Terra Pacis, dénonce les « aveugles guidant les aveugles », thème que l’on retrouve chez le fils de Quinten Matsys, puis chez Bruegel.
Niclaes reprend Socrate et la philosophie des Frères de la vie commune, pour qui c’est l’amour désintéressé (agape ou caritas) qui doit animer les hommes. Autre conviction : la vie est « un pèlerinage de l’âme ». Comme dans les paysages de Joachim Patinir, l’Homo Viator doit constamment, par son libre arbitre, pérégriner et chercher à s’unir à Dieu en se soustrayant aux tentations terrestres. La paix intérieure, avec soi-même, avec sa conscience et avec la volonté divine, est le fondement de la paix sur Terre, un idéal qui animait aussi très clairement le peintre.
Voici donc la véritable histoire, celle d’un grand commentateur politique et résistant de son temps, un peintre engagé intellectuellement et spirituellement pour la paix.