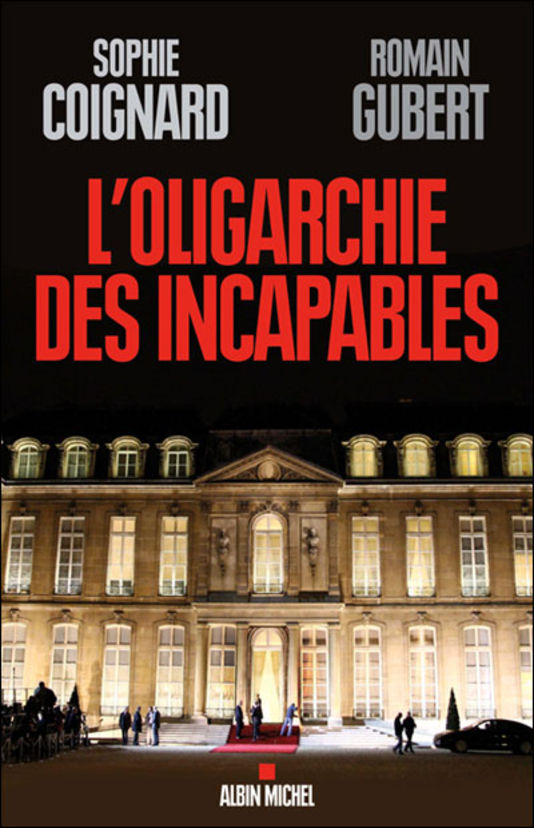L’Oligarchie des incapables par Sophie Coignard et Romain Gubert, Albin Michel, Paris Janvier 2012, 300 pages, 20 euros.
Revue de livre par Bruno Abrial.
Si donc ceux qui manient la force française venaient à se décourager, il n’y aurait pas seulement péril pour la patrie mais bien rupture de l’harmonie générale. La puissance échappée à ces sages, quels fous s’en saisiraient ou quels furieux ?
De Gaulle, Le Fil de l’Epée, 1927.
2004. Le trio Djouhri, Proglio, Roussely est à la manœuvre pour créer un grand groupe contrôlant l’eau et l’énergie française. La stratégie consiste à faire reconduire François Roussely à la direction d’EDF, à arranger un accord avec la CGT pour permettre la fusion du service public avec Veolia, puis à détruire l’emprise d’Anne Lauvergeon sur Areva afin de prendre le contrôle de la filière nucléaire. Ce nucléaire qui apparaît à leurs yeux comme une immense mine d’or dont il faut s’emparer, alors que se termine la belle époque où les secteurs du BTP et surtout de l’armement permettaient de remplir les caisses et les mallettes. Malheureusement pour eux, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin menace alors de démissionner et parvient ainsi à imposer Pierre Gadonneix à la place de Roussely.
2009. Nicolas Sarkozy pense à un certain Roussely, entre-temps reconverti dans le privé à la vice-présidence du Crédit suisse Europe, pour écrire un rapport sur l’avenir de la filière nucléaire française. Les deux anges venus murmurer à l’oreille du Président se nomment Claude Guéant, alors secrétaire général de l’Elysée, et Alexandre Djouhri. Le rapport, publié en 2010, critique la stratégie d’Areva misant sur une sécurité maximale et préconise d’ouvrir l’entreprise aux capitaux extérieurs. Le QIA, fonds d’investissement du Qatar, s’intéresse beaucoup à son secteur minier. Or, la banque conseil du QIA est… le Crédit suisse. Conflit d’intérêts ? Non, intérêt supérieur de la Nation !
2010. Dans un contexte de duel sans merci entre Henri Proglio, devenu PDG d’EDF, et Anne Lauvergeon, Claude Guéant envoie un message à la directrice d’Areva pour lui signifier que c’est EDF qui doit s’occuper de l’intégralité des négociations pour la vente de réacteurs nucléaires en Afrique du Sud. Quelques mois plus tard, Luc Oursel, un ami de François Roussely, prend la direction d’Areva. La voie est ouverte pour faire entrer le QIA au capital du groupe et entamer le démantèlement de l’un des derniers fleurons des trente glorieuses…
Comment en est-on arrivé là ? Le patron d’Electricité de France, le vice-président du Crédit suisse, le numéro deux du gouvernement et un ancien braqueur de bijouteries de la banlieue Nord, magouillant dans l’ombre pour s’installer au contrôle de l’eau et de l’énergie de notre pays ? Que s’est-il donc passé depuis le temps où ceux qui avaient combattu le nazisme instauraient une République « impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques de la direction de l’économie » ?
Le livre de Sophie Coignard et Romain Gubert, L’oligarchie des incapables, nous plonge au cœur d’un petit monde où cohabitent d’étranges espèces : entrepreneurs audacieux, hauts fonctionnaires, requins de la finance, avocats d’affaires, princes du Qatar et caïds transformés en intermédiaires en Afrique ou au Moyen-Orient. Des inspecteurs des finances devenus dirigeants de fonds d’investissements, comme Walter Butler, côtoient dans les grands dîners les représentants des plus prestigieuses dynasties. Le pantouflage entre privé et public y est devenu une habitude, le conflit d’intérêt une vertu, la cupidité un penchant naturel de l’homme au service du peuple. Et, retranchés dans leur château, pendant que la dette se creuse, que le fléau du chômage s’étend et que la France se fait désosser des moyens et des richesses bâties après la guerre, copains et coquins dansent au son d’un orchestre de troubadours, payé grâce aux bonnes œuvres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), c’est-à-dire avec l’épargne des Français. Devant les portes du château, un porte-parole de la joyeuse troupe vient prêcher la responsabilité budgétaire et recommander les efforts à réaliser pour payer la dette et rétablir les finances…
Dans ce milieu, l’argent est devenu la valeur suprême, au fur et à mesure que s’étend l’incapacité à s’occuper des affaires du pays. L’Etat s’affaiblissant, des réseaux d’influence se sont imposés, des bandes ont pu s’emparer de secteurs et de territoires entiers. L’argument de cette oligarchie pour justifier tout cela repose sur le dogme libéral anglo-saxon « que l’esprit d’entreprise soit guidé par le désir d’enrichissement est bien naturel ». L’habillage permettant de masquer le fait que cet enrichissement a cessé de bénéficier à la collectivité est la corporate governance, un système où des « comités de rémunération » au sein des conseils d’administration sont censés réguler raisonnablement les revenus des dirigeants. Pure hypocrisie, car tout le monde se tient par la barbichette de la corruption. D’un côté, afin d’éviter toute remise en question, on pardonne à ceux qui appartiennent à ce milieu leurs incompétences, même si elles ont coûté des milliards, de l’autre on traque le moindre centime superflu dans les dépenses sociales, et on crée un climat de défiance au sein de la population.
Mais ne nous y trompons pas : la droite bling-bling et moralisatrice de Sarkozy et de son « premier cercle » du Fouquet’s n’est que l’étape d’un processus commencé plusieurs décennies auparavant.
La trahison de la gauche
Mai 1981. François Mitterrand est élu. La presse de droite scande que les chars soviétiques vont bientôt défiler sur les Champs Élysées, et le spectre de la nationalisation hante les nuits des grands banquiers et grands industriels. Certains d’entre eux partent même se réfugier à l’étranger, comme Bernard Arnault. Mais si un changement fondamental semble bouleverser la société française, il s’agit en réalité d’une continuité du régime oligarchique, et même d’un changement de phase dans son évolution, puisque c’est dans cette période que le renard de la finance a été autorisé à entrer dans le poulailler du pouvoir politique. Jusque-là, on s’en tenait à des salaires raisonnables, à un mode de vie sans excès ; les règles à respecter étaient limpides. Le tout-Etat s’est alors laissé coloniser par l’argent. Le même Mitterrand qui, en 1981, dans ses discours de campagne électorale, fustigeait « l’argent qui corrompt, l’argent qui salit », livre en 1984 l’épargne populaire à la spéculation internationale en abrogeant la loi de séparation entre banques de dépôt et banques d’investissement, établie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il va désormais se contenter de détourner les yeux de cet argent qu’il ne saurait voir, avouant à sa femme qu’il s’est rendu impuissant face à cette « dictature financière internationale ».
Les grands patrons de l’industrie et de la banque comprennent très vite que la nationalisation annoncée en fanfare n’est pas un si mauvais moment à passer. Ils voient finalement arriver d’un bon œil les 39 milliards de francs d’indemnisation de l’Etat ; certains industriels ou financiers se trouvent même sortis d’une situation plutôt difficile. Bernard Arnault peut revenir en France. Il reprend le groupe textile Boussac, alors en pleine déconfiture : l’Etat lui livre deux milliards de francs en échange d’un engagement à préserver les 16000 emplois du groupe. Il prend l’argent et supprime les emplois. Les banques d’affaires, en particulier Lazare Frères, sont celles qui ont le plus bénéficié de cette époque : « Au début des années 80, les banques d’affaires, en France, ne comptaient pas pour grand-chose », explique un haut fonctionnaire du Trésor, qui a suivi de près de nombreuses opérations. « Le flux et le reflux des nationalisations et des privatisations les ont nourries à la manière d’une usine marémotrice : à chaque passage, elles se sont servies, comme banques conseils, profitant du mouvement des vagues. »
En même temps, le corps des énarques se sent irrésistiblement séduit par cet argent facile : « Pourquoi pas moi ? » Le cas de Jean-Charles Naouri illustre à merveille ce nouveau genre : petit génie, normalien, docteur d’Etat en mathématiques, diplômé de Harvard, énarque et inspecteur des finances, il orchestre, entre 1984 et 1986, la déréglementation des marchés financiers en créant le Matif (Marché à terme des instruments financiers), le Monep (Marché des options négociables de Paris) et autres outils favorisant les transactions et la liquidité. Il créé les OAT (Obligations assimilables du Trésor) qui vont permettre de vendre la dette française aux quatre coins du monde (aujourd’hui, 68% de la dette est détenue par des étrangers, principalement situés au Luxembourg, en Angleterre et aux îles Caïman, d’après Patrick Artus, économiste de Natixis). En 1986, la droite gagne les élections législatives et s’installe au gouvernement. Le temps des grandes privatisations est venu. Naouri se reconvertit dans le privé : il crée un fonds d’investissement, Euris, l’un des premiers du genre. Dans les années 90, il fait de Rallye/Casino une énorme chaîne de distribution. Il est aujourd’hui l’une des cinquante premières fortunes de France et son fils dirige les opérations des hypermarchés Géant Casino.
Alors, entre les belles intentions affichées en public – le dévouement toujours plus sincère pour la France – et les pratiques derrière le rideau, le fossé s’est creusé et l’oligarchie s’est enfoncée dans son incompétence.
De façon presque comique, c’est François Hollande lui-même qui vient de très bien résumer ce problème : dix jours après avoir défini la finance comme son ennemi, le voilà s’adressant à des journalistes de la presse financière britannique : « La gauche a été au gouvernement pendant quinze ans durant lesquels nous avons libéralisé l’économie et ouvert les marchés à la finance et aux privatisations. Il n’y a pas de craintes à avoir. »
Du Caractère
Si les propos de Hollande exposent sa maladresse, ils sont surtout le reflet d’une soi-disant élite qui, n’ayant ni la vision ni le caractère nécessaires, est sur le point de se faire balayer par l’histoire. Mais ne perdons pas de vue que ce système oligarchique, qui n’est finalement que la résurgence de vieilles traditions féodales, a pu s’installer dans les institutions de la République grâce à une population devenue amorphe et soumise. Car elle a contracté le même mal que cette oligarchie des incapables : la culture oligarchique, c’est-à-dire un milieu imprégné d’un culte de la possession et de l’instant, où les êtres humains sont dégradés à l’état d’individus ballotés entre la recherche du plaisir et l’angoisse de souffrir.
Si nous ne voulons donc pas être balayés en même temps que cette oligarchie, en sombrant dans les idéologies du sang, du sol et de la race, il nous faut raviver en nous-mêmes et en autrui la flamme qui nous fasse recouvrer notre dignité d’homme. Dans Le fil de l’épée, de Gaulle écrit, en parlant de l’ordre militaire en particulier, qu’« une vertu [lui] offre un idéal rajeuni, lui confère, par l’élite, l’unité des tendances, provoque l’ardeur et féconde le talent. Le Caractère sera ce ferment, le Caractère, vertu des temps difficiles ».
Il y a quelques jours, Jacques Cheminade disait à un groupe de militants qu’il existe deux types de leader : celui qui prend la responsabilité de faire concorder les opposés en les élevant au moyen d’un grand dessein pour l’humanité, et celui qui veut effacer les opposés en les noyant dans une grandeur factice ou une force mystique.
Tandis que l’oligarchie des incapables ressort ses vieilles recettes dans une tentative désespérée pour survivre, nous devons redonner aux citoyens le goût de défendre de belles et grandes idées, et de bâtir une République où chacun se pense comme un petit Président. Ce ferment existe, malgré les apparences, comme l’exprime à sa façon le slameur et écrivain Abd Al Malik : « La France, c’est une philosophie, des principes, des valeurs, mais qui n’existent pas réellement, profondément et sincèrement incarnés. Et donc, la France, c’est toi, c’est moi, ce sont des hommes et des femmes. On doit revenir à l’avant-garde de tout cela. Pour moi, il y a un véritable génie français, comme si la France ne pouvait exister que dans la grandeur. Si on ne la magnifie pas, ce n’est pas la France, c’est une caricature. (…) Le nationalisme est une chose mortifère, c’est la peur, le repli sur soi, la France de culture chrétienne, la France blanche, un fantasme du passé qui n’existe plus. Le patriotisme, c’est dire que quelque chose dépasse la couleur de peau ou la religion, quelque chose qui ramène à la vie, qui parle de la diversité comme richesse. »