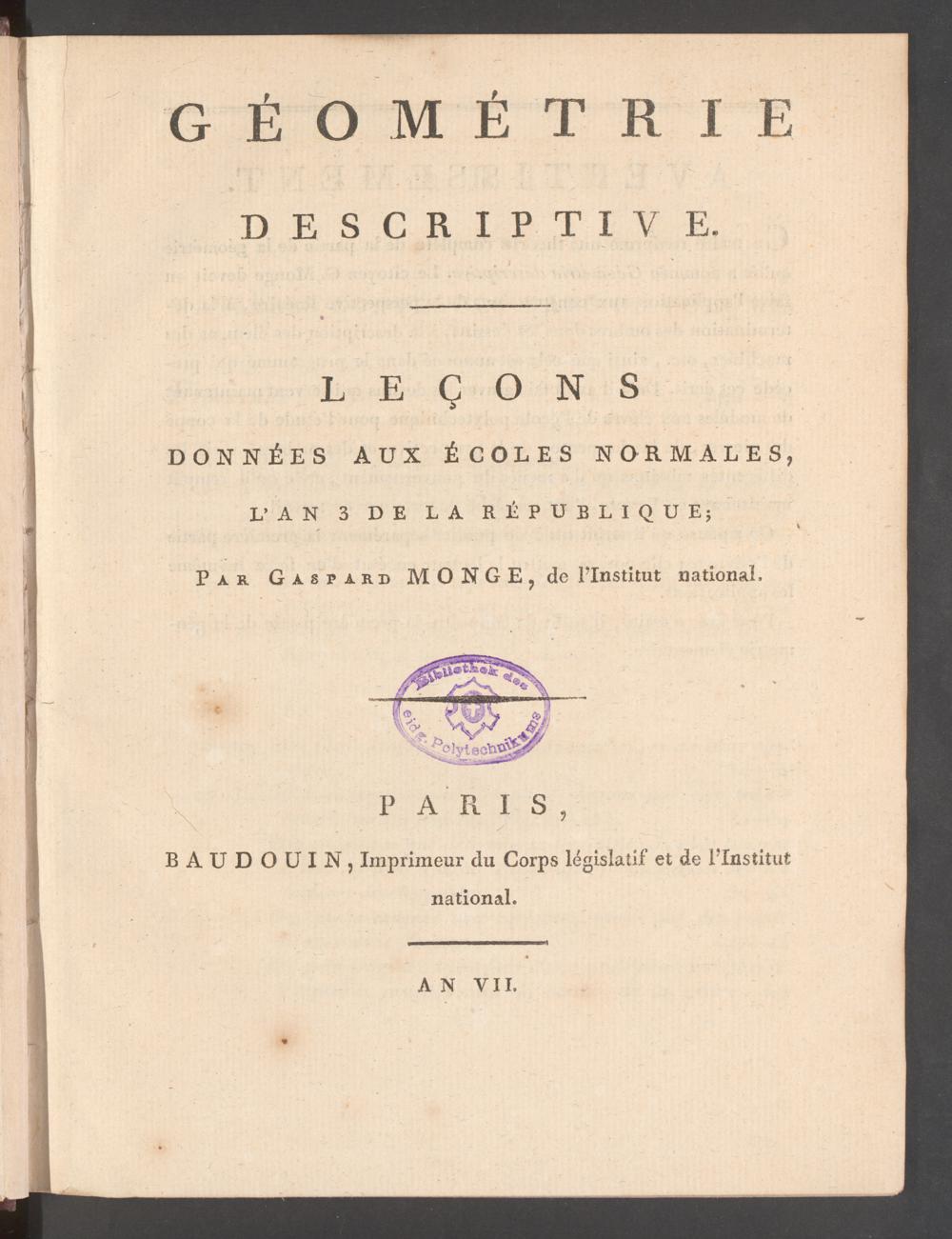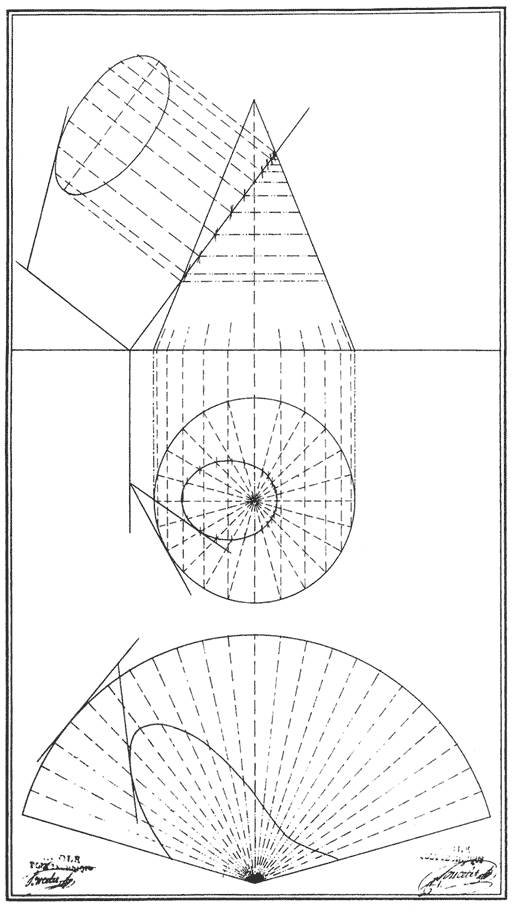Voici des textes tirés de La science de l’éducation républicaine, Campaigner Publications, 1980.
Lorsque les lumières rendues populaires feraient partout déterrer les hommes de génie ; lorsque ceux-ci augmentant la masse des lumières acquises, dirigeraient les efforts de la multitude ; et lorsqu’en faisant tout pour le peuple ce qui tourne toujours au profit du riche (...), on soulagerait le pauvre d’une foule de travaux pénibles en mettant à contribution non l’ignorance des peuples voisins, mais les forces inépuisables de la nature, et ne réservant à l’homme que l’exercice de son intelligence pour diriger l’emploi de ces forces.
Voilà ce qui a fait désirer aux hommes éclairés les gouvernements républicains : c’est le seul gouvernement qui puisse entretenir une exaltation continuelle et une disposition habituelle de la part de tous ses membres, au dévouement et au sacrifice pour la patrie. C’est le seul qui puisse donner à l’esprit humain toute sa perfection, c’est le seul qui ne trouve rien de difficile, rien d’impossible de la part d’une grande nation. Mais pour cela, il vaudrait mieux avoir des Républicains sans République qu’une République sans Républicains.
Gaspard Monge
L’histoire de la Révolution française a été si mystifiée que les simples « droits démocratiques » et la « liberté » dont jouissent aujourd’hui les citoyens de France et des autres nations capitalistes européennes passent pour la principale conquête de cette période révolutionnaire, une conquête que nous devrions aux Jacobins, aux sans-culottes et à la prise de la Bastille. Il est grand temps de démonter la supercherie et de jeter aux poubelles de l’histoire ces instruments de la politique britannique, les Mirabeau, Danton et autres Marat tenus aujourd’hui encore pour les grandes figures de la Révolution française. II est surtout grand temps que les hommes qui ont eux dirigé l’authentique Révolution française, relégués à un rang secondaire de l’histoire ou enfouis plus profondément sous des calomnies, soient connus du grand public pour la contribution cruciale qu’ils ont faite au développement de la civilisation humaine.

C’est en fait la création de l’Ecole polytechnique qui incarne la plus grande réalisation de la Révolution, car ce fut l’expression institutionnelle la plus poussée du vaste effort mené par l’élite platonicienne française gravitant autour de Gaspard Monge, de Lazare Carnot et de Prieur de la Côte d’Or pour bâtir une véritable république en France et des nations républicaines semblables dans toute l’Europe.
Ce dessein n’avait rien à voir avec le fait d’accorder à la population la « liberté » de choisir l’ignorance et le « droit » de rejeter le progrès scientifique comme les Enragés le proposaient alors et comme les partisans de l’ayatollah Khomeini le proposent aujourd’hui en Iran. La liberté et les droits de citoyens républicains signifiaient aux yeux des véritables dirigeants de la Révolution la possibilité pour des couches de plus en plus nombreuses de la population d’accéder au plus haut niveau de connaissance et de pratique sociale afin de contribuer à la prospérité générale de la nation.
Ces dirigeants humanistes durent engager une lutte sans répit contre les menées subversives et terroristes orchestrées par l’Angleterre et ses alliés, et ils la menèrent sur un large front épistémologique où les principes les plus avancés de la science militaire, de l’éducation et de l’économie politique servaient une seule et même politique républicaine.
La lutte qui se déroulait alors n’était pas celle, manipulée, qui opposait en apparence les Jacobins aux Girondins, ni, comme le suggère le schéma simpliste de la lutte des classes, le seul conflit entre un Ancien régime féodo-aristocratique et un ordre bourgeois-capitaliste émergeant : la véritable lutte opposait la vision du monde bestialiste qui sous-tendait la politique britannique, adoptée par Voltaire, Rousseau, Mirabeau et les masses « écologistes » que William Pitt et Marat lançaient comme un bélier contre la science, qui n’étaient que les instruments d’une conspiration britannique destinée précisément à empêcher l’établissement en France et en Europe de républiques alliées aux Américains - et les héritiers des grands bâtisseurs de nations, Louis XI, Henri IV, Colbert et Leibniz, les républicains acquis au progrès scientifique, économique et social dans lequel ils voyaient la condition nécessaire de la dignité et de la moralité humaines.
L’importance de l’Ecole polytechnique ne tient toutefois pas simplement à l’institution elle-même, qui a malheureusement été rapidement déviée de son objet original, mais à ce qu’elle a représenté historiquement et en termes scientifiques une percée, la solution épistémologique à une grave crise, une forme supérieure d’organisation sociale de la connaissance humaine platonicienne, qui a imprimé un élan crucial au progrès scientifique et technique dans toute l’Europe et au-delà. Il n’est pas exagéré de dire que sans l’Ecole polytechnique, les réalisations de l’école de mathématiques de Göttingen et celles de la physique moderne auraient été impossibles ; sans elle, on ne pourrait pas plus expliquer la réémergence durant la seconde moitié du XIXe siècle du courant scientifique leibnizien avec Pasteur, Vernadski, Poincaré et de Broglie.
La question à laquelle il nous faut répondre aujourd’hui est celle-ci : comment cette poignée d’hommes, « nés pour faire reculer les frontières de l’esprit humain » comme l’a dit leur jeune élève et collaborateur Charles Dupin, ont-ils réussi, avec si peu de moyens et dans des conditions aussi hostiles à vaincre militairement la puissante Coalition qui assaillait la France tout en formant la première génération de cadres républicains qui allaient devoir bâtir les nouvelles nations du monde ? Quel était leur secret, quelle était leur méthode ?
Comprendre ceci aujourd’hui ne relève aucunement d’un exercice de rhétorique : ce n’est qu’à cette condition que les dirigeants pro-humanistes du monde pourront anéantir l’actuel plan anglo-américain de « désintégration contrôlée de l’économie mondiale » et de nouvel âge des ténèbres et faire face à la tâche gigantesque qui consistera à établir un nouvel ordre économique de progrès scientifique et technique - un âge de la raison. Les succès de la méthode républicaine d’éducation sont un exemple pour rebâtir en France une vraie république, et un modèle exaltant pour le Tiers-monde dont la population se trouve généralement à l’heure actuelle dans des conditions matérielles et culturelles qui ne sont pas très différentes de celles que connaissait la population française à la fin du XVIIIe siècle.
Le complot britannique
Avant de nous tourner vers l’Ecole en tant que telle et quelques unes de ses implications immédiates, il est bon de se remémorer l’effroyable climat de chaos social, économique et politique dans lequel elle fut créée, climat qui fut marqué par l’infâme mouvement des sans-culottes contre la science et l’éducation.
De peur que le soulèvement qui éclata en France en 1788, en réaction contre l’incapacité de l’Ancien régime féodal à satisfaire les besoins essentiels de la société, ne mène à une réédition de la Révolution américaine et à l’instauration d’une République acquise au progrès à laquelle aspirait le « Parti américain » regroupé en France autour du Marquis de La Fayette, les Britanniques entreprirent immédiatement de mettre sur pied une coalition militaire européenne, dont la Prusse et l’Autriche allaient être les piliers, dans le dessein d’écraser la France et les dangereux développements républicains qui menaçaient l’Europe.
A l’intérieur, le ministre des Finances Necker et les cercles de la finance suisse auxquels il appartenait lancèrent l’opération des marchands girondins dont le but était de transformer la France en un Etat modelé sur l’Angleterre qui aurait été placé sous le contrôle de l’axe bancaire Genève-Amsterdam.
L’idée était de fonder cet Etat sur le paiement de la dette française, dont les Suisses possédaient la plus grande part et de l’orienter vers une politique impérialiste du type britannique, qui aurait promu le trafic d’esclaves et le pillage des villes et de la jeune République américaine. L’arrivée en Europe des produits agricoles venant des plantations des colonies françaises donnait lieu à une spéculation effrénée, et le paiement de la dette suisse était essentiellement assuré par le produit de ce pillage mercantilo-monétariste.
En 1793, les établissements financiers anglais qui contrôlaient une partie moindre de la dette française décidèrent d’escalader leur guerre contre la France car celle-ci représentait un danger non seulement en tant qu’Etat républicain en puissance, mais aussi en tant qu’éventuel empire marchand rival. Les Britanniques donnèrent alors un tour « anti-esclavagiste » et pro-jacobin à leur menées dans ce pays et y provoquèrent une grave crise inflationniste en le coupant de ses approvisionnements en provenance des Antilles (ils fomenteront par la suite le soulèvement contre les colons dirigés par Toussaint l’Ouverture).
L’économie française s’effondra sous le coup de l’opération des « assignats », cette monnaie de papier gagée sur les terres expropriées à l’Eglise et garantie par l’Etat, qui se mit à proliférer alors que la valeur réelle des terres inexploitées demeurait fixe et que l’économie n’était plus dopée par l’arrivée de produits coloniaux. En conséquence, toutes les banques suisses indépendantes s’écroulèrent et les autres, à savoir celles qui se trouvaient mieux intégrées dans le réseau européen des banques protestantes, se rangèrent du côté de Londres.
Une fois mis à bas le système bancaire qui contrôlait la France, les Britanniques et leurs agents jacobins plongèrent le pays dans le plus grand chaos économique et social et établirent le règne de la Terreur. La famine se déclara à la suite du stockage des céréales par les monopolistes à des fins spéculatives. Le système d’enseignement, aussi réduit qu’il était, avait été totalement démantelé avec l’expropriation des biens de l’Eglise et la suppression des congrégations religieuses qui assuraient pratiquement toute l’éducation dans le pays à l’époque. Les collèges avaient été fermés ou désertés.
La majorité des jeunes gens entre 18 et 25 ans qui se destinaient à l’enseignement avaient été enrôlés dans l’armée [1].
L’étau des forces ennemies qui encerclaient le pays se resserrait tandis que les armées françaises étaient frappées par le plus grand désarroi ; les nouvelles recrues mobilisées n’avaient reçu aucun entraînement militaire préalable et le commandement militaire avait été saigné à blanc par le départ des officiers qui avaient déserté ou fui les persécutions des Jacobins.
L’assaut qui fut délibérément lancé contre la science dès le début de la Révolution, et qui culmina en 1793 avec la suppression de toutes les académies et, surtout, de l’Académie des sciences, la plus importante, est sans doute l’exemple le plus frappant de la malfaisance de la main qui manipulait la folie des masses et la fureur jacobine ; car au-delà des institutions, c’était l’élite scientifique humaniste toute entière qui était prise comme cible, force vive sur laquelle reposait le futur de la nation, et qui, pour ce qui était de ses représentants les plus importants, avait pourtant accueilli favorablement l’aube du nouvel ordre politique et social qu’elle voyait poindre dans la Révolution.

Quelques mois après la prise de la Bastille, des attaques virulentes éclataient contre toutes les académies et notamment contre l’Académie royale des sciences. « Les académies royales sentent l’esclavage ! » hurlaient les sans-culottes dans la rue.
Les nobles, qui formaient la majorité des académiciens, devenaient suspects par nature. La plupart des académiciens se voyaient accusés d’être des renégats, en vertu du simple fait qu’ils étaient « pensionnés par le Roi », y compris ceux d’entre eux qui étaient des Révolutionnaires convaincus.
En 1790, calomnies et attaques s’intensifient et une véritable machine de guerre est mise sur pied avec la parution d’un pamphlet fielleux appelant à la « suppression de tous les canons des sciences, des arts et de la littérature », accusant les académiciens de « manger la nourriture de quarante ménages » et d’être les « instruments de la tyrannie royale ».
Nul besoin de dire que l’Académie des sciences, qui avait été fondée par Colbert en 1666 sur les conseils de Leibniz, n’avait rien à voir avec quelque salon de parasites aristocratiques comme les clameurs des sans-culottes le laissaient entendre. Héritière directe de la politique colbertiste, l’Académie faisait partie intégrante du gouvernement et représentait la plus haute autorité scientifique et technique de l’Etat.
Toutes les inventions nationales lui étaient systématiquement soumises en vue de leur application pratique à des fins de progrès industriel, tandis que les différents ministères chargeaient régulièrement ses membres d’accomplir des travaux spécifiques. Les Académiciens étaient tenus de s’engager toute l’année dans des activités productives regardées comme « intenses » à l’époque.
Il en était particulièrement ainsi depuis qu’un nouvel élan avait été donné à une politique néo-mercantiliste dirigiste orientée vers le développement industriel sous l’influence de Trudaine et de Forbonnais dans les années 1770 (des travaux importants avaient notamment été réalisés par Monge et ses collaborateurs dans le domaine des techniques métallurgiques en vue de doter le pays d’une industrie de l’acier) et, dans les années 1780, sous celle du « Système américain » d’économie politique dont le grand émissaire en Europe avait été Benjamin Franklin, qui organisa des réseaux humanistes en France, notamment à partir de l’Académie des sciences dont il était un membre éminent.
En 1790, l’Assemblée constituante avait chargé l’Académie d’élaborer un système national uniforme de poids et mesures, une tâche à laquelle les académiciens déployaient des efforts majeurs en s’efforçant de lui donner une base solide, notamment avec l’adoption du système décimal.
Toutefois, les requêtes continuelles de l’Académie pour obtenir les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet restaient vaines ; et ce, malgré le fait que dans tout le pays, la demande se faisait insistante, à travers les Cahiers de doléances, en faveur d’un tel système uniforme, et malgré le fait que les académiciens eux-mêmes faisaient valoir avec force que cette tâche était véritablement « civique » puisqu’elle était des plus susceptibles à favoriser le commerce en développant les échanges à l’échelle nationale.
C’est alors que le psychotique Marat, pantin des Britanniques s’il en fut, entra en scène pour orchestrer la campagne déchaînée contre la science et le progrès par le biais de son journal délirant L’Ami du Peuple. Un coup d’œil sur le pedigree de Marat nous aidera à comprendre toute la perfidie que recélait son cri de ralliement à l’adresse des Enragés : « Les académies sont des zoos, où, à grand frais, les charlatans et les pédants sont rassemblés ». Marat avait alors derrière lui une longue histoire de démêlés avec les cercles de l’Académie des sciences qui l’avaient rejeté dès 1766, le considérant à juste titre comme un dérangé.
A la suite de quoi Marat avait passé onze années en Angleterre pour réapparaître en France avec un titre frauduleux de « docteur en médecine », qui lui avait valu la place de docteur des écuries du Comte d’Artois, dont la santé mentale n’avait rien à envier à celle de Marat.
Jusqu’en 1789, Marat tenta maintes fois de pénétrer l’Académie des sciences à l’aide de diverses fraudes, et Franklin, célèbre de par ses découvertes sur l’électricité et véritable « cerveau » des cercles républicains, fut l’une de ses cibles favorites. En 1788, Marat, obscur charlatan, surgit sur la scène politique où, à grand renfort de calomnies et de concoctions mensongères, il attisa les masses contre l’« aristocratie du savoir » qui, selon la « Loi des Suspects » de 1793, devait être proscrite de la même manière que celle de naissance.
Le Comité d’instruction publique dut faire paraître un décret en 1793 qui éliminait toutes les académies. Le massacre de la Terreur n’épargna pas certains parmi les plus grands esprits de la nation. Bailly, maire de Paris et savant célèbre fut guillotiné.
Le Duc de la Rochefoucault, l’ancien Secrétaire particulier de Franklin, fut lynché par la foule sur le chemin de la guillotine. Le grand chimiste Lavoisier, qui tenta jusqu’à la dernière minute de sauver les travaux de l’Académie sur le système des poids et mesures, fut exécuté, Monge lui-même fut maintes fois harcelé et faillit se faire arrêter comme « émigré », pour avoir été trop indulgent envers les officiers de la noblesse et le camp girondin lorsqu’il occupait le poste de ministre de la Marine en 1792.
Lors de la réaction thermidorienne contre la Terreur en 1794, à l’issue de laquelle Robespierre fut éliminé, Carnot, ferme partisan d’un Etat centralisé, prit le contrôle effectif du Comité de Salut Public des mains de la faction Barras-Tallien qui représentait les marchands de Bordeaux et de manière plus générale les intérêts financiers ayant bâti leur fortune en spéculant sur les approvisionnements à l’armée ainsi que les paysans qui avaient profité de l’expropriation des biens de l’Eglise - faction qui était favorable à la décentralisation et à la restauration de la monarchie.

Avec Prieur de la Côte d’Or et Monge, l’« ingénieur-conseil » du Comité de Salut Public, Carnot réussit à maintenir dans l’arrangement politique complexe du Comité, un rapport de forces favorable à une remise en question fondamentale des aspects les plus destructeurs de la politique jacobine, Dans une situation qui demeurait politiquement très précaire [2], l’élaboration d’un plan de réorganisation de l’enseignement fut parmi l’une des premières mesures prises, plan qui se concrétisa immédiatement par la création de l’Ecole. « Un moment de tempête aurait suffit pour renverser ce phare érigé à la science et plonger à nouveau la France dans l’obscurité », déclara Biot, un des premiers élèves de l’Ecole, qui fut plus tard le grand professeur de chimie de Pasteur.
La politique de Monge, Carnot et de leurs plus proches collaborateurs a été aussi mal comprise et déformée que leur rôle général durant cette période sous-estimée. Au-delà de ses sinuosités et contradictions apparentes, (Monge appartint au Club des Jacobins mais fut fortement soupçonné de sympathie pour les aristocrates et les Girondins, Carnot fut exilé d’abord comme royaliste après le coup de Fructidor, puis comme antimonarchiste en 1815, et passe ordinairement pour un pur « opportuniste »), leur politique était celle de républicains convaincus et conséquents, qui plaçaient la notion de bien public au-dessus d’une obédience partisane - et c’est bien ce qui leur a permis de déjouer les manipulations britanniques du jeu politique en France à cette époque.
Par-dessus tout, Monge, Carnot et Prieur appartenaient à la conspiration humaniste transatlantique connue en France sous le nom général de « Parti américain », c’est-à-dire au véritable mouvement républicain qui s’était mobilisé pour soutenir la Révolution américaine.
L’indépendance de l’Amérique, conquise et assurée par le secours de nos armes, avait électrisé la nation, et dès lors, mille plans d’amélioration politique avaient germé dans toutes les têtes ; c’était le sujet de toutes les conversations ; les troupes, à leur retour de l’autre hémisphère, étaient flattées de s’entendre nommer les soldats de la liberté ; une étincelle pouvait, d’un moment à l’autre, causer un embrasement universel.
Voila comment un officier de Carnot, Tissier, décrivait la situation à la veille de la Révolution française. En tant que ministre de la Marine en 1792, Monge avait eu des contacts étroits avec la République américaine, et c’était La Rochefoucault, le proche ami de Franklin à Paris, qui avait introduit Monge à l’Académie des sciences en 1780, lorsque Franklin se trouvait encore en France. Carnot, dont le père connaissait Franklin pour qui lui-même avait la plus grande admiration, déclara ceci en 1805, après s’être insurgé contre le système napoléonien :
Ce n’est pas par la nature de leur gouvernement que les grandes républiques manquent de stabilité, c’est parce qu’étant improvisées au sein des tempêtes, c’est toujours l’exaltation qui préside à leur établissement. Une seule fut l’ouvrage de la philosophie organisée dans le calme : et cette république subsiste, pleine de sagesse et de vigueur : ce sont les Etats-Unis de l’Amérique septentrionale qui offrent ce phénomène, et chaque jour leur prospérité reçoit des accroissements qui étonnent les autres nations. Ainsi, il était réservé au nouveau monde d’apprendre à l’ancien.
L’« Ecole des Pythagore et des Platon »
« Le Comité doit vous dire que la grandeur de cette école est digne du peuple auquel elle est consacrée ; qu’elle satisfera doublement et aux besoins de la République et à l’instruction générale que le peuple réclame depuis 5 ans ; qu’elle répandra, de proche en proche, et dans toute la République, le goût si avantageux des sciences exactes, et que c’est enfin un puissant moyen de faire marcher d’un pas égal, le perfectionnement des arts utiles et celui de la raison humaine ».
Antoine Fourcroy, Rapport sur la fondation de l’Ecole polytechnique, 1794.
L’Ecole polytechnique fut essentiellement une victoire de la « science continentale » à un moment critique de l’histoire où l’antagonisme fondamental entre deux conceptions du monde avait été exacerbé de manière décisive par la Révolution américaine et la victoire du Système américain d’économie politique sur le système britannique.
Historiquement, il existe deux approches opposées à la science, qui correspondent à deux points de vue épistémologiques généraux : celle pour laquelle l’univers est une collection de particules et phénomènes discrets considérés comme premiers en eux-mêmes, et qui tente de définir les processus physiques selon un ensemble de lois fixes ; et celle pour laquelle ce ne sont pas les phénomènes particuliers qui sont fondamentaux mais le principe selon lequel la totalité qui les englobe est sujette à un changement continu, changement qui est médié par les phénomènes particuliers, vers des ordres supérieurs d’organisation.
La première de ces deux conceptions de l’univers est celle des « atomistes », Aristote, Newton, Hume, Locke, Voltaire et Rousseau, celle de l’empirisme britannique. Ces réductionnistes veulent que l’homme soit rivé à des lois fixes, ils lui nient la faculté de créer les outils avec lesquels découvrir des ensembles de lois supérieurs. La deuxième vision du monde est celle de Platon et du courant platonicien lié à Descartes, Leibniz et aux « hydrodynamistes » du XVIIIème siècle que les Britanniques détestaient et appelaient par dérision la « science continentale ».
Pour les platoniciens qu’étaient Monge et Carnot, l’objet de la science était d’accroître le pouvoir de l’homme sur l’univers par la découverte et la maîtrise de nouvelles lois, et ils avaient compris que ce faisant, l’homme s’engage dans un processus de soi-perfectionnement où la rationalité de cet univers qu’il peut maîtriser se reflète dans celle de son propre esprit.
La science permet à la société de se développer vers des ordres d’efficacité de plus en plus grands en termes de pratique humaine, et c’est précisément à travers ce processus que l’homme peut accéder à la raison. Contrairement aux mécanistes britanniques, pour Monge et Carnot la finalité du progrès scientifique ne réside pas tant dans ses applications pratiques que dans la moralité auquel il donne accès. A leurs yeux la science est nécessaire car elle est fondamentalement morale.
C’est là son ultime objet, comme les grands géomètres et économistes politiques du début du XIXème siècle le comprirent. Et c’est comment, au déchaînement de sauvagerie orchestré par Marat et à l’obscurantisme voltairien [3], voués l’un comme l’autre à préparer le terrain à la règle de l’empirisme et du bestialisme britanniques pour le compte des intérêts impérialistes de l’Angleterre, Monge, Carnot et Prieur opposèrent le projet extraordinaire de l’Ecole : ce projet, qui était en quelque sorte l’application sur le tas du principe de moindre action qui trouva toute son expression scientifique dans les travaux de Carnot en physique, représentait un défit direct lancé à la notion britannique d’univers fixe et une intervention décisive dans une situation de crise dont l’effet fut celui d’une « onde de choc ».
Ils organisèrent consciemment l’Ecole sur la base du principe de l’étude du processus de la science, du processus créateur menant aux découvertes scientifiques, le processus grâce auquel l’on découvre le pouvoir de ses propres facultés créatrices.
Et ce, pour que ce pouvoir soit rapidement développé, « multiplié », comme le dit Carnot, dans la population : éveiller l’esprit du plus grand nombre le plus vite possible, telle était la première condition à satisfaire pour bâtir une nation républicaine, de même que c’était la meilleure arme contre la subversion britannique. « Mieux vaut avoir des républicains sans République qu’une République sans républicains », affirmait Monge.

Avant et durant la mobilisation militaro-scientifique de 1793, la nécessité d’une école d’ingénieurs unique regroupant tous les corps existants avait été souvent discutée par Carnot, Monge et Prieur. Il existait alors principalement quatre écoles d’ingénieurs : l’école militaire de Mézières, où Monge enseigna et où Carnot et Prieur furent ses élèves, la plus avancée de toutes, réservées aux fils de la noblesse, l’école d’artillerie de Châlons-sur-Marne et les écoles d’ingénierie civile des Ponts et Chaussées et des Mines à Paris.
Les divisions très strictes qui séparaient ces différentes écoles leur étaient grandement préjudiciables. Les officiers de Mézières, par exemple, n’avaient pas le droit de communiquer leur connaissance plus avancée aux élèves de l’école d’artillerie de Châlons, dont les plus sérieux d’entre eux devaient se rendre à Paris pour suivre des cours particuliers de physique et de chimie lorsqu’ils pouvaient se le permettre.
Lamblardie, qui était alors à la tête de l’Ecole des ponts et chaussées à Paris (ayant succédé à Trudaine), préconisait vivement la création d’une école préparatoire où les ingénieurs militaires et civils se verraient enseigner tous ensemble les « principes généraux des sciences ».
Une telle école, faisait-il valoir, permettrait, en mettant immédiatement un terme aux rivalités inutiles entre les différents corps d’ingénieurs, de commencer à former dans le pays une force de cadres scientifiques et techniques compétents.
La Commission chargée d’élaborer le plan d’enseignement et d’organisation de l’Ecole centrale des travaux publics comme l’Ecole polytechnique s’appela la première année, fut choisie parmi les scientifiques qui avaient travaillé avec le Comité de salut public et le Comité d’instruction publique, et qui représentaient en fait le « noyau dur » de la mobilisation scientifique et militaire de 1793, tels Monge, Prieur, Lamblardie, Fourcroy, Berthollet, Chaptal, Guyton de Morveaux, Hassenfratz et Vauquelin.
L’idée centrale qui guida leur réflexion était que toutes les branches des services publics devaient se recouper dans leur théorie et leur pratique ; qu’elles requièrent toutes la même connaissance générale de base des arts graphiques ; et que de telles études générales « ne peuvent qu’être menées sous les plus grandes autorités scientifiques, dans le centre même des arts et sous la supervision des savants les plus distingués », comme le dit Pinet, un historien de l’Ecole. Ainsi, explique Biot pour sa part, l’Ecole fut fondée « premièrement, pour former des ingénieurs ; deuxièmement, pour répandre les lumières dans la société civile ; et troisièmement, pour éveiller les talents qui peuvent faire avancer la science. »
Gaspard Monge fut en fait le principal architecte de l’Ecole. En véritable savant républicain, son premier souci était de créer les moyens avec lesquels réaliser le progrès économique et social qui permet d’élever la population à la moralité ; l’Ecole, qui allait incarner le meilleur de la tradition platonicienne, fut l’instrument de ce dessein. « C’était une idée éminemment philosophique, éminemment nationale que de donner à chaque élève dans un service public une connaissance générale suffisante de tous les autres services », affirma Dupin, pour qui l’Ecole était celle « des Pythagore et des Platon ».
Les Développements sur l’Education adoptés pour l’Ecole des travaux publics qui circulèrent largement avant le décret établissant l’Ecole elle-même en 1794, sont fortement empreints de l’influence de Monge, notamment lorsqu’il y est souligné que le besoin de cadres scientifiques découle de la nécessité de développer l’industrie nationale - un progrès à son tour nécessaire pour consolider la République, comme Monge l’explique par ailleurs clairement dans le Programme qui sert d’introduction à son Traité de Géométrie descriptive (voir encart ci-dessous intitulé « La géométrie descriptive et le perfectionnement de l’espèce humaine » ).
La géométrie descriptive et le perfectionnement de l’espèce humaine
Pour tirer la nation française de la dépendance où elle a été jusqu’à présent de l’industrie étrangère, il faut premièrement, diriger l’éducation nationale vers la connaissance des objets qui exigent de l’exactitude, ce qui a été totalement négligé jusqu’à ce jour, et accoutumer les mains de nos artistes au maniement des instruments de tous les genres, qui servent à porter la précision dans les travaux, et à mesurer ses différents degrés : alors les consommateurs, devenus sensibles à l’exactitude, pourront l’exiger dans les divers ouvrages, y mettre le prix nécessaire ; et nos artistes, familiarisés avec elle dès 1’âge le plus tendre, seront en état de l’atteindre.
Il faut, en second lieu, rendre populaire la connaissance d’un grand nombre de phénomènes naturels, indispensable aux progrès de l’industrie, et profiter, pour l’avancement de l’instruction générale de la nation, de cette circonstance heureuse dans laquelle elle se trouve, d’avoir à sa disposition les principales ressources qui lui sont nécessaires.
Il faut enfin répandre, parmi nos artistes, la connaissance des procédés des arts, et celle des machines qui ont pour objet, ou de diminuer la main-d’œuvre, ou de donner aux résultats des travaux plus d’uniformité et plus de précision ; et, à cet égard, il faut l’avouer, nous avons beaucoup à puiser chez les nations étrangères.
On ne peut remplir toutes ces vues qu’en donnant à l’éducation nationale une direction nouvelle.
C’est, d’abord, en familiarisant avec l’usage de la Géométrie descriptive tous les jeunes gens qui ont de l’intelligence, tant ceux qui ont une fortune acquise, afin qu’un jour ils soient en état de faire de leurs capitaux un emploi plus utile, et pour eux et pour l’Etat, que ceux mêmes qui n’ont d’autre fortune que leur éducation, afin qu’ils puissent un jour donner un plus grand prix à leur travail.
Cet art a deux objets principaux.
Le premier est de représenter avec exactitude, sur des dessins qui n’ont que deux dimensions, les objets qui en ont trois, et qui sont susceptibles de définition rigoureuse.
Sous ce point de vue, c’est une langue nécessaire à l’homme de génie qui conçoit un projet, à ceux qui doivent en diriger l’exécution, et enfin aux artistes qui doivent eux-mêmes en exécuter les différentes parties.
Le second objet de la Géométrie descriptive, est de déduire de la description exacte des corps tout ce qui suit nécessairement de leurs formes et de leurs positions respectives. Dans ce sens, c’est un moyen de rechercher la vérité ; elle offre des exemples perpétuels du passage du connu à l’inconnu ; et parce qu’elle est toujours appliquée à des objets susceptibles de la plus grande évidence, il est nécessaire de la faire entrer dans le plan d’une éducation nationale. Elle est non-seulement propre à exercer les facultés intellectuelles d’un grand peuple, et à contribuer par là au perfectionnement de l’espèce humaine, mais encore elle est indispensable à tous les ouvriers dont le but est de donner aux corps certaines formes déterminées ; et c’est principalement parce que les méthodes de cet art ont été jusqu’ici trop peu répandues, ou même presque entièrement négligées, que les progrès de notre industrie ont été si lents.
On contribuera donc à donner à l’éducation nationale une direction avantageuse, en familiarisant nos jeunes artistes avec l’application de la Géométrie descriptive aux constructions graphiques qui sont nécessaires au plus grand nombre des arts, et en faisant usage de cette Géométrie pour la représentation et la détermination des éléments des machines, au moyen desquelles l’homme, mettant à contribution les forces de la nature, ne se réserve, pour ainsi dire, dans ses opérations, d’autre travail que celui de son intelligence
Il n’est pas moins avantageux de répandre la connaissance des phénomènes de la nature, qu’on peut former au profit des arts.
Le charme qui les accompagne pourra vaincre la répugnance que les hommes ont en général pour la contention d’esprit, et leur faire trouver du plaisir dans l’exercice de leur intelligence, que presque tous regardent comme pénible et fastidieux (...)
Gaspard Monge. « Programme » de son Traité de Géométrie descriptive, 1795.
Monge joua également un rôle décisif dans l’élaboration du Plan d’instruction pour l’Ecole, et c’est là que s’exprime tout le génie de ces hommes qui avaient déjà défié la crise en appliquant le principe de moindre action durant la mobilisation militaire.
A ce moment-là, l’Etat n’avait plus de fonds, plus de crédit. Un million de soldats avaient été mobilisés mais il n’y avait pas d’armes à leur donner.
Jusque-là, le bronze, le fer, l’acier et même la poudre à canon avaient été fournis par l’étranger, notamment l’Angleterre et l’Allemagne. Une mobilisation scientifique nationale fut déclarée pour remédier à cette situation désastreuse.
Monge dirigea la production de toutes les armes et entreprit de donner un développement soudain et massif à la productivité des métallurgistes, des mécaniciens et des chimistes, les formant intensivement aux nouvelles techniques qu’il avait lui-même mises au point avec Berthollet et leurs collaborateurs.
Monge se rendait dans toutes les fonderies pour y introduire ces nouvelles techniques et donner des cours de formation sur le tas aux ouvriers, tandis que circulait partout un Avis aux Ouvriers en Fer qu’il avait rédigé avec Vandermonde pour leur donner « les notions qui doivent vous guider dans une entreprise qui est généreuse pour le moment et sera utile à notre industrie future ». Des milliers de travailleurs qualifiés furent ainsi formés pendant cette mobilisation.
L’Ecole, de même, devait amorcer un processus permettant à la science et aux techniques de progresser le plus efficacement possible, avec des moyens aussi réduits qu’ils pouvaient l’être. L’une des plus grandes difficultés fut celle d’impulser le premier mouvement à l’instruction générale qui allait ensuite transformer la situation de manière exponentielle.
Ce problème avait été mis en relief par l’échec de l’Ecole normale l’année précédente, une école où devaient être formés les futurs enseignants, où, pour citer Dupin, « la science même de l’éducation allait être enseignée ».
L’écart entre la qualité de l’éducation qui devait y être donnée et le niveau médiocre des élèves s’avéra pratiquement insurmontable. Il fallait résoudre ce problème en ce qui concerne l’Ecole polytechnique, et pour ce faire, il fallait l’aborder selon le principe physique de néguentropie tel qu’il joue, par exemple, dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée : pour obtenir une réaction en chaîne de fusion nucléaire et la libération d’une masse d’énergie à très haute densité, l’apport initial d’énergie doit être très élevé et transmis efficacement.
Les brigades de Monge
Il fallait trouver le moyen de transmettre le plus efficacement possible une connaissance « à densité élevée » aux élèves qui devaient en reproduire les effets. Avec toutes les ressources morales et intellectuelles de sa profonde adhésion à l’idée républicaine de progrès, Monge mit au point la méthode qui permit à l’Ecole polytechnique de démarrer : ce fut le système des « chefs de brigades ».
Sur les 396 élèves qui avaient été admis à l’Ecole à la suite d’un examen national, seul un tiers avait reçu une éducation du niveau du collège. Les élèves furent divisés en 25 brigades et chaque brigade reçut un « chef » que Monge sélectionna parmi les plus avancés de ces jeunes ; il leur donna lui-même initialement une formation très intense lors d’une véritable école de cadres à laquelle il se consacra jour et nuit, alternant les cours particuliers et les cours par groupes.
L’idée était de permettre rapidement aux chefs de brigades de s’assurer que tous les élèves de l’Ecole allaient progresser d’un même élan sur une voie « où chacun devait avancer à pas de géant » comme le dit Dupin, en aidant systématiquement ceux qui rencontraient des difficultés pour que ne soit pas entamée l’efficacité générale recherchée.
Ce fut durant ces trois premiers mois que Monge forma le noyau de l’Ecole, par des efforts considérables, et que le programme de l’Ecole fut présenté et les méthodes d’enseignement testées.
C’était aussi, après la brève expérience de l’Ecole normale de l’année précédente, la première fois que Monge enseignait en public sa géométrie descriptive (qui avait été frappée au sceau du secret militaire à Mézières pendant de longues années auparavant), recherchant toujours les meilleurs résultats pédagogiques, recourant à des manuscrits en sa possession pour remédier au manque de manuels, utilisant des modèles de bois ou de pierre, des heurismes graphiques, etc.
Monge avait refusé de prendre la tête de l’Ecole afin de pouvoir se consacrer entièrement à ses activités scientifiques et pédagogiques ; mais en fait, c’était lui qui représentait la plus grande autorité. Comme Dupin, Biot et de nombreux autres l’ont noté, ses qualités remarquables de savant et de pédagogue jouèrent un rôle déterminant ; les plus brillants de ses élèves devaient marquer profondément les développements humanistes au cours de la première moitié du XIXe siècle en Europe.
Bien que tous les instituteurs de l’Ecole n’eussent pas la dimension de Monge, figuraient parmi eux les plus grandes autorités scientifiques et artistiques du pays, des hommes dont le nom était lié aux travaux les plus avancés dans le domaine des mathématiques, de la physique et de la chimie, tels Lagrange, Guyton de Morveau, Fourcroy, Berthollet.
Monge : un pédagogue passionné

Monge ne se contentait pas d’expliquer aux élèves, dans ses leçons périodiques et dans les salles d’études, les théories de la science et leurs applications. Il aimait à conduire ses disciples partout où les phénomènes de la nature et les travaux de l’art pouvaient rendre sensibles et intéressantes ces applications. Le terrain qui entoure Mézières, par sa variété, sa richesse minérale et ses accidents, est éminemment propre aux démonstrations de la physique et de la géologie.
En même temps, cette contrée, exploitée par des hommes industrieux, présente une foule de manufactures, soit pour les arts civils, soit pour les arts militaires. Monge étudiait avec une égale ardeur et les phénomènes de la nature et les phénomènes de l’industrie ; il acquérait des lumières pratiques qui devaient un jour puissamment contribuer au salut de la patrie, et s’empressait d’en faire jouir la jeunesse studieuse.
Dans ces excursions, faites aux jours de congé, par les plus beaux temps de l’année, au milieu des sites les plus pittoresques, l’imagination de Monge semblait s’agrandir comme les aspects offerts à ses regards par la nature ; il communiquait à ses disciples son ardeur et son enthousiasme, et changeait en plaisirs passionnés des observations, des recherches appliquées à des objets sensibles, qui, faites dans l’enceinte d’une salle et par des considérations abstraites, n’eussent paru qu’une pénible étude.
Il est arrivé parfois que, pour gagner plus tôt quelque usine sans aller chercher des routes et des ponts, Monge continuant ses explications à ses élèves, s’avançait à travers un large ruisseau, le passait à gué sans s’interrompre, sans que les jeunes gens qui l’entouraient cessassent de se presser autour de lui, en silence, et tout absorbés par les vérités qu’il dévoilait à leur intelligence : tant était grande et magique la puissance qu’il exerçait sur leurs esprits !
Charles Dupin, Essai historique sur les travaux scientifiques et les services de Gaspard Monge, 1819
Le Journal de l’Ecole polytechnique : Faire avancer les lumières générales
« L’objet de ce journal, publié en vertu d’un arrêté des trois Comités de la Convention qui surveillent l’Ecole centrale des travaux publics, se trouve dans les motifs exprimés au considérant de l’arrêté de ces Comités, savoir : de justifier l’emploi des moyens que la République fournit pour l’instruction des élèves ; de les encourager, ainsi que ceux qui concourent à leur enseignement, par la publicité donnée à leurs travaux et à leurs soins ; de faire prendre aux études une direction qui tende sans cesse à les perfectionner ; d’offrir un modèle propre à guider d’autres établissements d’instruction ; enfin de répandre des connaissances très-utiles aux arts ou aux sciences, et de provoquer l’extension de leur domaine par des découvertes nouvelles ou des applications heureuses (...)
Chaque mois, il paraîtra un cahier de ce bulletin ; on y trouvera des comptes-rendus, rédigés ordinairement par les instituteurs, chacun pour la partie qui le concerne. Ces comptes-rendus donneront, en chaque genre, la notice du travail fait dans le mois. Les découvertes et les solutions élégantes de problèmes, fournies, soit par les instituteurs, soit par les élèves, y seront également insérées : ce cahier en présentera quelques exemples intéressants. Les instituteurs et tous les agents attachés à l’école pourront aussi faire paraître des mémoires relatifs aux sciences ou aux arts, quel qu’en soit l’objet ; il suffira qu’ils contiennent des vérités utiles à répandre, ou des nouveautés propres à faire avancer les lumières générales (…)
Par rapport au cours de physique, on a l’intention que les expériences qui s’y feront en présence des élèves, aient pour objet, autant qu’il sera possible, ou de constater quelque phénomène nouveau, ou de redresser des erreurs dans les explications des faits déjà connus. Dans cette vue, on formera le projet d’une série d’expériences les plus intéressantes à tenter ; et la publicité qui leur sera donnée, à mesure qu’elles seront exécutées, contribuera efficacement au progrès de la science (...)
Si l’on se représente un moment par la pensée quatre cents jeunes gens, choisis par leurs premières connaissances mathématiques, rassemblés sur un amphithéâtre, écoutant les instituteurs qui viennent successivement, dans l’espace de trois mois, leur présenter le magnifique tableau des sciences et des arts dont ils apprécieront en détail les diverses parties pendant leur séjour à l’école ; si l’on voit ensuite ces élèves, se distribuant par brigades de vingt, dans des salles où ils travaillent six heures chaque jour, tracer les nombreux objets de la géométrie descriptive qu’on leur enseigne ; si de là, on les suit dans un local orné de tout ce qui peut embellir leur imagination et former leur goût pour le dessin, sur lequel ils s’exercent pendant les trois dernières heures du jour, en alternant par divisions pour l’étude de l’analyse pendant le même temps ; si enfin on les retrouve, deux jours de chaque décade, dans des Laboratoires de chimie, manipulant eux-mêmes, après avoir reçu la leçon de leur instituteur, et s’y délassant, par l’exercice du corps et l’attrait de tant d’objets curieux, de l’application donnée, les autres jours, aux objets plus sérieux des mathématiques ; quel intéressant spectacle ! Qui ne se sentira heureux et ne se glorifiera pas d’avoir contribué à l’instruction, aux premiers essais, aux progrès, d’une jeunesse si chère à la République par l’espoir qu’elle lui donne ! (…)
Il reste maintenant à annoncer en peu de mots les modifications que l’on croit devoir introduire pour l’avenir dans le plan du Journal (...)
Les instituteurs, les agents de l’école, les élèves sont invités à fournir des mémoires sur les sciences et les arts, soit qu’il s’agisse de travail fait dans l’établissement, soit de recherches tirées d’ailleurs.
Les mémoires de même genre qui seraient adressés par des savants en correspondance avec l’école, seraient également accueillis (...)
Et de temps en temps, l’on y joindra l’exposition de la situation de l’école et de son régime.
La partie historique de sa formation et de ses progrès, la description des collections de machines, modèles ou dessins qu’elle renferme ; l’annonce de ce qu’il y aura d’heureux, de nouveau, de plus expéditif dans les méthodes d’enseignement ; des détails sur les opérations, sur la qualité du travail exécuté, qui en fassent concevoir la possibilité, qui mettent à portée d’en faire ailleurs la répétition ; des vues sur les qualités que l’on doit s’attacher à former, à développer, à porter au plus haut degré dans les élèves, pour les rendre vraiment propres aux différents services publics, et tant d’autres considérations importantes à tirer d’un sujet si fécond, nous semblent dignes d’être offertes au public.
Nous ferons tous nos efforts pour remplir son attente, ainsi que les intentions du Gouvernement, en nous attachant sans cesse à perfectionner l’institution confiée à nos soins, et en contribuant de tous nos moyens à la communication des lumières et à l’accroissement de l’instruction générale ».
Journal de l’Ecole polytechnique, avant propos, 1795
Le Journal de l’Ecole polytechnique fut conçu comme l’instrument d’une importante propagande pédagogique et scientifique (voir encart ci-dessus « Le Journal de l’Ecole polytechnique : Faire avancer les lumières générales »). Son but était de présenter de manière pédagogique certains des aspects les plus importants des travaux réalisés à l’Ecole, à la fois dans le cadre des cours et des recherches faites par les élèves, de sorte que d’autres établissements d’enseignement à travers le pays et au-delà des frontières soient en mesure de répliquer immédiatement ces travaux. Comme l’expliquent les rédacteurs du Journal, il s’agissait dans un même temps d’encourager les applications pratiques sur lesquelles pouvaient déboucher les découvertes scientifiques ainsi largement diffusées. L’Ecole polytechnique était conçue comme un modèle, un point de référence pour toutes les couches de la population engagées dans le processus de développement économique et la formation d’une force de travail qualifiée ; tout le matériau - méthodes pédagogiques, solutions imaginées par les professeurs et les élèves aux différents problèmes scientifiques et techniques, découvertes, expériences, instruments, etc. - qui pouvait contribuer à développer la connaissance et la pratique humaines dans toute la population était décrit, expliqué dans le Journal. Loin d’être considérés par les fondateurs de l’Ecole comme une élite de grands prêtres « détenant » la science et coupée de la population, les jeunes polytechniciens étaient explicitement encouragés à assumer directement la responsabilité de propager directement la connaissance scientifique dans toute la population. C’était là la mission morale qui leur était fondamentalement impartie. Car, en effet, « sans un admirable dévouement au progrès de leurs condisciples », les membres de toute élite républicaine dégénèrent et se condamnent à ne plus être des républicains, mais seulement des « élitistes ».
L’organisation initiale de l’Ecole comportait un autre aspect-clé qui était le fait de l’engagement républicain exemplaire de Monge et de Carnot. Tous deux représentaient de rares cas de « plébéiens » qui avaient réussi à se faire admettre à l’école militaire de Mézières ; tous deux ne parvinrent à leur degré de compétence scientifique et militaire qu’au prix d’une longue et amère histoire de harcèlement et de luttes humiliantes avec le système de l’Ancien régime où les carrières militaires et scientifiques étaient le privilège de la noblesse. Ceci n’était pas compatible avec le développement d’une nation de citoyens républicains. Les élèves de l’Ecole polytechnique, qui étaient admis pour la première fois dans une institution incarnant le plus haut niveau d’enseignement sans distinction d’origine sociale, devaient être entièrement pris en charge par l’Etat durant leurs trois années d’études. C’était le moyen de donner au plus grand nombre de citoyens, quelle que soit leur origine, la possibilité d’accéder à des qualifications scientifiques et techniques. De surcroît, les fondateurs de l’Ecole avaient prévu que les élèves vivraient en dehors de l’établissement, dans des familles républicaines de la capitale, où ils trouveraient une atmosphère encourageante pour leurs études, un soutien moral et des conditions matérielles adéquates. La population pouvait ainsi prendre conscience directement de l’importance de ces jeunes cadres qui allaient contribuer à développer la République. Avant la militarisation de l’Ecole, la discipline interne était quasiment assurée par les chefs de brigades qui jouissaient naturellement d’une grande autorité morale.
Telle qu’elle fut originellement conçue par Monge, Carnot, Prieur et leurs proches collaborateurs, l’Ecole polytechnique vécut moins de dix ans, malgré les âpres efforts qui furent déployés pour la sauvegarder. Les opérations hostiles à cette institution commencèrent dès 1795, une année seulement après sa création. La Convention tenta à plusieurs reprises de « purger » de l’Ecole les éléments prétendument « anticiviques » et antirépublicains, accusés de se livrer à des activités pro-royalistes en dehors des murs de l’Ecole. Il s’est sûrement trouvé un certain nombre de polytechniciens pour prendre part aux « chasses aux Jacobins » et autres agissements des gangs de Muscadins mais une telle « purge » n’aurait pas manqué d’être des plus préjudiciables au fonctionnement de l’Ecole, et c’était bien là l’effet escompté. Sous le Directoire, sommé une nouvelle fois de procéder à la répression des prétendus activistes, le conseil de l’Ecole refusa tout net de s’exécuter, conscient que la manœuvre était avant tout dirigée contre l’Ecole toute entière. Par ailleurs, le Comité des fortifications, avec l’aide du Ministre de l’intérieur Baraillon, tenta maintes fois de trouver des prétextes justifiant des mesures répressives à l’encontre de l’Ecole, arguant que celle-ci était trop « privilégiée » par rapport aux autres écoles d’ingénieurs et appelant à sa réorganisation sur un modèle militaire - réorganisation que Napoléon allait imposer en 1804. Plus insidieuse mais non moins dangereuse fut la subversion qui s’exerçât de l’intérieur de la part des réductionnistes tels Laplace, le mathématicien, qui réclamait une orientation plus « théorique » des études accusées d’accorder trop de place aux activités pratiques et concrètes !
Malgré toute l’affection qu’il avait pour Napoléon, Monge combattit avec acharnement la dénaturation que celui-ci fit subir à l’Ecole polytechnique. La décision de Napoléon d’en revenir au système de l’Ancien régime en ne recrutant à l’Ecole que des élèves originaires de familles riches fut particulièrement pénible pour un Monge qui, depuis son retour d’Egypte en 1799, avait été jusqu’à donner son salaire de professeur et sa pension de retraite pour aider les élèves les plus déshérités. Les fonds publics alloués à l’Ecole avaient déjà été drastiquement réduits en 1799, malgré l’opposition virulente de Prieur.
Le décret de Napoléon en date de 1804 imposant une « discipline militaire » à l’Ecole fut rejeté comme étant « désastreux » par Monge. Les élèves se virent ensuite contraints de payer une pension annuelle très élevée. Le contenu de l’enseignement se détériora rapidement, prenant une direction que Pinet décrit comme « fondamentalement » opposée aux idées des fondateurs de l’Ecole. Certains cours furent supprimés, notamment ceux d’ingénierie civile - décision à laquelle Monge s’opposa particulièrement. Le cours spécial de génie civil fut complètement éliminé en 1807, tandis que les « arts académiques » faisaient leur entrée en force avec la création d’une chaire de grammaire et de belles-lettres.
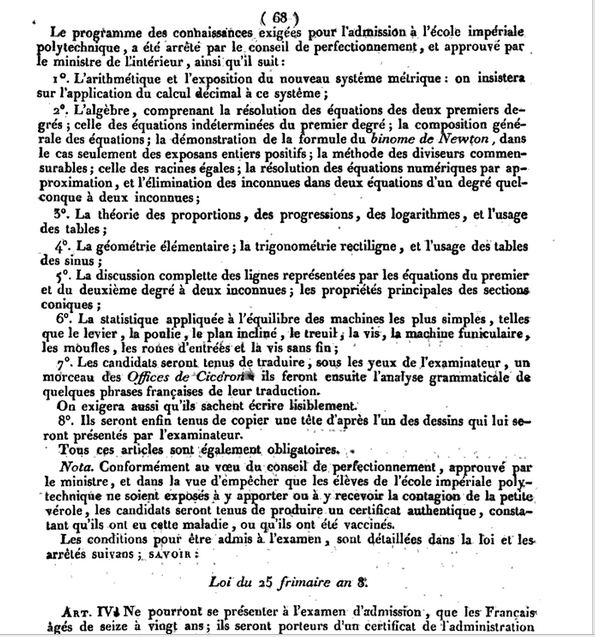
« Moins pour la science elle-même que pour les services qu’elle rend à l’autre » [4]
Avant d’entrer dans certains des aspects-clé de l’enseignement que reçurent les premiers Polytechniciens, il est important de voir comment le projet de l’Ecole polytechnique, dans son principe essentiel, fut une expression directe de la pensée platonicienne, la prolongation de l’œuvre réalisée par les réseaux humanistes que Leibniz et Descartes façonnèrent au XVIIème siècle et qui avait trouvé sa forme pratique la plus avancée dans le « Système américain ». En d’autres termes, l’Ecole était aussi l’œuvre des grands Oratoriens, d’une part, et de Franklin, de l’autre.
Benjamin Franklin, le « Sage de Boston », appartenait à l’Académie royale des sciences en vertu de ses découvertes sur l’électricité, et il participa régulièrement aux sessions de l’Académie durant les quatre années qu’il passa à Paris en tant qu’Ambassadeur de la République américaine.
Le « Prométhée moderne », comme on l’appelait dans les milieux humanistes français, jouissait d’un prestige considérable. Il avait établi ses quartiers généraux à Passy, qui n’était alors qu’un faubourg parisien et qui allait très vite devenir son « Versailles de la philosophie », d’où il se livra à d’intenses activités organisatrices au nom de l’Idée de progrès qui animait alors la République américaine. C’est ainsi qu’il organisa au sein de la franc-maçonnerie - qui regroupait certains des plus grands esprits du pays - une faction contre l’influence britannique du Duc d’Orléans.
En 1779, Franklin prit la tête de la célèbre Loge des Neuf Sœurs à Paris, année même où Monge rejoignit les réseaux maçonniques à Mézières. Sous l’impulsion de Franklin, la Loge connut un ·essor considérable les deux années qui suivirent, notamment dans le domaine de l’éducation. Comme Carnot l’explique dans son Rapport à l’Empereur sur l’Instruction (voir encart « Le grand art de l’économie politique » ci-dessous), l’effort des Pères fondateurs de l’Amérique pour promouvoir l’instruction était considéré comme exemplaire. Ce fut la Loge des Neuf Sœurs, par exemple, qui parraina le premier collège laïc public, suivant un plan suggéré directement par Franklin où l’accent était mis sur l’enseignement scientifique. Ce collège devint plus tard le Lycée de Paris, où Monge enseigna pendant près de deux ans.
Lorsqu’il organisa l’Ecole plus tard, Monge se servit de son expérience à Mézières et des méthodes employées à l’Ecole de Schemnitz, dont Mézières s’était inspirée, qui avait été fondée en Hongrie par Marie-Thérèse. Son docteur, Ingenhousz, était un vieil ami de Franklin de même qu’un ami de Monge. Schemnitz possédait un laboratoire de chimie célèbre, que Monge avait reproduit à Mézières.
Monge et Carnot avaient d’autre part été tous les deux éduqués chez les Oratoriens, et ceci, comme nous allons le voir, devait jouer un rôle essentiel dans leurs accomplissements futurs.
La Congrégation de l’Oratoire de Notre Seigneur Jésus-Christ en France avait été fondée en 1611 par le Cardinal Pierre de Bérulle, un proche ami de Richelieu, et plus tard, de Descartes, en tant qu’émanation directe du grand projet de réforme éducative d’Henri IV dont celui-ci avait saisi une commission qui y travailla de 1595 à 1600. En tant que congrégation religieuse, l’Ordre de l’Oratoire fut approuvé par le Pape Paul V en 1613 et encouragé à développer une vocation éducative pour contrer l’Ordre rival des Jésuites.

Alors que les Jésuites étaient principalement implantés dans les grandes villes et exerçaient leur influence sur les couches les plus riches de la population, les Oratoriens établirent leurs collèges dans les petites villes et ouvrirent leurs portes aux couches plus défavorisées. Les Pères oratoriens engageaient même souvent leur fortune personnelle pour aider les élèves les plus pauvres à suivre des études dans leurs collèges. En dépit des divers troubles que connut l’Oratoire durant l’agitation politique qui marqua la seconde moitié du XVIIe siècle - suite à la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV, et surtout après 1663, date à laquelle les travaux de Descartes furent mis à l’index et l’enseignement de la théorie cartésienne fut réprimée en France - l’Ordre de l’Oratoire réussit toujours à maintenir en son sein un noyau influent de Platoniciens convaincus, dont les plus éminents furent les philosophes-savants Lamy, le chef de file du parti cartésien en Anjou, Pelaud, qui succéda à Lamy lorsque celui-ci fut exilé, et Malebranche qui introduisit Leibniz dans l’enseignement oratorien. Cette élite livra une bataille continuelle contre les Thomistes au sein de l’Oratoire et contre les Aristotéliciens incarnés par les Jésuites, en dehors. Les Jésuites, fervents défenseurs du système aristotélicien, recommandaient officiellement à tous leurs professeurs de « suivre l’aristotélisme, non seulement en logique et en métaphysique, mais en philosophie naturelle ».
Sous les pressions de l’Etat, des mesures répressives furent maintes fois prises à l’encontre des disciples de Descartes dans l’Oratoire, qui suscitèrent de très vives réactions. La lutte opposait alors ouvertement les partisans de l’aristotélisme et ceux du platonisme, Descartes étant considéré par ses nombreux défenseurs dans l’Oratoire comme l’héritier direct de Platon. Dans des collèges oratoriens comme ceux d’Angers et de Saumur, la plupart des enseignants, fortement acquis aux idées de Descartes, refusèrent de ne plus enseigner ses thèses, ce qui valut à Lamy d’être exilé en 1676.
Richelieu et Mazarin appelèrent auprès d’eux d’éminents Oratoriens dans la conduite des affaires de l’Etat, tout en maintenant les Jésuites à distance - situation qui fut renversée par Louis XIV à sa majorité. Les Oratoriens retrouvèrent leur influence politique après l’expulsion des Jésuites hors de France en 1764 à l’instigation de Guyton de Morveau, mais furent éliminés avec toutes les autres congrégations religieuses en 1792 - mesure qu’un de leurs historiens a qualifiée de « violation des Droits de l’Homme », car avec eux, c’était la meilleure éducation populaire qui disparaissait.
L’un des grands principes de l’éducation oratorienne était que l’élève devait être lui-même un éducateur pour mieux apprendre. La fonction enseignante exercée par l’élève auprès de ses compagnons plus jeunes était considérée comme une source de bienfaits tel « le plaisir de communiquer ce que l’on sait, le fait d’avoir un but social et concret à atteindre, la nécessité d’apprendre et de se perfectionner pour mieux enseigner », comme le déclarait le Père Houbigant en 1720.
C’est pourquoi les Oratoriens avaient très vite établi le système des régents, c’est-a-dire des jeunes instructeurs, sur lequel Monge, qui enseigna lui-même la physique à l’âge de 16 ans au collège oratorien de Beaune, modela ses « chefs de brigades » à l’Ecole polytechnique.
Après quelques années d’études, les élèves des collèges oratoriens étaient vivement encouragés à devenir des régents, après quoi les régents avaient le choix entre devenir prêtres, acquérir un véritable poste d’enseignant ou quitter la congrégation pour des activités séculaires si tel était leur désir. En fait, la majorité du corps enseignant de l’Ordre était formée de jeunes régents, et c’est parmi eux que la théorie de Descartes trouva ses adeptes les plus convaincus.
En 1684, alors qu’il se trouvait en exil à Grenoble, Lamy écrivit un livre polémique exposant la méthode oratorienne dans ce qu’elle avait de meilleur.
Ce livre, intitulé Entretiens sur les sciences dans lesquels outre la méthode d’étudier, on apprend comment l’on doit se servir des sciences pour se faire l’esprit juste et le cœur droit, et accompagné de Réflexions sur l’art noétique, se présentait sous forme d’un dialogue entre Théodose (Lamy) et Aminte (incarnant des amis de Lamy restés à Angers). Le thème central en est une attaque de Théodose contre la manière aristotélicienne dont la philosophie était alors couramment enseignée, sous forme de commentaires dictés sur des idées philosophiques.
Théodose propose au contraire d’utiliser directement comme matériau d’une étude de la philosophie, les expériences et découvertes les plus importantes du siècle en cours, dans le domaine de la physique, des mathématiques, de la chimie, de l’anatomie, et de lire publiquement des textes originaux. Théodose suggère que les traités ainsi choisis soient ensuite discutés en public. Ce que Lamy voulait dire par là, c’est que la forme du dialogue platonicien devait jouer un rôle essentiel dans l’enseignement des Oratoriens. Et dans une certaine mesure, c’était déjà le cas : les cours se terminaient toujours sur une discussion animée entre le maître et les élèves et la tâche des régents était en fait d’organiser des dialogues platoniciens avec leurs jeunes camarades.
Cette idée fondamentale de Lamy, à savoir que « pour bien comprendre, il faut enseigner » fut reprise plus tard par Monge, dont les cours à l’Ecole polytechnique, et auparavant à l’Ecole normale, restent célèbres pour l’enthousiasme qu’ils suscitaient parmi les élèves avec lesquels Monge dialoguait fréquemment et dont un bon nombre d’entre eux devinrent plus tard de grands éducateurs. [5]
Ce que Lamy voulait également dire c’est que l’étude de la science et de la philosophie est une seule et même chose, que la connaissance philosophique et scientifique s’acquiert par l’étude du processus de la science, en se concentrant sur les dernières découvertes de l’époque. Le lien entre la science et la philosophie était considéré comme si étroit par les Oratoriens qu’ils n’enseignaient pas la science comme une catégorie séparée.
L’enseignement scientifique était généralement assuré par le professeur de philosophie. (Notons le cas typique de ce Père oratorien qui enseignait la philosophie et qui construisit un aérostat à Condom en 1785).
Les Oratoriens s’intéressaient tout particulièrement aux découvertes de leurs contemporains dans le domaine de l’électricité et du calcul différentiel et intégral, notamment à celles de Leibniz, dans le cadre d’un effort dirigé vers le développement des sciences exactes à l’opposé de l’enseignement scientifique alors dispensé par l’université de Paris, qu’ils accusaient de « subjuguer l’esprit à la règle des syllogismes » [6]. Leur Ordre fut lui-même un véritable foyer scientifique, d’où furent issues plusieurs générations de grands savants.
Le premier professeur d’hydrographie en France, Guillaume Denis, fut un Oratorien qui ouvrit une chaire d’hydrographie au collège de Dieppe en1665, le premier collège oratorien établi en France, en 1616.
C’est aussi là que fut ouverte la première chaire de mathématiques et que furent étudiées les sections coniques de Pascal en géométrie.
L’hydrographie était alors une science naissante, encouragée par Colbert qui faisait du développement des canaux et des machines hydrauliques l’un des piliers de sa politique d’expansion industrielle.
L’hydrodynamique, comme elle fut appelée plus tard, mena à des découvertes qui comptent parmi les plus importantes de la physique moderne et a été le vecteur de l’épistémologie leibnizienne, depuis Leibniz et ses collaborateurs les Bernoulli, jusqu’à Monge et de Broglie.
Chez les Oratoriens, l’enseignement de la science faisait généralement partie intégrante de celui de l’histoire, l’une de leurs innovations les plus importantes. Les Oratoriens avaient fortement réagi contre l’enseignement de l’histoire alors courant en France, qui se limitait à l’histoire d’Athènes et de Rome et à ce qu’ils rejetaient comme la « science vide des commentateur ».
Ils jugeaient comme beaucoup plus utile d’étudier les faits historiques se rapportant à l’histoire de la France chrétienne.
Aux héros de la Rome antique et de la mythologie gréco-latine, culture qu’ils dénonçaient comme « imprégnée de paganisme » [7], ils contre-posèrent les grands bâtisseurs de la nation française : Charlemagne, Louis XI, Jeanne d’Arc, Henri IV.
La première leçon de cette nouvelle conception de l’histoire, l’histoire de France, fut donnée en 1634, en français, car les Oratoriens s’appliquaient dans un même temps à promouvoir l’étude du français comme langue vivante, exprimant l’âme du processus qui avait engendré la nation. Tous leurs cours étaient en fait donnés en français, contrairement aux Jésuites qui n’employaient que le latin. Et c’est à la lumière de l’histoire de France que les Oratoriens faisaient ressortir le rôle moteur du développement des sciences et des techniques.
Parmi les réalisations des Oratoriens en matière de pédagogie les plus susceptibles de favoriser le rayonnement de la connaissance dans toute la population, leur but premier, nous devons mentionner celle des « exercices publics » où les élèves se livraient à des expériences scientifiques de physique et autres en présence de leur famille, de leurs amis et de la population locale, conviés pour l’occasion. Les collèges oratoriens étaient généralement équipés de cabinets de physique et de nombreux instruments scientifiques, et les élèves encouragés à effectuer des manipulations par eux-mêmes.
Aux régents l’on demandait d’écrire des pièces de théâtre sur le thème du combat intérieur que l’homme voulant atteindre à la véritable dignité doit livrer aux instincts et passions qui l’enchaînent à l’âme de bronze et d’argent décrites par Platon, pour tendre vers la raison de l’âme d’or, qui obéit, elle, à la loi supérieure de la Liberté-Nécessité - thème qui trouva toute son expression politique dans les travaux du grand poète et dramaturge allemand Schiller dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Ces pièces étaient représentées publiquement dans les différents collèges fréquentés par les régents ; chaque année, en effet, les régents changeaient de collège, afin que les idées nouvelles dont ils étaient porteurs en termes de découvertes et de méthodes pédagogiques, circulent rapidement dans tout le pays.
L’idée fondamentale sur laquelle reposait l’enseignement oratorien était que ce n’est pas la somme des connaissances particulières acquises qui est importante, mais le processus de perfection de l’esprit dont l’étude de la science est le médiateur, la faculté de « bien penser ».
Enseigner, pour les Oratoriens, signifiait « se faire ouvrier de lumière » ; la science était le moyen de créer de vrais chrétiens, des hommes consciemment engagés dans le perfectionnement de leur esprit. « Notre esprit n’est pas fait pour l’érudition », disait Lamy, « mais l’érudition pour l’esprit, c’est-à-dire qu’on doit en user pour le régler et le perfectionner ». Répudiant les connaissances superficielles, Lamy ajoutait : « Il faut que les études se changent en notre substance », il faut ramener tout à la connaissance non des hommes mais de « l’homme universel ».
La géométrie et la philosophie de la science
L’homme est à l’image de Dieu (un vrai chrétien aux yeux des Oratoriens) lorsqu’il tend vers son soi-perfectionnement en recherchant le perfectionnement de l’univers. Et Dieu, pour les Platoniciens et leurs héritiers, le principe créateur de la soi-perfection, était le Géomètre. « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre », Platon avait-il fait inscrire au-dessus de la porte de son Académie, car la géométrie, comme Monge, Carnot et Dupin le comprirent, est aussi la « philosophie de la science ».
C’est pourquoi la géométrie joua un si grand rôle dans la formation de la première génération de Polytechniciens. Non pas en tant qu’ensemble fixe d’axiomes telle qu’elle est malheureusement enseignée couramment aujourd’hui, mais parce que cette branche de la science représente un moyen unique d’éduquer l’esprit à la raison en communiquant l’idée de la rationalité de l’univers physique et de la rationalité correspondante de l’esprit humain.
Pour Monge, qui a contribué de manière cruciale au développement de cette science, l’objet de la géométrie résidait avant tout dans la manière dont les formes et les figures sont générées, dans l’évolution de leurs rapports au sein de configurations changeantes, et non dans leurs qualités fixes. Il cherchait avant tout à transmettre la notion du processus grâce auquel il était parvenu à ses découvertes géométriques, un processus qu’il ne manquait pas d’associer à un sentiment de joie profonde.
L’apport le plus connu de Monge est la « géométrie descriptive », c’est-à-dire, formellement, la représentation d’objets à trois dimensions dans un espace à deux dimensions. Selon cette méthode, chaque point de l’espace est représenté par ses projections orthogonales sur deux plans perpendiculaires ; le deuxième plan est ensuite censé être replié sur le premier par sa rotation autour de leur intersection, et les deux projections se trouvent ainsi sur le même plan horizontal. Les travaux de Monge dans ce domaine sont la prolongation directe de ceux réalisés un siècle auparavant par Descartes et le grand géomètre Desargues.

Avant Gaspard Monge, il n’existait aucune manière codifiée de représenter précisément sur un plan un objet à trois dimensions. On conçoit dès lors qu’il était très difficile de faire construire n’importe quelle machine, par plusieurs personnes, car les différentes pièces de la machine n’étaient plus ajustées. Ce problème devenait insurmontable dès qu’il fallait produire les différentes pièces dans plusieurs villes éloignées. C’est Monge qui avec la géométrie descriptive a créé le moyen de remédier à cette situation en systématisant une méthode de représentation d’un espace à trois dimensions dans le plan.
Soit un segment AB sur une droite D. La méthode consiste à projeter orthogonalement les extrémités A et B sur deux plans perpendiculaires notés P et Q. Les projections seront respectivement A’, B’ et A", B".
Il suffit de rabattre le plan Q sur le plan P’, prolongement du plan P, et de reporter alors les points A" et B" sur le plan P’, ce qui nous donne les points indiqués a et b. La représentation finale du segment AB est indiquée ci-dessous.
C’est cette méthode projective qui est à la base du dessin industriel et du dessin architectural.
Cette nouvelle branche de la géométrie fut le fruit du souci constant de Monge de développer l’industrie française, notamment la métallurgie et la mécanisation. Il savait que ce développement ne pouvait être amorcé qu’en appliquant aux différents domaines de la technologie des méthodes scientifiques. A l’époque, il existait une situation chaotique dans les divers secteurs techniques utilisant des méthodes graphiques, dans ce sens que leur efficacité générale était grandement entravée par de nombreuses divisions et particularités. Monge comprit que pour parvenir à une efficacité technique supérieure qui assurerait le progrès industriel, il fallait refondre les procédés existants disparates utilisés par les différentes techniques.
C’est ainsi qu’il fit la synthèse d’un nouveau concept en mettant à jour le principe commun sous-jacent à toutes les techniques graphiques et à tous les problèmes liés à l’espace, et qu’il découvrit qu’en posant sous une forme géométrique les différents problèmes posés par les différentes techniques, une similarité allait apparaître qui permettrait de résoudre ces problèmes à l’aide de la méthode des deux projections orthogonales [8].
La clé de son approche - approche que l’on retrouve par ailleurs dans tous les aspects de ses travaux - est que celle-ci est fondée sur le principe général du continuum développé par Leibniz.
Au lieu de rechercher des solutions particulières aux différents problèmes qui se présentaient, il rechercha l’invariant qui pouvait résoudre ces différents problèmes en les situant dans un ordre de lois de mathématique physique supérieur.
En fait, la géométrie descriptive était bien le moyen de parvenir à des ordres supérieurs de technologie, en permettant de traduire géométriquement la conception globale de réalisations techniques plus complexes qui requièrent une plus grande division du travail, en offrant « un langage nécessaire pour l’homme de génie qui conçoit un projet, pour ceux qui doivent en diriger la réalisation, et finalement, pour les artistes qui eux-mêmes doivent en réaliser les différentes parties », comme Monge l’explique dans l’introduction à son Traité sur la Géométrie Descriptive.
Monge commença à travailler sur cette idée vers 1775 et l’élabora durant toute la période où il enseigna à Mézières. Il présenta sa géométrie descriptive entièrement conceptualisée pour la première fois publiquement dans son cours à l’Ecole normale en 1794.
Lorsqu’il était professeur d’hydrodynamique à l’Ecole du Louvres dans les années 1780, Monge réalisa de nombreuses études et expériences sur les machines hydrodynamiques, et il considérait que l’étude d’une « théorie des machines » devait faire partie intégrante de son cours sur la géométrie descriptive. Il avait entrepris une classification générale des machines (plus tard complétée par l’un de ses élèves et collaborateurs de l’Ecole, Hachette), qui eut une grande influence sur les auteurs de traités de mécanique du XIXème siècle. Jusqu’à Monge, les milieux scientifiques n’avaient abordé l’étude des machines que du point de vue de la description de leurs détails ; Monge partit lui du principe de leur conception globale.
« Monge voulait qu’on appliquât cette géométrie à la description générale des machines, pour réduire ainsi qu’il en avait l’idée tous les moyens de transmettre de la force et du mouvement à des éléments parfaitement connus, classés et disponibles comme les instruments de l’atelier bien ordonné d’un excellent artiste. Il voulait enfin qu’on répandit par tous les moyens possibles, et qu’on rendit presque vulgaires à force de les populariser, la description et l’interprétation d’une foule de phénomènes de la nature, qui, par leur action, peuvent avoir une influence plus ou moins grande sur les travaux de notre industrie », écrivit Dupin.
Parmi les travaux les plus importants de Monge en géométrie, il faut noter ceux sur la génération des surfaces : Monge remarqua que les surfaces utilisées n’avaient généralement pas de degré défini, ce qui était au contraire fondamental c’était leur mode de génération.
La réponse qu’il fit un jour à l’Ecole normale à un disciple de Condillac qui arguait que pour comprendre les éléments géométriques, il fallait suivre l’« ordre logique », solide, surface, ligne et point, est significative à cet égard.
Monge montra que les surfaces développables contrairement aux objets fixes, sont des plus utiles pour la technique ainsi que pour la théorie des ombres et le processus de l’analyse, et insista sur l’importance de la classification des surfaces selon leur mode de génération : « Dire qu’une surface est de révolution, c’est donner l’idée de la manière dont elle a été engendrée ; c’est indiquer la grande famille dont elle fait partie ; c’est prouver qu’elle a toutes les propriétés qui conviennent à toute la famille en général », Monge expliqua-t-il.
Dans les exercices qu’il donnait à ses élèves, Monge s’efforçait toujours de développer en eux un sens de l’intuition géométrique. « Il faut que l’élève se mette en état d’une part de pouvoir décrire en analyse tous les mouvements qu’il peut concevoir dans l’espace, et de l’autre, de se représenter perpétuellement dans l’espace le spectacle mouvant dont chacune des opérations analytiques est l’écriture », dit-il. Pour lui, comme pour Carnot et les « grands géomètres » qu’ils formèrent, il n’existait pas d’opposition entre l’analyse et la géométrie, qu’ils considéraient comme deux aspects complémentaires d’une même science mathématique. Le divorce entre l’analyse (algèbre) et la géométrie n’intervint que plus tard au XIXème siècle, et ouvrit la voie au « symbolisme algébrique » désastreux des « mathématiques modernes ».
Monge soulignait en fait dans son enseignement de la géométrie, le lien entre le mode de génération des figures géométriques et celui de certains types de phénomènes physiques - lien qui a été essentiellement brisé par les mathématiques d’aujourd’hui.
« L’influence scientifique de Monge s’étendit bien au-delà des murs de son Ecole et des frontières de son pays, et donna son élan au développement de la géométrie qui allait commencer en Allemagne. J’ai moi-même grandi, grâce à mon professeur Plücker, dans la tradition de Monge », a écrit le grand mathématicien Felix Klein, qui reprit cette tradition dans son Programme d’Erlangen, contre lequel Bertrand Russell, le père des mathématiques modernes, réagit quelques années plus tard en publiant ses Principia Mathematica.
Alors qu’on lui demandait un jour pourquoi il n’avait pas introduit directement la méthode des projections orthogonales dans son cours sur la géométrie descriptive, Monge répliqua qu’il fallait « suivre la marche naturelle de l’esprit ; il fallait vous montrer la nature du spectacle que l’on a toujours sous les yeux. Il fallait enfin exciter en vous quelques-unes des émotions que ce spectacle est propre à produire ; et si, parmi vous, il y en a un à qui, pendant la première leçon ou à la lecture de la première séance, le cœur ait battu, c’en est fait, il est géomètre ».
Monge, et plus encore peut-être, Carnot et Dupin, savaient que l’essence de la géométrie, comme de toute science, ne tient pas au simple fait qu’elle est un instrument pour changer le monde mais au processus mental qui précède chez le savant la manipulation de l’instrument, grâce auquel celui-ci crée des hypothèses - dont Newton, lui, niait la nécessité - qu’il vérifie ensuite par la médiation de l’instrument scientifique.

C’est ce que Carnot a appelé « le génie lui-même », ce que Dupin a appelé « la philosophie de la science », ce qui « précède la marche matérielle des manipulations mathématiques », et ce que Platon a appelé « l’hypothèse supérieure ».
C’est le principe grâce auquel l’individu créateur parvient au savoir réel, celui qui recouvre la connaissance des objets particuliers et des instruments particuliers qui nous aident à saisir les processus physiques ; le principe qui ordonne la succession d’hypothèses et qui a permis à l’homme d’atteindre des niveaux de savoir supérieurs à travers l’histoire platonicienne.
Monge, Carnot, Dupin et leurs successeurs associaient consciemment ce processus à une émotion de joie, et, comme le dit si bien Monge, éprouver cette joie est la condition pour devenir un véritable géomètre, quelqu’un pour qui la géométrie va être le moyen de saisir le principe ordonnant de l’univers et non un corps fixe de savoir.
En lisant ce que Carnot et Dupin disaient de cette géométrie supérieure (voir encart « Le charme insoupçonnable de la géométrie » ci dessous), tout professeur de mathématiques honnête aujourd’hui devrait être confondu par le caractère destructeur des « maths modernes », ce pur produit du réductionnisme britannique qui, au lieu de susciter chez les enfants l’enthousiasme qui accompagne la découverte sensuelle de la rationalité de l’univers, anéantit et la rationalité et l’émotion de joie créatrice sous un flot de symboles abstraits et même absurdes.
Le charme insoupçonnable de la haute géométrie
Les personnes qui commencent à cultiver la haute géométrie, ne sauraient soupçonner le charme qu’elles éprouveront, un jour, à ce travail. Elles ne voient, dans les premiers rudiments de la science, qu’un enchaînement inextricable, de propositions abstraites, de démonstrations épineuses, de descriptions qui fatiguent et rebutent l’intelligence.
C’est, en effet, une étude fort pénible que celle des premières conceptions de la géométrie à trois dimensions. Il faut apprendre à se représenter, en idée, des surfaces et des courbes dont les formes, d’une complication plus ou moins grande, sont variées à l’infini. Il faut les voir par les yeux de l’esprit, se couper, se toucher, s’envelopper, suivant des conditions données. Mais, quand ce travail intellectuel nous a rendus familiers avec les propriétés qui caractérisent les principales espèces de courbes et de surfaces, il semble qu’un nouvel ordre de conceptions vienne d’être créé dans notre entendement. Nous découvrons des rapports généraux, immuables, qui sont les lois éternelles de l’étendue figurée. Ces vérités mathématiques, loin d’être abstraites, se présentent à notre intelligence, sous des aspects visibles et pour ainsi dire palpables. Voilà comment l’imagination, qui semblait étrangère à des conceptions purement rationnelles, crée en quelque sorte un monde nouveau dont les objets, soumis dans leur position, dans leur figure et dans leurs mouvements, à des règles invariables, présentent de toutes parts, des idées d’ordre, de constance et d’harmonie.
Lorsqu’ensuite nous passons de ce monde géométrique à la réalité du monde physique, nous retrouvons, dans les espaces que la matière occupe et dans les espaces qu’elle parcourt, les formes abstraites que la science avait imaginées. Les lois générales auxquelles sont assujetties ces abstractions mathématiques, reçoivent tour à tour leur application. L’esprit humain découvre, avec une surprise où le plaisir est égal à l’admiration, que l’univers et ses phénomènes portent dans leur existence, le type ineffaçable de ces formes idéales et de ces lois théoriques (…)
Par ces hautes conceptions, l’Univers a cessé d’apparaître aux yeux des hommes, sous l’aspect incohérent des éléments de la matière, dispersés ou réunis, découverts ou cachés, par les caprices du hasard. L’intelligence humaine a connu par degrés qu’une géométrie sublime préside aux mouvements, aux formes, aux rapports de grandeur et de position de tous les corps célestes. Notre savoir s’est élevé, dans les applications d’une admirable théorie, jusqu’à connaître l’ensemble des parties figurées de l’espace qui furent, qui sont ou qui seront le lieu, le centre, ou l’axe, ou l’orbite, des mouvements perpétuels que suivent les grandes masses de notre système planétaire et leurs moindres éléments. Ainsi, dans l’espace et dans la durée, depuis l’infiniment petit jusqu’à l’infini, tout est soumis à des lois mathématiques.
En méditant sur ces lois immuables et savantes, par lesquelles une Suprême Intelligence régit le temps et l’Univers, les sages n’ont pu trouver, pour l’appeler d’après ses œuvres, aucun titre plus juste et plus sublime, que celui de l’Eternel Géomètre.
Charles Dupin, Considérations générales sur les applications de la géométrie.
Ce n’est qu’en comprenant sensuellement ce « principe poétique » sous-jacent à la mentation créatrice dans les différents domaines de la science de même que dans le grand art, comme la poésie elle-même et la musique, que l’homme peut parvenir à la raison. Le véritable objectif des efforts éducatifs de Monge, Carnot, Dupin et des premiers grands Polytechniciens était de faire accéder de plus en plus de gens à la compréhension de ce processus afin qu’ils puissent le cultiver et en multiplier les bienfaits pour toute l’humanité. C’était là le secret, le secret totalement ouvert de leur mouvement destiné à « éveiller les lumières » dans tout le pays, et au-delà. Leur œuvre fut le fait de véritables républicains, dans le sens platonicien du terme, car élever la population à la moralité, voulait dire l’élever à la raison. A leurs yeux, moralité était synonyme de raison - n’oublions pas que le terme raison avait terriblement souffert dans ces années-là du rite jacobin qui avait réduit cette notion à une « déesse suprême », irréelle, froide et dérisoire.
En fait, ces républicains étaient des poètes. Dupin transmit cette conception de la géométrie supérieure dans un langage hautement poétique. La polémique d’Edgar Allan Poe sur le mathématicien et le poète dans sa Lettre volée est des plus pertinentes. Poe, un grand poète qui était aussi officier du renseignement de la République américaine sorti de West Point, l’équivalent américain de l’Ecole polytechnique, y rend un hommage à Dupin qu’il dépeint sous les traits apparemment fictifs de son détective français. « C.A. Dupin », dont il fait le porte-parole de la méthode platonicienne d’enquête à l’opposé de la méthode britannique de déduction. Dans la Lettre volée, Dupin montre que l’esprit supérieur, celui qui a défié les efforts empiristes de la police française en cachant la lettre dans un endroit qu’elle ne parvient pas à découvrir, ne peut pas être l’esprit d’un seul mathématicien mais seulement d’un mathématicien qui est aussi un poète. Carnot, lui, écrivit de vrais poèmes, que Prieur mit souvent en musique. Hyppolite Carnot dit de son père que lorsque ce dernier travaillait sur des problèmes militaires et scientifiques, il lui arrivait souvent de s’arrêter, de parcourir à grands pas son appartement, et de commencer à fredonner un poème qu’il notait au milieu de ses plans militaires ou équations. Ce principe poétique donnait lieu à de joyeuses festivités : Carnot était membre de la Société des Rosati à Arras, une société de poètes et d’amateurs de bon vin, qui se réunissait pour des banquets où se succédaient les poèmes et les pièces musicales. Ces réunions n’avaient rien de bacchanales : elles étaient la célébration de la créativité et de la raison humaines, comme dans le Banquet de Platon.
Le dessin artistique s’était aussi vu attribuer une place importante dans le programme de l’Ecole polytechnique, à côté des mathématiques, de la physique et de la chimie. Voici comment le célèbre peintre Neveu présentait son programme d’enseignement de cette matière :
« On parlera de la peinture en général (...) Dans sa définition la plus relevée, elle sera aussi l’art d’exciter des pensées par des sensations [9], d’agir sur l’âme par l’organe de la vue ; c’est par là qu’elle prend de l’importance, qu’elle rivalise avec la poésie, qu’elle peut, comme elle, éclairer les esprits, échauffer les cœurs, exciter et nourrir les sentiments élevés. On fera sentir les secours qu’elle peut prêter à la morale et au gouvernement ; comment elle sera dans les mains du législateur habile un puissant moyen pour inspirer l’horreur de l’esclavage, l’amour de la patrie, et conduire les hommes à la vertu ».
Neveu s’opposait à ce que les élèves se contentent d’« imiter » le dessin ou la peinture sans en comprendre la véritable signification. En étudiant le travail d’un peintre, l’élève devait au contraire s’élever et « grandir » avec le peintre. « La peinture, pour remplir l’idée qu’en ont toujours eue les hommes éclairés, doit s’élever à de plus hautes conceptions », disait Neveu contre l’imitation, « il faut qu’elle parle à l’intelligence (...) qu’elle élève l’imagination, qu’elle conserve de grands souvenirs, qu’elle fasse naître de grandes pensées (...) c’est alors qu’elle s’élève à toute sa dignité, qu’elle rivalise avec la poésie ». Les règles de la composition des plus grands tableaux (Léonard de Vinci était considéré comme le maître « universel ») étaient étudiées du point de vue géométrique le plus avancé, où science et art ne faisaient plus qu’un, dans ce qui fut en France la première présentation publique des « principes généraux de l’art » - l’art n’étant plus présenté comme enveloppé de « mystère » mais le fruit et la célébration de la mentation créatrice.
La géométrie naturelle est le génie lui-même
Il est une science simple, exacte, lumineuse, profonde, sublime : sa marche est lente, méthodique, circonspecte ; elle assure la possession du cultivateur, guide le navigateur au travers des écueils de l’océan, pèse les globes célestes, calcule leurs distances, décompose la lumière, connait la vitesse : c’est l’art d’Euclide ; mais il est une autre géométrie plus subtile encore, dont les principes sont pour ainsi dire le sentiment (Note). Fille de l’imagination et non de l’étude, à laquelle un jugement exquis, un coup d’œil prompt, un tact heureux servent de nombres, de règle et de compas, ses opérations sont métaphysiques, ses résultats s’obtiennent par un calcul rapide que des signes extérieurs ne peuvent représenter ; c’est elle qui guide l’artiste ingénieux, de qui l’art d’Euclide est souvent ignoré ; c’est la seule lumière qui nous reste, lorsque la marche ordinaire devient trop lente, les objets trop multipliés, les rapports trop compliqués ; elle aperçoit intuitivement, elle veut un génie aussi hardi que profond, plus vif que méthodique, plus vaste que réfléchi : sans cette géométrie, l’autre est un instrument inutile ; elle crée, l’autre polit ; elle est mère de l’invention, l’autre l’est de la précision. C’est à l’aide de ces deux flambeaux qu’Archimède éclaira l’univers (…)
Note : C’est la géométrie naturelle, espèce d’instinct bien différent de la géométrie acquise. La science ne donne pas le génie, et la géométrie naturelle est le génie lui-même appliqué à la mesure des grandeurs. La géométrie acquise est, par son exactitude même, forcée à une lenteur extraordinaire, et bornée à des cas très simples. L’autre à un usage prompt, et s’applique à tout ; elle voit d’un coup d’œil ce qui gêne les combinaisons, sans influer sensiblement sur les résultats, et fait habituellement se relâcher d’une exactitude trop rigoureuse en faveur de la célérité ; c’est par elle que les mathématiciens entrevoient les résultats d’une hypothèse, avant même que de l’avoir analysée par un calcul exact, c’est aussi la géométrie qui est nécessaire aux généraux pour saisir en un instant la disposition, l’ordonnance et la marche des troupes.
Lazare Carnot, Eloge de M. le Maréchal de Vauban, 1784.
La philosophie de la science
Les belles découvertes mathématiques ne sont jamais le résultat d’une combinaison mécanique et pour ainsi dire aveugle de signes abstraits. Il faut que l’esprit, pour me servir d’une belle expression de Montaigne, il faut que l’esprit par ses vues primesautières devance la marche matérielle des manipulations du calcul. C’est cette providence du génie, guidée par des règles plus ou moins sûres, par des inductions plus ou moins directes, et souvent par un simple pressentiment de ce qui doit être ou n’être pas la vérité, c’est elle qui constitue la philosophie de la science.
Charles Dupin, Essai historique sur les travaux scientifiques et les services de Gaspard Monge, 1819.
L’expédition d ’Egypte :
un projet leibnizien de l’Ecole contre l’Angleterre
A l’origine, l’expédition en Egypte visait à briser le dos des Turcs (l’Empire ottoman était sous le contrôle des Britanniques), et, en dernière analyse, à arracher l’Inde aux Anglais. Au début, l’opération ne manquait pas d’ambiguïté dans ce sens que l’agent britannique Talleyrand, chargé des affaires étrangères, cherchait par là à se débarrasser de Bonaparte en vue d’établir en France une monarchie constitutionnelle de type anglais ; Monge sut toutefois retourner cette opération en faveur de la politique républicaine à l’aide de son élève et collaborateur Fourier, le futur mathématicien, qui, aux côtés de Monge et de Bonaparte, fut la troisième grande figure de l’équipe qui dirigea l’expédition.
L’expédition d’Egypte en 1797 fut le premier véritable déploiement « sur le terrain » des Polytechniciens. C’était surtout la première opération de grande envergure que les dirigeants républicains français lançaient contre l’Angleterre depuis 1789 et la constitution de la Coalition militaire contre la France, de même que c’était la première application directe d’un projet proposé un siècle plus tôt par Leibniz à Louis XIV. Dans son Grand Dessein d’une entente de Républiques souveraines· en Europe, Leibniz avait imparti à la France la mission de civiliser l’Afrique du Nord et la méditerranée, afin d’y étendre l’influence platonicienne au détriment de l’Angleterre. Ce projet avait été repris plus tard par le Premier ministre de Louis XV, Choiseul, mais il avait été bloqué par l’agent d’influence britannique que fut Madame de Pompadour, la protectrice des physiocrates anti-industriels. Il est très probable que durant son séjour au ministère de la marine Monge ait eu entre les mains des documents concernant ce projet.
L’idée d’une opération décisive contre l’Angleterre n’était pas nouvelle. Depuis 1793, il avait été question à plusieurs reprises dans l’entourage de Carnot et Monge d’organiser une « descente » contre la perfide Albion. En fait, la direction républicaine de l’armée et de la marine françaises avait déjà prévu une invasion de l’Angleterre durant la guerre américaine ; ce fut alors que les troupes françaises mirent à l’épreuve la « grande tactique » qui allait ensuite être utilisée par La Fayette et Rochambeau sur les champs de bataille américains, et par Carnot en Europe contre la Coalition.
Carnot prévoyait alors de détruire d’abord Ostende et Amsterdam afin de priver Londres de ses avant-postes bancaires les plus importants sur le continent et de son commerce avec l’Inde. Mais les ressources disponibles pour une attaque éventuelle contre l’Angleterre avaient dû être mobilisées pour endiguer l’ennemi de l’intérieur, la chouannerie, et la descente fut repoussée plusieurs fois.
En 1795, Carnot envisageait la création d’une république hollandaise et l’occupation de la rive gauche du Rhin pour porter un coup fatal au côté prussien de la Coalition. Le plan de Bonaparte prévoyant une campagne en Italie pour vaincre l’Autriche fut adopté l’année suivante. Monge, fervent partisan de l’instauration de gouvernements républicains dans toute l’Italie, y accompagna Bonaparte à la tête d’une Commission des Arts chargée de recenser toutes les grandes œuvres d’art dans ce pays, notamment celles héritées de la Renaissance. Avant de ramener à Paris en 1797 le célèbre traité de Campo Fiormo consacrant la défaite de l’Autriche, Monge prit une part active dans l’établissement de la République cisalpine, qui comprenait les villes de Modène, Bologne et Ferrare.
En avril 1796, la décision avait été prise d’envoyer quelque 200 000 soldats contre l’Angleterre une fois que celle-ci aurait été isolée comme le dernier ennemi de la Coalition. (Au cas où une vaste opération n’aurait pas été possible, Carnot songeait à purger l’Ouest de la France des Chouans qui auraient été débarqués sur les côtes anglaises avec des centaines de prisonniers de droit commun !).
Nous n’allons pas entrer ici dans l’aspect militaire de l’expédition mais plutôt dans sa dimension humaniste et scientifique sans précédent.
Une Commission scientifique fut organisée par Monge et Berthollet, comprenant une cinquantaine de membres spécialistes des sciences mathématiques et de leurs applications (géomètres, astronomes, mécaniciens), de l’ingénierie (ingénieurs des travaux publics, des mines, géographes), des sciences naturelles (chimistes, botanistes, zoologistes, minéralogistes), de littérature (orientalistes), des docteurs, chirurgiens, musiciens, architectes, dessinateurs, graveurs, etc. - dont un tiers sortait tout juste de l’Ecole polytechnique.
L’idée essentielle qui guida la Commission et l’Institut d’Egypte établi dès l’arrivée des troupes françaises au Caire (sous la direction de Monge, Bonaparte et Fourier), était « la conquête de faits nouveaux pour contribuer à l’amélioration du pays » [10]. Dès que l’expédition débarqua en Egypte, les ingénieurs eurent pour mission de dresser les plans des villes et de la côte et d’établir un « grand plan géométrique d’Alexandrie » et des environs, qui, d’après Jomard, « aurait pu remplir un atlas ».
L’Institut du Caire, dont Monge était le président, devait principalement s’occuper « des progrès et de la propagation des lumières en Egypte ; de la recherche, de l’étude et de la publication des faits naturels, industriels et historiques de l’Egypte ». Il comprenait quatre grandes sections : mathématiques, physique, économie politique et arts (technologie). La question de l’enseignement devant être dispensé à la population locale fut l’une des premières étudiées.
Une vaste étude de la région du Nil fut entreprise. Les ingénieurs réparèrent canaux, chaussées et digues. Le canal d’Alexandrie fut curé et rétabli pour la navigation. Bonaparte travailla sur le projet du canal de Suez, reliant la Méditerranée à la Mer Rouge, à partir des vestiges du canal antique découverts par les ingénieurs. Les édifices publics furent restaurés et entretenus. Des cultures nouvelles furent introduites et des systèmes d’irrigation construits.
L’une des premières choses que firent les Français en arrivant fut d’installer une imprimerie d’où sortaient des publications quotidiennes pour l’armée et la population, en français et en arabe, sur l’évolution de la situation militaire et le cours des divers travaux scientifiques, infrastructuraux et artistiques engagés en Egypte. Les écrivains et journalistes qui faisaient partie de l’expédition envoyaient rapports et livres en France pour informer la population de la métropole. Des lieux artistiques, notamment des théâtres, furent ouverts. Berthollet établit un laboratoire ouvert aux autochtones où ils pouvaient assister aux dernières expériences de physique et se familiariser avec la science. C’est ainsi que plusieurs ballons furent lancés, expérience alors révolutionnaire, afin de « frapper l’esprit » de la population locale. Une riche bibliothèque fut ouverte à l’Institut du Caire, tandis que des écoles spéciales étaient créées pour l’enseignement des mathématiques et des sciences en général. Les médecins étudièrent les maladies qui affectaient la population indigène. La musique et la poésie locales furent « savamment approfondies » et enrichies par la culture musicale et poétique européenne. Deux recueils périodiques, Le Courrier de l’Egypte, et la Décade égyptienne faisaient largement connaître tous ces travaux.
Les ingénieurs réalisèrent toute la description géographique, topographique et statistique du pays. La population, les infrastructures existantes, les machines et la production furent recensées, tandis qu’était relevé l’emplacement des anciennes cités et autres sites historiques, notamment les vestiges de la Renaissance arabe.
Ces activités étaient loin d’être sans danger dans cette situation de guerre. Plus d’un ingénieur ou d’un scientifique périt aux mains des Britanniques ou de leurs marionnettes arabes. Monge lui-même faillit succomber à une maladie très grave. Lors d’un soulèvement contre les troupes françaises au Caire, tous les instruments scientifiques de la Commission furent détruits - pour être immédiatement refaits, à partir de rien pratiquement, par Conté.
Tous les soirs, la Commission se réunissait dans les jardins de Cassini-Bey sous la direction de Monge et de Fourier. C’est là que cette pléiade humaniste se flattait de « jeter les fondements d’une nouvelle école d’Alexandrie, qui, partie d’un point plus avancé, pouvait un jour effacer l’ancienne » [11]. L’Ecole d’Alexandrie avait été un célèbre foyer néo-platonicien créé par Alexandre le Grand. Alexandrie, qui fut l’un des plus grands centres commerciaux du monde, tira sa renommée séculaire de sa bibliothèque et de son phare, symbole de la lumière répandue par la civilisation des bâtisseurs de cités. Dans les jardins de Cassini-Bey, plus d’un projet fut échangé dans une atmosphère de joie où furent tissés des liens qui unirent souvent leur vie durant ce noyau de Polytechniciens et leurs collaborateurs.
« Il n’avait pas tort Leibniz, quand il conseillait à la France, il y a deux siècles, d’occuper son activité à introduire dans ce beau pays d’Egypte la douceur et la politesse de ses mœurs, la science et les arts de ses enfants ! Nous nous sommes efforcés de donner quelque réalité au rêve d’un grand homme, et il s’est heureusement trouvé un Bonaparte pour y présider, des auxiliaires et des savants (...) et une école, l’Ecole polytechnique, pour l’accomplir », déclare Jomard.

Le projet grandiose fut militairement défait par les Anglais après la destruction de la flotte française en 1799. Toutefois, l’influence des travaux de la Commission et de l’Institut commencèrent à se faire sentir politiquement avec l’avènement du gouvernement de Mohammed Ali en 1812. Les troupes de Mohammed Ali et de son fils avaient été directement formée par les officiers de Napoléon en vue de combattre l’Empire ottoman et d’aider la France à chasser les Barbaresques d’Algérie et à prendre le contrôle de toute la Méditerranée. Cette politique de développement fut ensuite reprise avec force à la fin du XIXème siècle par le ministre des Affaires étrangères Gabriel Hanotaux et les « Colonistes » français. Leur Grand Dessein s’inspirait à la fois de Leibniz et du projet antérieur de Richelieu de créer une « nouvelle France » outre-mer, dont les Oratoriens devaient assurer la direction des affaires éducatives et religieuses. Les Etats-Unis d’Amérique, projet que parraina Richelieu, furent explicitement conçus comme le modèle de la colonisation républicaine française de l’Afrique, contre la conception britannique d’empire. Bien que les Colonistes ne purent mener à bien leur dessein, ils laissèrent derrière eux des cercles humanistes qui furent instruits dans la tradition de Monge et de Dupin, et qui représentent aujourd’hui l’élite de la Renaissance future de ce continent.
« Elever à la dignité d’hommes tous les individus de l’espèce humaine »
Pour les jeunes Polytechniciens, leurs maîtres et collaborateurs, nourris de principes républicains, la tâche qui s’imposait à l’aube du XIXème siècle était de lancer un vaste mouvement d’enseignement scientifique et technique afin de doter le pays d’une force de travail industrielle. Les grands économistes politiques que furent Carnot, Monge, Dupin et Chaptal savaient que la ressource première de la société réside dans un accroissement constant de la puissance de travail. Pour ce faire, non seulement des scientifiques, ingénieurs et techniciens doivent être formés en nombre grandissant, mais la force de travail toute entière doit avoir accès au niveau de savoir lui permettant d’assimiler productivement les nouvelles technologies introduites dans l’industrie. Ceci se traduisit par un double effort éducatif : le mouvement de l’« enseignement industriel » et le développement massif de l’instruction élémentaire amorcé par Carnot durant les Cent Jours en 1815.
Les efforts pour promouvoir un enseignement industriel de masse se traduisirent par la création en France d’un vaste réseau d’Ecoles et de Conservatoires des arts et métiers. Les Ecoles formaient directement les futurs ingénieurs et techniciens, tandis que les Conservatoires ouvraient leurs portes à de larges couches de travailleurs qui acquéraient de nouvelles qualifications dans des cours du soir. L’objectif des éducateurs industriels n’était pas de former les travailleurs empiriquement à une qualification fixe, mais de développer en eux la capacité d’acquérir rapidement les qualifications toujours plus poussées requises par le progrès scientifique et technique, A. Guettier, professeur de sciences industrielles à l’Ecole des arts et métiers d’Angers, témoigne ainsi de la nécessité de cette éducation :
Le devoir du gouvernement est de donner aux classes travailleuses toute la capacité morale nécessaire pour jouir de leurs droits et les exercer avec raisonnement, intelligence et conviction (...) Il faut d’abord songer à donner au peuple un système d’enseignement dont toutes les branches se relient les unes aux autres de manière à former un tout complet ». L’enseignement professionnel, « en dehors de son influence immense sur la moralisation et l’émancipation des masses, doit être une nécessité publique. Non seulement il ferme la porte aux révolutions en déversant les idées du peuple vers les sources du travail agricole, industriel ou commercial qui est son lot ; mais par les connaissances spéciales qu’il répand, il tend à augmenter la richesse du pays en développant la production et en l’améliorant sous le double rapport de la qualité et du prix de revient.
Le souci de Guettier et des animateurs de ce mouvement était de « permettre au simple exécutant d’atteindre aux fonctions les plus élevées de l’ingénieur et du manufacturier », Guettier proposa dans les années 1840 la création d’un système d’enseignement industriel centralisé, dont la pierre de touche aurait été une Université des arts et métiers dont la vocation scientifique et industrielle se serait inspirée de l’Ecole polytechnique originale.
Par ailleurs, aux yeux de Carnot, une instruction populaire généralisée était le moyen nécessaire « d’élever successivement à la dignité d’hommes tous les individus de l’espèce humaine ». Les structures existantes de l’enseignement primaire étaient alors totalement inappropriées dans la perspective de développement économique rapide où se plaçait Carnot. Les moyens, en termes de crédits et d’enseignants, pour lancer un tel mouvement d’instruction de masse, étaient pratiquement inexistants. Et, encore une fois, le principe actif qui fut mis en jeu pour résoudre cette crise fut celui de moindre action.
C’est ainsi que furent prises les mesures spectaculaires établissant l’« enseignement mutuel » Pour remédier au manque de maîtres, d’écoles, de livres, de papier et de crayons et parvenir néanmoins à instruire le plus grand nombre d’enfants, un seul maître se trouva à la tête d’une classe pouvant aller jusqu’à mille élèves, à qui, en l’espace de quelques mois, il dut apprendre à lire, écrire et compter avec des moyens pédagogiques matériels des plus limités ! Le maître était en fait assisté dans sa tâche par des enfants choisis en raison de leur niveau plus élevé que les autres, qui se chargeaient d’instruire directement leurs camarades par groupes. Comme Carnot l’explique si bien dans son Rapport à l’Empereur (voir encart « Le grand art de l’économie politique » ci-dessous ), ce « principe générateur de nouveaux maîtres », celui des chefs de brigades de l’Ecole polytechnique, des régents de l’Oratoire, et, fondamentalement, du dialogue platonicien - fut alors la manière la plus efficace d’élever la population rapidement au niveau d’instruction requis, grâce au développement exponentiel parmi les enfants de ce niveau de connaissance et de la faculté de le reproduire chez les autres.
Le grand art de l’économie politique
« Sire,
Il existe un exemple pour les progrès de la raison, fourni par une contrée du Nouveau Monde, plus récemment, mais peut-être mieux civilisée déjà que la contrée qui s’appelle l’Ancien Monde. Lorsque les Américains des Etats-Unis déterminent l’emplacement d’une ville et même d’un hameau, leur premier soin est d’amener aussitôt sur le lieu de l’emplacement un instituteur, en même temps qu’ils y transportent les instruments de l’agriculture ; sentant bien, ces hommes de bon sens, ces élèves de Franklin et de Washington, que ce qui est aussi pressé pour les vrais besoins de l’homme que de défricher la terre, de couvrir ses maisons et de se vêtir, c’est de cultiver son intelligence.
Mais, lorsqu’au milieu de la civilisation européenne, l’inégalité des fortunes, inévitable conséquence des grandes sociétés, laisse parmi les hommes une inégalité de moyens aussi grande, comment admettre au bienfait de l’instruction, au moins élémentaire, aux avantages de l’éducation primaire, la classe la plus nombreuse de la société ? L’instruction sans morale pourrait n’être qu’un éveil de nouveaux besoins, plus dangereux peut-être que l’ignorance même. Il faut donc que la morale marche de front avec l’instruction : or, comment élever à la morale, en même temps qu’à l’instruction, le plus grand nombre d’hommes possibles des classes les moins fortunées ? Voilà le double problème qui a le mérite d’occuper les véritables amis de l’humanité, et que Votre Majesté veut résoudre elle-même en fondant une bonne éducation primaire.
Quand j’exposerai à Votre Majesté qu’il y a en France deux millions d’enfants qui réclament l’éducation primaire, et que cependant, sur ces deux millions, les uns n’en reçoivent qu’une très imparfaite, les autres n’en reçoivent aucune, Votre Majesté ne trouvera point minutieux, ni indignes de son attention les détails que je vais avoir l’honneur de lui présenter sur les procédés déjà employés dans certaines éducations primaires, puisqu’ils sont les moyens même par lesquels on peut arriver à faire jouir la plus grande portion de la génération qui s’avance, du bienfait de l’éducation primaire, seul et véritable moyen d’élever successivement à la dignité d’hommes tous les individus de l’espèce humaine. Il s’agit ici non pas de former des demi-savants, ni des hommes du monde ; il s’agit de donner à chacun les lumières appropriées à sa condition, de former de bons cultivateurs, de bons ouvriers, des hommes vertueux, à l’aide des premiers éléments des connaissances indispensables, et de bonnes habitudes qui inspirent l’amour du travail et le respect pour les lois.
Dans toutes les parties de l’économie politique, le grand art est de faire le plus avec le moins de moyens. Tel est le principe qui a dirigé plusieurs des philanthropes qu’on peut regarder comme créateurs et directeurs de l’éducation primaire ; ils ont voulu élever le plus grand nombre d’enfants avec le moins de dépense possible, et avec le secours du plus petit nombre de maîtres ; voilà leur idée principale : voici maintenant le moyen pour obtenir ce résultat : c’est de rendre les enfants instituteurs les uns des autres, pour la conduite morale comme pour l’enseignement intellectuel, par la transmission presqu’électrique de tous les commandements qui partent d’un seul maître ; ce maître se trouve ainsi multiplié sur tous les points d’une classe considérable, par ses jeunes représentants revêtus de différents noms d’instituteurs, de moniteurs, de lecteurs, et cette représentation d’un seul par tous et dans tous est assez positive et assez sûre pour qu’un seul maître puisse suffire à soigner jusqu’a mille élèves ; tandis qu’un maître d’école ordinaire ne peut guère aller au-delà du nombre de quarante. Cette règle de surveillance mutuelle, chose remarquable, on la retrouve dans les institutions de Lycurgue ; elle est la clé de tous les procédés dont l’instituteur primaire fait usage. Ce qu’il ya de plus heureux encore, c’est que dans ce procédé qui épargne le nombre des maîtres, en créant à l’instant des suppléants par la pratique sur le lieu même, et pour le besoin de l’école qu’ils dirigent, dans ce procédé, dis-je, se trouve un principe générateur de nouveaux maîtres. Les élèves qui viennent déjà d’être maîtres sur les bancs où tout à l ’heure ils apprenaient encore, se trouvent, au sortir de la classe où ils ne tenaient encore la place que d’une fraction millième, devenus eux-mêmes capables de rassembler et d’élever aussi haut qu’eux mille autres fractions pareilles, c’est-à-dire, qu’ils sont tout à fait, et au moment même, capables de devenir les maîtres d’une classe aussi nombreuse que celle qu’ils quittent ; et la nouvelle classe dont on voudra les charger, va pouvoir à son tour donner des créations aussi fécondes qui devront s’augmenter et se multiplier toujours dans la même proportion (...) »
Lazare Carnot, Rapport à l’Empereur sur l’éducation, 1815.
Contrairement à la version britannique de l’« enseignement mutuel », parrainé notamment par la Compagnie des Indes orientales, pour laquelle l’instruction dispensée devait être minimale et permettre seulement la formation d’une force de travail d’où les intérêts impérialistes britanniques pouvaient extraire le maximum de profit immédiat, le mouvement dirigé par Carnot en France conçut cette éducation comme un investissement à long terme, pour ainsi dire, à « forte densité énergétique », d’une qualité telle que l’enfant pouvait acquérir le potentiel lui permettant d’accéder plus tard au plus haut niveau de savoir et de pratique. En 1815, Carnot créa une Commission sur l’instruction élémentaire, qui mena à la formation de la Société pour l’Instruction Elémentaire, elle-même une émanation de la Société pour l’Encouragement de l’Industrie Nationale dirigée par Chaptal [12].
Carnot attaqua l’approche réductionniste d’inspiration britannique de ces membres de la Société pour l’instruction élémentaire pour qui la seule raison d’instruire la population était de développer l’industrie et le commerce. Avant son exil, Carnot envisageait au contraire une réforme politique de l’éducation fondée sur de véritables principes républicains, selon lesquels la finalité de l’éducation était la moralité et la dignité humaine.
La controverse qui eut lieu au sujet de l’introduction de la musique et de la géométrie dans l’enseignement mutuel est très révélatrice à cet égard. Ce sont les mêmes réductionnistes qui s’opposèrent à l’enseignement de ces deux matières sous prétexte que l’instruction devait se « limiter au savoir utile » et non conduire les enfants à l’ « ambition » que donne « un savoir trop poussé ». Deux noms ont marqué l’innovation cruciale que fut l’organisation de cet enseignement : Louis Benjamin Francoeur et Guillaume-Louis Bocquillon Wilhem. Francoeur, ancien chef de brigades et élève de Monge, était un mathématicien et un musicien (son père avait été directeur de l’orchestre de l’Opéra et surintendant de la musique de Louis XVI), qui enseignait les mathématiques à l’Ecole polytechnique et était le secrétaire de la Société pour l’Instruction Elémentaire. Il organisa l’enseignement de la géométrie, aussi appelée dessin, pour les enfants, supervisa les méthodes d’enseignement de la musique et se chargea de créer les cours de chant dans les écoles mutuelles. Francoeur, qui était très proche de Carnot (il offrit sa maison comme refuge à Carnot après Waterloo, ce qui lui valut d’être radié de l’Ecole polytechnique), n’eut de cesse que d’encourager les Polytechniciens à créer des écoles populaires et à assumer des responsabilités éducatrices partout où ils le pouvaient.
E.F. Jomard, l’un des fondateurs du mouvement d’éducation mutuelle et des arts et métiers, traduit l’esprit qui animait cette élite républicaine en évoquant le souvenir de Francoeur :
C’est parce qu’il comprenait toute la portée des sciences mathématiques appliquées au besoin de la Société ; c’est parce qu’il savait que leurs progrès conduisent à des découvertes dans les arts utiles et l’industrie, qu’il les embrassait toutes avec ardeur jusque dans les théories transcendantes, pour arriver, par les applications, à améliorer le sort des classes laborieuses. Telle était la grande pensée de Monge, pensée qu’il cherchait, à son exemple, à réaliser, à féconder par l’enseignement ; ce fut aussi l’idée dominante, comme nous le verrons plus tard, qui lui inspire tant d’utiles ouvrages, où l’application pratique est presque toujours à côté du principe scientifique.

Wilhem était musicien et répétiteur de mathématiques ; il enseignait la musique à l’école militaire de Saint-Cyr et à l’Ecole polytechnique, et ses chants contre les Anglais étaient alors célèbres [13].
C’était un grand admirateur du compositeur Cherubini, lui-même très proche de Beethoven. Hors la méthode qu’il élabora pour enseigner la musique dans les écoles populaires et les cours du soir de musique qu’il organisa pour les adultes, sa contribution la plus importante fut sans doute la création d’un orphéon à Paris, un vaste chœur où les enfants venus de régions différentes se retrouvaient régulièrement pour chanter.
L’idée admirable qui avait présidé à cette initiative était que de cette manière les enfants étaient amenés à rencontrer d’autres enfants originaires de régions diverses et que le chant était le médiateur des liens d’amour qui devaient se développer entre eux.
Selon Francoeur, la méthode d’enseignement de Wilhem reposait sur l’idée d’un progrès constant vers des niveaux toujours plus élevés, avec une base musicale solide au départ.
L’objectif était de donner à la population « d’heureuses harmonies faites pour propager les pensées morales, les passions généreuses ». Le but aurait été manqué, explique Francoeur, sans des conditions scientifiques et si (Wilhem) s’était borné à un procédé empirique. Une des applications heureuses que trouva la méthode de chant de Wilhem, Francoeur mentionne-t-il, fut dans des asiles psychiatriques où « elle contribua à une amélioration sensible de l’état des insensés ».
Voici un témoignage des cercles musicaux de l’époque sur Wilhem :
Il croyait que l’homme n’a le sentiment du beau que pour mieux apprendre à être bon ; que l’art est un agent universel dont il faut féconder et diriger la puissance ; que son germe est partout, mais qu’il appartient à quelques initiateurs de le faire éclore et de le développer dans la foule. De là sa belle pensée de grandes réunions musicales pour substituer les plus nobles plaisirs aux voluptés grossières ; de là ses persévérants efforts pour transformer Paris d’abord puis la France entière en un immense orphéon, conception pleine de poésie et de vertu, qui ne peut désormais s’éteindre et fera le tour du monde.