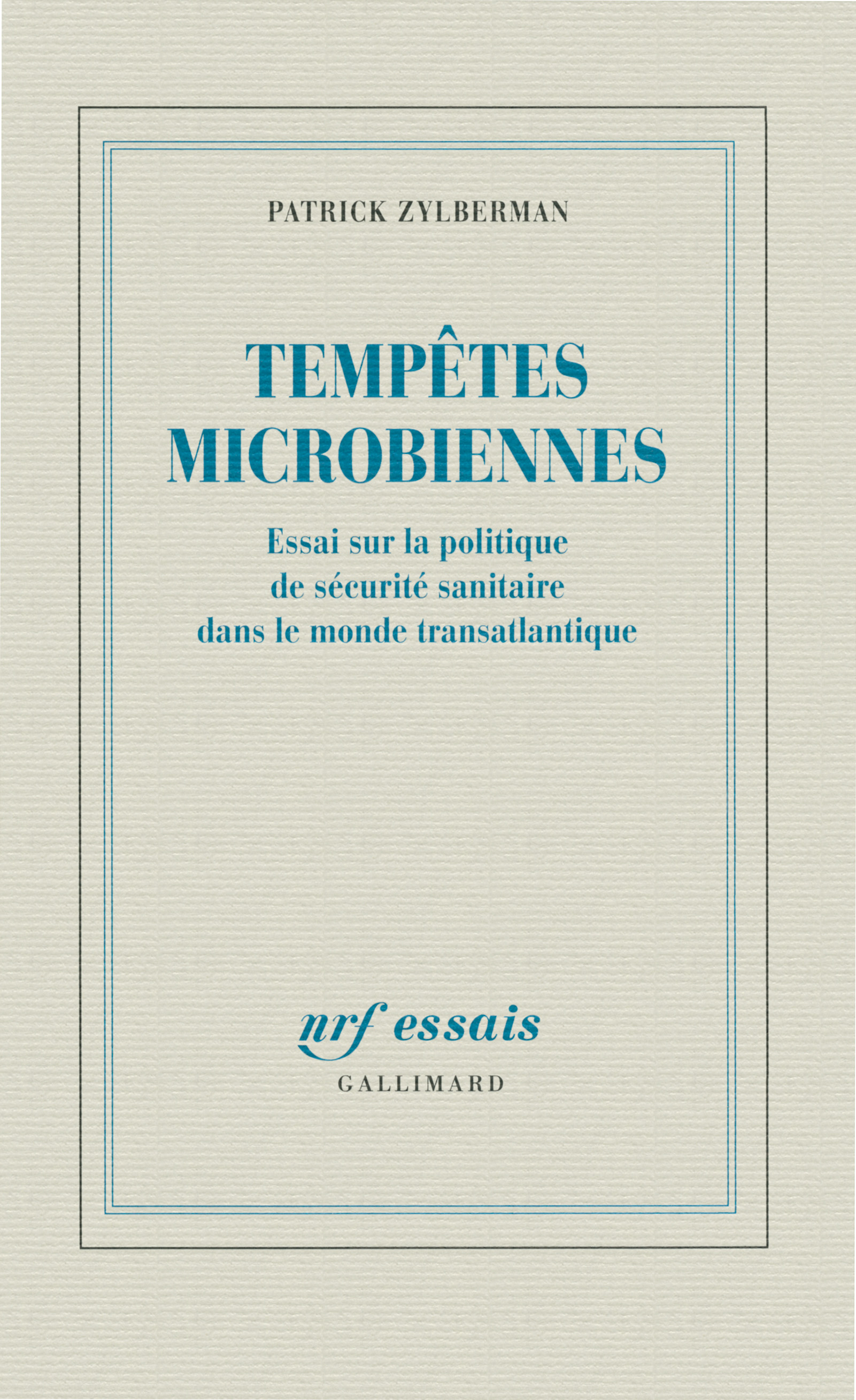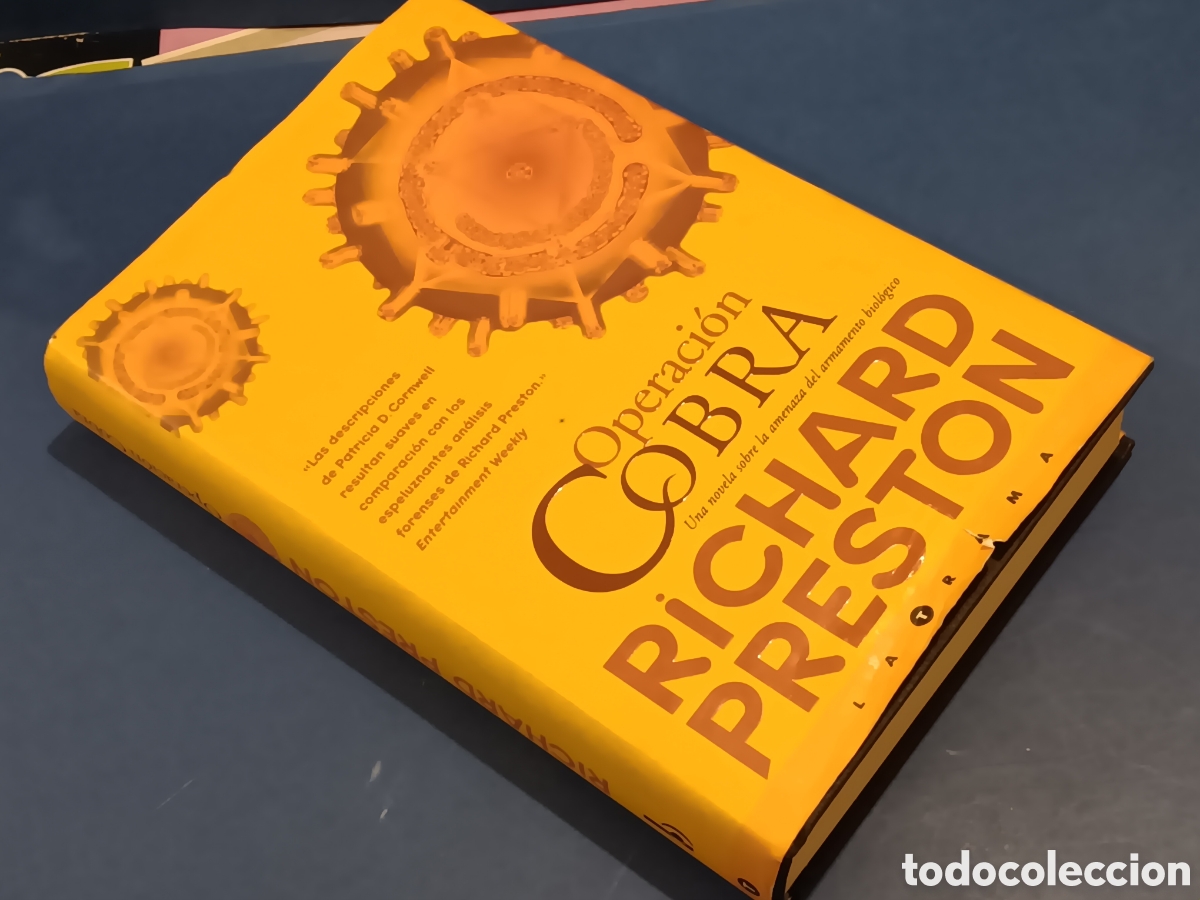Les conflits armés d’aujourd’hui ne sont-ils pas essentiellement des guerres menées contre la santé publique ? » (Pierre Perrin, The Risks of Military Participation, Humanitarian Crises, 1999)
Avoir une pensée à long terme nécessite une planification politique et économique. Dès lors, un gouvernement est mis dans une situation très inconfortable lorsqu’il doit prendre une décision sans un minimum de clarté. Or, gouverner c’est prévoir !
Malheureusement, cette nécessité absolue d’anticiper est ignorée ou plutôt biaisée dans un monde fictionnel où les conseillers des grands sont à la recherche d’un ennemi qu’il faudra se préparer à combattre. Dans ce monde alarmiste de jeux de rôles et de scénarios figés, la peur du bioterrorisme, de l’arme ultime du virus, est utilisée pour convaincre les gouvernements d’accepter la nécessité de mettre le monde sous le chapeau militaire anglo-américain. Les systèmes de santé publique nationaux et mondiaux en font les frais.
Voici une tentative de comprendre comment une administration hyper politisée de la santé publique française a si mal fonctionné lors des épisodes épidémiques du XXIe siècle : canicule de 2003, grippe aviaire de 2009, Covid-19. Ce qui pose cette question : Que reste-il vraiment de l’indépendance des services de santé publique ?
Le chapitre des maladies infectieuses est clos
Le 4 décembre 1967, William Stewart, directeur général de la santé des Etats-Unis, annonce publiquement la grande victoire de la science face aux maladies infectieuses, grâce aux immenses progrès faits dans la recherche sur les micro-organismes au cours de la première moitié du XXe siècle : anatoxines, vaccins, antiviraux, antibiotiques, etc.
En 1977, l’OMS promet « la santé pour tous en l’an 2000 » grâce à cet arsenal préventif qui pourra couvrir la plupart des maladies virales et bactériologiques de forme épidémique.
Mais le VIH/sida et l’apparition de germes pharmaco-résistants vont changer la donne sur deux points fondamentaux :
L’épidémie de sida a officiellement commencé le 5 juin 1981 quand cinq décès ont été décrits dans la revue américaine Morbidity and Mortality Weekly Report. Selon toute probabilité, le virus a été transmis à l’homme par un chimpanzé du sud du Cameroun, entre 1915 et 1941, et s’est disséminé vers les pays limitrophes. Aujourd’hui, le monde fait face à 509 mutants reconnus, selon le biologiste Lionel Cavicchioli.
Cette recrudescence est favorisée non seulement par le développement du transport international, mais aussi par les conflits militaires, les désordres politiques et sociaux encouragés par l’Occident dans les pays du Sud global.
Si des bactéries pharmaco-résistantes sont en nombre croissant dans les pays à faibles revenus et sont issues de zoonoses à plus de 52 %, les pays développés ne sont pas épargnés par un « retour » des maladies infectieuses. Un abaissement de la vigilance vaccinale et le vieillissement de la population sont d’importants facteurs d’augmentation de morbidité infectieuse. En atteste la forte mortalité chez les malades âgés atteints du Covid-19 : « 93 % des victimes du Covid sont âgées de plus de 65 ans », selon Santé publique France (SpF).
Si je tiens à affirmer ici mon soutien à la recherche vaccinale, celle-ci doit cependant rester sous protection souveraine des Etats, au bénéfice des populations.
Nouvelle doctrine
En avant-propos de ce chapitre, il faut souligner l’importance d’une étroite collaboration entre tous les services publics de santé d’un pays, ce qui inclut, bien entendu, les services de santé militaires. Mais cette collaboration doit se faire au service de l’Etat et de sa population, et en aucun cas dans le but d’un contrôle supranational dévoyé. Or, la mainmise d’intérêts étrangers sur les services de l’Etat, notamment en matière de santé publique, porte fatalement à restreindre les capacités des institutions à garantir leur indépendance et leurs moyens d’action.
Les trois types d’émergence de nouveaux virus :
- l’apparition de nouveaux variants ;
- l’introduction d’un virus existant dans une nouvelle population (hôte) ;
- la dissémination d’un virus existant d’une population isolée vers une population plus large.
Source : Tempêtes microbiennes, Patrick Zylberman, NRF Essais, Gallimard 2013, p.52
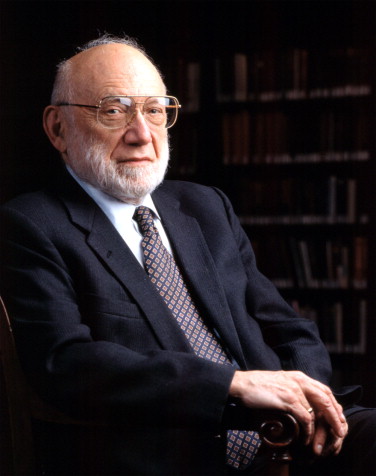
En 1988, aux Etats-Unis, le Conseil sur la santé mondiale à l’Institut de médecine (IOM) rend public un rapport sur la santé et l’évaluation sanitaire de la population américaine, The Future of Public Health. C’est un désastre : entre 1978 et 1988, l’aide fédérale aux services sanitaires a été amputée de 32 %.
En 1989, le microbiologiste Joshua Lederberg incite l’IOM à réaliser une étude qu’il préconisait depuis un certain temps : comment faire face aux maladies infectieuses (variole, grippe, etc.) que les Etats-Unis peineraient à contrôler.
Dans les années 1990, Lederberg sera l’un des théoriciens majeurs d’une « Nouvelle Doctrine de l’émergence infectieuse », qui se fonde sur une conception post-pasteurienne des épidémies virales. La doctrine de l’émergence revisite non seulement l’approche scientifique et médicale des épidémies, mais prépare l’installation d’un contrôle très militarisé et supranational qui prend le pouvoir sur la santé publique au détriment des Etats.
Selon la nouvelle doctrine, le système sanitaire international existant serait incapable de protéger les populations, d’où la nécessité d’une supervision renforcée de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’agence spécialisée des Nations unies (ONU) pour la santé publique créée en 1948.
Il faut insister sur ce point : cette doctrine se traduit, non pas par une meilleure coopération entre Etats souverains, mais par la mise en place d’une gouvernance supranationale, par un contrôle de plus en plus direct sur les décisions des Etats en matière de santé publique.
Dans le nouveau système, l’étude de la « prédiction des menaces potentielles » provoquées par l’homme (manipulation de formes virales), notamment en prévision de guerres bactériologiques, doit supplanter la prévention pasteurienne des épidémies naturelles. Cette dernière permet d’analyser les relations d’équilibre entre des agents infectieux et leurs hôtes (animaux et humains) sur le terrain et de donner aux populations les moyens prophylactiques nécessaires : hygiène, vaccins, etc.
Dans la doctrine de l’émergence, on pousse à créer des virus sur-dopés pour avoir raison d’un ennemi en mettant en danger les populations. Dès lors, puisque l’ennemi (entendez la Russie) est une menace permanente supposée, il faut donc se garantir de ses attaques éventuelles. Soulignons que Lederberg fut conseiller scientifique de neuf présidents américains, dont Bill Clinton, qui jouera un rôle clé dans le changement de politique internationale américaine.
Militarisation des germes
En 1990, un petit noyau de biologistes et d’historiens fonde la Doctrine de l’émergence infectieuse. Si on ne peut exclure la malveillance des premiers cités ci-dessous, on peut aussi imaginer que certains n’aient pas forcément totalement appréhendé les conséquences de l’application de cette doctrine.
Quelques noms :
- Stephen S. Morse (1951) épidémiologiste américain ;
- Joshua Lederberg, (1925 – 2008) biologiste moléculaire expert en génétique microbienne, intelligence artificielle ;
- Frank John Fenner, (1914 –2010) virologue australien ;
- Edwin Dennis Kilbourne (1920 –2011), microbiologiste et virologue américain ;
- Luc Montagnier, (1932 –2022) virologue français ;
- Donald Ainslie Henderson, (1928 – 2016) médecin et épidémiologiste américain ;
- Mirko Dra’en Grmek, (1924 –2000) historien de la médecine franco-croate ;
- Fernand Paul Achille Braudel (1902 – 1985), historien français.
En 1994, au cours de sa présidence du Comité d’étude sur les menaces infectieuses émergentes de l’IOM, Lederberg pose les bases d’une nouvelle stratégie d’alerte au sein des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains. Il y associe santé publique, santé animale, agronomie, écologie, sécurité nationale et industrie pharmaceutique. En maître d’œuvre, il s’approprie la direction des dossiers spéciaux sur les infections émergentes et les armes biologiques dès 1996.
Cette année-là, un réseau de surveillance globale sera mis en place, avec mise sous tutelle et contrôle renforcé des décisions parlementaires afin d’assurer le renforcement d’une bio-défense face à une éventuelle menace russe. Les membres du gouvernement font appel à des cabinets d’expertise en matière de décision financière sur les organismes de santé publique. Autrement dit, les décisions politiques se font en amont des avis des élus.

Selon Stephen Morse, membre fondateur de la Doctrine de l’émergence : « La santé publique n’est pas seulement une composante essentielle de la biodéfense : ce sera peut-être sa seule composante aux premiers stades de la réponse à une attaque biologique. » (The Vigilance Defense, Scientific American, 2002.)
Ici se trouvent entremêlés les mondes scientifique, politique et médiatique, dans de vastes campagnes hyper médiatisées sur la « sécurité sanitaire ». Dès lors, cette dernière devient une affaire de « sécurité nationale ».
Morse est un membre à vie du Conseil des relations étrangères (CFR) de New York, le lieu par excellence où s’élaborent les politiques de l’establishment anglo-américain. Il a été directeur de programme pour la biodéfense à la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) du ministère de la Défense (1996-2000), où il a codirigé le programme de contre-mesures aux agents pathogènes et a ensuite dirigé le programme de diagnostics avancés.
Il ne faut pas négliger un précieux outil de propagande, le New York Times, fidèle allié des faucons de guerre. Sa journaliste Judith Miller porte un intérêt particulier à la guerre biologique. Ses dépêches regorgent de scénarios-catastrophes, tel l’arrosage massif d’anthrax sur les villes américaines, et elle y distille une propagande anti-irakienne virulente et mensongère. Accessoirement, elle est la maîtresse de Lee Aspin, futur secrétaire à la Défense de Bill Clinton. Une présidence prise en tenailles entre les services de renseignement et le complexe militaro-financier. Clinton prendra des décisions qui auront de lourdes conséquences sur le début du XXIe siècle, après les attentats du 11 Septembre.
L’Empire régulateur de la santé publique
Avant d’aller plus avant, il faut évoquer Biopreparat, un programme scientifique et industriel de l’Union soviétique destiné à la guerre biologique, situé sur l’île de la Renaissance (Vozrozhdeniya), une péninsule en mer Aral entre le Kazakhstan et l’Ouzbelistan. Dès 1973, cette unité a la responsabilité du programme de recherche d’armement biologique soviétique. 60 000 employés y effectuent des recherches sur divers agents biologiques comme l’Ebola, la variole, le typhus, la peste noire, etc.
Les autorités soviétiques ont caché plusieurs incidents majeurs dus à des erreurs de manipulation et à des fuites au sein de leurs laboratoires comme dans l’atmosphère, notamment des microbes du charbon contaminant leurs employés et une partie de la population. Une leçon que les Russes retiendront. Après la chute du régime communiste, Biopreparat sera dissous en 1992.
En 1993, les Russes transfèrent leurs collections de virus du Centre de contrôle des épidémies de Moscou vers Vector, un centre de recherche en virologie situé à Kosolto en Sibérie. Les Américains maintiennent leur Centre de contrôle des maladies (CDC) à Atlanta, en Géorgie.
Une précision importante : il est indispensable de conserver des souches virales en vue de découvertes scientifiques visant à améliorer la santé des populations, ainsi que pour la recherche fondamentale et la découverte de nouveaux moyens de lutte contre les épidémies naturelles.
Bien que les Russes aient offert aux experts occidentaux de visiter en toute transparence leurs nouveaux laboratoires à Kolsoto afin d’apaiser les relations internationales, l’Occident se fige dans un mode de confrontation stratégique, prêt à faire face à des menaces bioterroristes supposées.
De ce fait, les Américains établissent un groupe de travail commun entre leurs ministères de la Santé et de la Défense, « chargé de proposer et de superviser des projets de recherche dans une optique défensive en cas de réintroduction de la variole ».
Ce qui est pour le moins suspect étant donné que le 9 décembre 1979, une commission mondiale a certifié que la variole avait été éradiquée et cette certification a été officiellement acceptée par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1980, et surtout, rappelons-le, que l’OMS demande la destruction des stocks existants de ce virus.
L’Amérique reste donc dans une logique offensive, prête à devancer toute menace venant des Russes, même si ces derniers ne verraient aucun intérêt à utiliser une arme biologique qui pourrait se retourner contre eux. Les virus sont peu sélectifs et en cas de conflit, une épidémie passe vite d’une armée à l’autre et contamine rapidement les populations, quel que soit le camp.
Autrement dit, l’heure n’est pas vraiment à la détente du côté américain et même les Britanniques s’en mêlent. En la personne de Graham Scott Pearson, ils obtiennent en 1995 le report de la destruction des stocks de virus variolique, contre l’avis de l’OMS qui refuse de remettre en question son ordre du jour.
Toujours dans l’idée de se préparer à un conflit, les Américains vont construire à travers le monde des laboratoires de conservation et de manipulation de virus dangereux, en prévention d’une future guerre bactériologiste. Plusieurs de ces laboratoires seront installés en Afrique, en Asie ainsi qu’à la frontière russo-ukrainienne.
Directeur général de l’Établissement de défense chimique et biologique en Grande-Bretagne et directeur du laboratoire du ministère de la Défense à Porton Down de 1984 à 1995, Scott Pearson est aussi un invité régulier des Conférences Pugwash sur la science et les affaires mondiales à Genève, dont il ne faut pas négliger les décisions qui mèneront à la guerre d’Irak. La menace bioterroriste sera alors exploitée pour justifier l’offensive américaine sur la région.
Un virus fictif
En 1998, en collaboration avec les membres du Pentagone, Richard Preston écrit un roman fiction sur une tentative d’attaque bioterroriste contre les Etats-Unis par un virus baptisé Cobra. Fruit d’une manipulation génétique des virus de la grippe et de la variole, cette chimère fictive attaque le cerveau humain, avec un taux de létalité de près de 98 %. Le récit est partagé entre la description du virus et les efforts du gouvernement pour neutraliser la menace imminente qu’il représente.
Preston sera nommé conseiller expert auprès du gouvernement.

Richard Preston, journaliste romancier, auteur du livre Operacion cobra, est l’un des inspirateurs de la politique du « preparedness ». En 1998, son roman est présenté au président Clinton qui, inquiet, demande à ses conseillers s’ils ont connaissance de ce livre. Visiblement non !
Un événement décisif marque l’été 1998 : la Corée du Nord tire un missile en mer du Japon, qui, selon les experts, « aurait pu contenir une charge biologique ». Cette nouvelle est largement amplifiée par la presse et le Pentagone.
Effrayé, Clinton y voit une confirmation de la fable de Richard Preston et annonce la publication d’un plan variole, incluant la vaccination du personnel des services d’interventions militaires et civiles : policiers, pompiers, urgentistes, etc. De plus, sous influence d’un Pentagone fermement opposé à la destruction du virus de la variole, programmée pour 1999, Clinton ordonne d’en conserver des échantillons sous protection de l’armée. Tout ceci sans qu’aucune alerte épidémique ne soit déclarée aux Etats-Unis. Les services médicaux américains sont atterrés par cette décision arbitraire, dictée par une conception uniquement géopolitique.
Toujours sous le deuxième mandat Clinton, le Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Studies multiplie les symposiums sur les dangers du bioterrorisme. Ainsi, les 16 et 17 février 1999 à Washington, 950 experts militaires, fonctionnaires de l’administration fédérale, médecins et spécialistes de la santé publique tiennent un colloque sur les différents aspects du bioterrorisme. Dix pays y sont invités, dont les principaux pays d’Europe de l’Ouest et Israël, ce qui tend à externaliser le programme américain.
Les États membres de l’Organisation mondiale de la Santé s’entendent sur un nouvel « Accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies », qui deviendra, sous pression américaine, un instrument de contrôle sur les politiques de santé nationale par les services de renseignement militaire des Etats-Unis.
Deux factions s’affrontent désormais au sein de l’OMS : les « destructionnistes » qui, après la certification officiellement entérinée par la 33e Assemblée mondiale de la Santé en 1980, appellent à l’élimination des stocks du virus variolique dans les laboratoires, et surtout de leurs manipulations génétiques augmentées (créations de chimères), et les « rétentionnistes » qui s’y opposent fermement sous prétexte de danger bioterroriste.
En 2002, lors de la 55e Assemblée mondiale de l’OMS, le moratoire sur la destruction du virus de la variole est définitivement adopté, sous prétexte d’une possible émergence de nouvelles formes hémorragiques de la maladie, hypothèse qui, jusqu’à ce jour, n’est fondée sur aucune preuve. Cela marque surtout la fin de la neutralité politique de l’OMS et sa balkanisation. L’OMS est marginalisée dans toutes les décisions touchant à la recherche en biotechnologies. Ici un verrou a sauté et la nouvelle doctrine sur les maladies émergentes et le preparadness est devenue majoritaire.
Dès lors, la sécurité des Etats en matière de défense biologique sera assurée par une direction centralisée militaire supranationale. La « société du risque » justifie désormais les contraintes et la surveillance resserrée d’une population qui se trouverait sous constante menace d’attaque virale.
Le mauvais exemple américain
A cela s’ajoute le fiasco de la désorganisation des services sanitaires américains (pompiers, urgences médicales, US Army, etc.), placés en position d’assistance technique du FBI. Par exemple, sous prétexte de secret défense, les CDC n’eurent jamais accès à la communication des fameuses lettres contaminées à l’anthrax, fin 2001 : « Obsédés par la santé publique, les autorités ont aggravé la confusion régnante en ignorant les impératifs de santé publique », commente G. Avery dans Bioterrorisme Fear.
Par contre, la population eut droit à un harcèlement médiatique sans précédent suite à l’envoi d’enveloppes « contaminées », contenant des messages du type : « 11 septembre 2001, vous ne pouvez pas nous arrêter. Nous avons cet anthrax. Vous allez mourir maintenant. Vous avez peur ? Mort à l’Amérique. Mort à Israël. Allah est grand. »
Si cette affaire criminelle ne fut, curieusement, jamais résolue, car ici la recherche de la vérité laisse la place à la propagande, elle mit la population en conditions d’accepter ce contrôle.
Autre exemple, lors du passage de l’ouragan Katrina en 2005, la ruine de la cohésion de ces différents services sera en grande partie la cause de la forte mortalité. On a compté 1836 victimes, bien souvent parce que les services de pompiers ou les ambulanciers devaient attendre les ordres d’intervention des nouveaux services de gestion militaire.
La sécurité sanitaire dans les mains de Bruxelles et de l’OTAN
Dans ce mode de préparation permanente au pire des scénarios catastrophes, l’urgence est de prendre des mesures devant assurer une sécurité maximale, car avant tout, aucun pays ne peut être pris en flagrant délit d’impréparation. Ce qui ne peut réussir sans une centralisation poussée à l’extrême, même si, politiquement, le poids de telles décisions est lourd de conséquences économiques sur la population. Une centralisation qui oblige à gonfler les effectifs de surveillants gestionnaires d’une bureaucratie qui s’avère des plus coûteuses pour la Sécurité sociale, appelée à la rescousse, et augmentent son déséquilibre budgétaire.
Le 30 octobre 2001, le Conseil des ministres européens de la Recherche crée un groupe d’experts en matière de défense contre le terrorisme biologique et chimique. Pour palier les risques bioterroristes, les représentants des ministères de la Recherche, de la Défense, de la Santé et de l’Intérieur priorisent les technologies de détection de souches virales « créées dans un but malfaisant ».
Ce qui semble a priori difficilement réalisable, sauf à permettre à ses propres laboratoires de jouer les apprentis sorciers sur des virus augmentés pour devancer les laboratoires russes qui en feraient autant. Ce qu’un accord international devrait non seulement réglementer mais interdire. Mais comme les Etats perdent peu à peu leur pouvoir de décision face à cette machine supranationale, un tel accord semble difficile à mettre en place.
Bernard Kouchner, ministre la Santé en 2001, sous le gouvernement de Jacques Chirac, explique que « l’Union européenne a intégré la biodéfense à sa politique de santé publique ». D’ailleurs, le 1er mai 2002, une Task Force contre le terrorisme voit le jour à Luxembourg : la BICHAT (Biological and Chimical Agents Threat). L’OTAN participera à certains exercices de simulation de la gestion des conséquences de crise, à Bruxelles, en novembre 2003. Désormais la gestion de la santé publique est élaborée depuis Bruxelles par la commission et l’Otan.
Préparation de l’UE et réponses aux menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), OCDE, 10 décembre 2021
Depuis 2003, influencée par les mesures prises aux Etats-Unis après les attentats du 11 Septembre, la Commission européenne crée un département à la Sécurité intérieure qui mettra à contribution les services sanitaires nationaux. Une surveillance politique centralisée reste clé de la santé publique à Bruxelles par l’Union européenne et les Etats-Unis. Le 25 avril 2005, des experts militaires, des biologistes, des médecins américains et européens et des parlementaires européens s’accordent pour un
Nouvel Agenda de défense contre le bioterrorisme.
A partir de 2014, Bruxelles se lance dans la lutte contre le bioterrorisme, qui a pris brusquement le pas sur la lutte contre le VIH, la tuberculose, la malaria et autres, délaissant en grande partie le financement de la recherche publique et ouvrant la porte à la philanthropie privée comme la Fondation Bill et Melinda Gates : Fonds des Nations unies pour la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, etc. Un partage des tâches qui contraint les Etats à se concentrer sur des réformes managériales, plutôt que sur les budgets de recherche et développement dans des programmes en immunologie, microbiologie et virologie, au service de la santé publique.
Dépendance française
« Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir. »
En 2003-2004, Didier Raoult, Pierre Lang et Jean-Marie Le Guen publient trois rapports alarmistes sur le bioterrorisme, puisant leur source dans la communication américaine.
Voici un extrait du Rapport sur le bioterrorisme, par Didier Raoult, du 1er juillet 2003, préparé à la demande du ministre de la Santé, François Mattei :
Concernant le bioterrorisme, le problème a été clairement identifié autour de la fin des années 80, après l’effondrement des pays communistes et à la suite de la guerre du Golfe. Il a été constaté, dès cette époque, que le traité de non-prolifération de 1972 n’avait absolument pas été respecté dans les pays du bloc de l’Est (un accident lié à la manipulation de la bactérie du charbon dans un laboratoire militaire avait tué une centaine de personnes en Russie et en 1979, en Irak, des silos contenant des doses considérables de toxines botuliniques et de bactéries du charbon ont pu être identifiés). Par ailleurs, on sait que l’URSS a préparé des quantités considérables de virus de la variole et il est possible qu’un certain nombre de lots aient été dispersés.
Dans ces conditions, depuis plus de 10 ans, trois risques majeurs ont été identifiés, les toxines botuliques, les spores de charbon et le virus de la variole. A la suite des événements du 11 Septembre 2001, les structures en place ont pu réagir, dans l’urgence, au problème du bioterrorisme mais depuis, plusieurs problèmes de fond ont pu être mis en évidence. »
On voit donc bien que ceux-là même qui criaient au scandale lors de la crise Covid, ont fourni les arguments pour ce contrôle supranational, à l’exemple de Luc Montagnier et Didier Raoult.
En France, depuis 2001, la gestion de crise sanitaire est coordonnée par les ministères de l’Intérieur et de la Défense. La Santé se trouve reléguée en position d’expertise et d’assistance.
Le préfet de zone, qui a vu ses pouvoirs renforcés par un décret le 16 janvier 2002, est le seul interlocuteur. En tant qu’officier général de zone défense, les établissements hospitaliers (publics et privés) sont soumis à ses décisions lors d’incidents menaçants d’ordre épidémique. Chaque plan d’urgence nécessite une armée de gestionnaires introduits dans tous les secteurs touchant à la santé, une bureaucratie pléthorique qui n’a fait qu’enfler au fil des ans et qui grève les budgets de l’Etat, tout en gonflant la dette du pays.
Des plans qui ont tous dysfonctionné pendant la canicule de 2003, le SRAS de 2004, la grippe de 2009 et bien sûr le Covid-19 de 2020. Des plans qui coûtent cher à la Caisse d’assurance maladie qui les finance avec la bénédiction du Conseil constitutionnel, puisqu’ils sont conformes aux « objectifs de sauvegarde de la santé publique », selon la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001.
Dans la loi de programmation militaire 2003-2008, la Défense développe sa collaboration avec la médecine civile. En soi l’approche se défend, mais en réalité, il s’agit d’une contrainte exercée sur le service public, qui a largement réduit son indépendance et n’a fait qu’accentuer la crise au sein des hôpitaux publics. Aujourd’hui, ces derniers, non seulement manquent de moyens suite aux différentes réformes économiques imposées par les gouvernements depuis 2002, mais on prive les services de santé de toute liberté de décision et d’entreprendre face aux catastrophes sanitaires et épidémiques. Les effets ne se font pas attendre : engorgement des urgences, diminution du nombre de lits d’hôpitaux et dans les maisons de retraite, manque de personnel… la liste est longue. Comme on peut le constater lors des épidémies de grippes saisonnières ou lors de l’épisode Covid-19.
Lors de ce dernier événement, les services de santé ne pouvaient prendre aucune décision sans l’accord des préfectures et des Agences régionales de santé (ARS) qui se disputaient la direction des opérations. Finalement, face à cette désorganisation, l’Etat a dû lâcher du lest et supprimer quelques contraintes, comme la Tarification à l’acte, qu’il a réintroduite sitôt l’épidémie en phase de décroissance.
La crise est d’autant plus grave quand les autorités politiques tardent à réagir et qu’elles sous-estiment sciemment les risques dans un but électoral ou dans celui de minimiser les dépenses, ou pire encore, qu’elles attendent le feu vert de Bruxelles avant de prendre la moindre décision.
Dans ce système mafieux, la population se sent abandonnée et manifeste son désaccord face à l’insuffisance de moyens dans le sanitaire. Le confinement de tout un pays et la surveillance policière se généralise comme moyen d’éviter les débordements intempestifs : les Gilets jaunes ont servi d’exemple. C’est vrai, « nous sommes en guerre », affirme notre Président. Dans la plus grande hypocrisie, le gouvernement compte sur le dévouement d’un personnel médical épuisé et sur une soumission contrainte des citoyens pour maintenir le calme.
Pour conclure
La France se trouve en pleine crise de gouvernance du fait que nos dirigeants s’en remettent à des autorités extérieures avant chaque prise de décision. Comme Emmanuel Macron l’a fait pendant la période Covid, laissant Mme Ursula Von der Leyen décider des achats des pays de l’Union européenne jusqu’à la moindre commande (masques, vaccins, etc.), tout en privilégiant un commerce avec les firmes américaines au détriment de la production des pays européens.
Face à un Etat qui déserte, le citoyen perd non seulement toute confiance dans les autorités mais aussi ses repères, et se désintéresse de la chose publique. En un mot, il se dépolitise, ou se radicalise. Crise de gouvernance et crise de citoyenneté agissent en synergie, alors que l’intérêt au bien commun s’efface devant une démocratie du bien-être personnel, favorisée par un espace culturel contrôlé par les écrans. Nous vivons dans le fameux Big Brother is watching you du roman de George Orwell.
L’indépendance des services de santé publique dans un Etat est strictement corrélée à son indépendance économique. Aussi, le citoyen averti a-t-il intérêt à demander des comptes à ses dirigeants politiques et à exiger leur indépendance, face aux industries militaro-financières que dirige une oligarchie basée dans le monde anglo-américain.
L’indépendance française selon de Gaulle
« Quelque chose vient de se transformer quant au rôle international de la France. Car ce rôle, tel que je le conçois, exclut la docilité atlantique que la République d’hier pratiquait pendant mon absence. Notre pays est, suivant moi, en mesure d’agir par lui-même en Europe et dans le monde, et il doit le faire parce que c’est là, moralement, un moteur indispensable à son effort. Cette indépendance implique, évidemment, qu’il possède pour sa sécurité, les moyens modernes de la dissuasion. Eh bien ! Il faut qu’il se les donne !
Mon dessein consiste donc à dégager la France, non pas de l’Alliance atlantique que j’entends maintenir à titre d’ultime précaution, mais de l’intégration réalisée par l’OTAN sous commandement américain ; à nouer avec chacun des Etats du bloc de l’Est et, d’abord, avec la Russie des relations visant à la détente, puis à l’entente et à la coopération ; à en faire autant, le moment venu, avec la Chine ; enfin, à nous doter d’une puissance nucléaire telle que nul ne puisse nous attaquer sans risquer d’effroyables blessures.
Mais, ce chemin, je veux le suivre à pas comptés, en liant chaque étape à l’évolution générale et sans cesser de ménager les amitiés traditionnelles de la France. »
(Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, tome 1, le Renouveau, Paris, Editions Plon, 1970)
Bibliographie sommaire
- Tempêtes microbiennes, Patrick Zylberman, NRF Essais, Gallimard 2013
- L’affaire cobra, Richard Preston, Ed. PLON
- Bioterrorism, Fear, and Public Health Reform : Matching a Policy Solution to the Wrong Window, May 2004, Public Administration Review, George Avery, American Health Data Institute
- Rapport sur le bioterrorisme, par Didier Raoult (Dossier PDF)
- Préparation de l’UE et réponses aux menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), OCDE, 10 décembre 2021 (Dossier PDF)
- Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, tome 1, le Renouveau, Paris, Editions Plon, 1970.
- Faut-il sauver le soldat Buzin ? https://touscentenairesetbienport.blog/2023/11/07/faut-il-sauver-le-soldat-buzin/