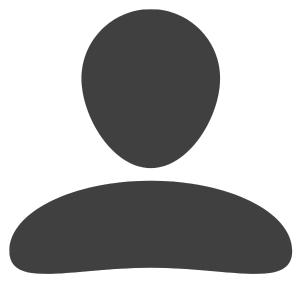[sommaire]

Cet article fait partie de notre dossier spécial Shakespeare contre Voltaire :
- La tragédie française
- Le contrepoint dans le Henry V de Shakespeare
- L’empire barbare vu par Shakespeare dans Titus Andronicus
Faut-il se réjouir de voir les opprimés s’indigner contre les injustices commises à leur encontre, à l’image des bonnets rouges qui ont récemment cassé des portiques en Bretagne ? L’histoire montre qu’une révolte sans projet positif pour l’avenir est tout sauf révolutionnaire. L’indignation sans perspective dégénère souvent en violence pour le plus grand profit des oppresseurs. Les grands patrons bretons qui ont distribué les bonnets rouges à leurs propres victimes l’ont fort bien compris.
Au XVIIIe siècle, aux grands espoirs suscités par la Révolution française dans les milieux humanistes de toute l’Europe qui se battaient pour l’avènement universel de la République, suivirent colère et consternation lorsque la France descendit les cercles de l’enfer avec la Terreur, l’Empire et la Restauration. Dans ses Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Friedrich Schiller déclare qu’« un grand moment de l’histoire a échu à un peuple petit ».
Au-delà de ce terrible constat, Schiller nous montre que pour qu’une Révolution apporte un projet de société positif, il faut que le caractère des citoyens soit sans arrêt ennobli par les idées du Bon, du Vrai et du Beau. L’éducation du caractère est la fonction fondamentale de l’art, contrairement à ce qu’on enseigne dans la société d’aujourd’hui où l’on réduit le Beau à une simple affaire de goût individuel, et l’art à une simple question de divertissement.
Grand connaisseur de la culture dite « classique » française qu’il tenait pour responsable de l’échec de la Révolution française, Schiller savait ainsi qu’il existe des conceptions de l’art qui visent à rendre les gens bêtes et méchants, c’est-à-dire incapables de penser et de menacer l’ordre établi.
C’est pourquoi nous avons pris le parti dans les trois articles qui suivent, de présenter à nos compatriotes deux pensées artistiques et politiques diamétralement opposées qui ont façonné l’histoire, celles de Voltaire et de Shakespeare, pour leur montrer qu’il existe une vie très excitante en dehors de la cage du classicisme français.
Introduction
Août-septembre 2013 : nous sommes probablement passés très près d’une guerre mondiale. Bien que chacun sache depuis longtemps que les « preuves » de l’existence des armes nucléaires de Saddam Hussein, utilisées pour justifier une attaque contre l’Irak en 2003, étaient frauduleuses, aujourd’hui beaucoup de nos concitoyens, par ailleurs opposés à une intervention militaire en Syrie, ont quand même cru que Bachar al Assad avait utilisé des armes chimiques contre la population de son pays. Comment ? En voyant des images et des vidéos dans les médias et sur Internet, montrant des Syriens morts présentant les symptômes caractéristiques de l’usage de telles armes. Ces images tinrent lieu de preuve de la culpabilité du dictateur, et permirent à certains chefs d’Etat d’exiger une attaque immédiate contre la Syrie, en violation du droit international.
Pourtant, montrer qu’un crime a été commis est une chose, prouver la culpabilité de son auteur en est une autre.
Comme on le sait, la diplomatie des Russes et d’autres a empêché cette attaque avant que l’opinion publique sache que ce n’était pas Assad qui avait utilisé des armes chimiques, mais ses ennemis, précisément pour donner un prétexte à l’intervention occidentale contre lui. Néanmoins, dans un premier temps, les gens ont cru ce qu’ils ont vu …
Toutefois, cette crédulité dont ils ont fait preuve n’est pas simplement le résultat de cette propagande politique. En fait, cette propagande ne fonctionne que parce qu’il y a quelque chose de profondément enraciné dans la culture de notre société, une propagande plus fondamentale qui nous pousse à baser nos jugements sur le témoignage de nos sens, en particulier la vision et l’ouïe, plutôt que sur notre imagination et notre pensée.
Pourquoi sommes-nous si stupides et comment pourrons-nous guérir ? Pour commencer à répondre à cela, remontons dans l’histoire des idées, et prenons pour référence l’époque où l’empirisme prit racine en Angleterre.
Francis Bacon
A la fin du règne d’Elisabeth 1ère, c’est-à-dire à la fin du XVIe siècle, c’est Francis Bacon l’étoile montante dans le ciel d’Angleterre. Bacon a été suffisamment habile pour lier sa carrière au comte d’Essex, le gigolo préféré de la reine (âgée de trente ans de plus que lui), et suffisamment courageux pour le trahir au moment où le sort de ce dernier était déjà scellé. Il faut dire qu’Essex était aussi vaniteux et ambitieux que mauvais soldat, et lorsqu’il revint d’une expédition militaire désastreuse en Irlande, il tenta un coup d’Etat mal préparé qui lui coûta sa tête. Signalons au passage que c’est à Essex que le Chœur du Henry V de Shakespeare fait allusion au début du cinquième acte, quand le roi revient victorieux en Angleterre… Après la mort d’Elisabeth, Bacon accéda aux plus hautes dignités sous le règne de Jacques 1er, son successeur.
Bacon a la réputation d’être un scientifique et un philosophe. On présente son ouvrage Novum organum comme un texte fondateur de la méthode expérimentale. En réalité, il est la figure de proue de l’empirisme tel qu’il a été introduit en Angleterre avant d’être répandu plus tard, au siècle des Lumières, en Europe continentale.
L’empirisme n’est pas la méthode expérimentale ; c’est même exactement le contraire.
L’empirisme se résume par la célèbre citation de Bacon : « Ce ne sont pas des ailes qu’il faut à notre esprit, mais des semelles de plomb ». Bacon et ses successeurs considèrent en effet que le scientifique doit commencer son travail par observer passivement les faits de la nature en s’interdisant toute idée préconçue, puis doit s’efforcer d’en induire des lois générales. En d’autres termes, l’empirisme exige que le témoignage des sens précède la pensée .
Dans son Introduction à l’étude de la médecine expérimentale , qu’il illustre par un certain nombre de ses propres découvertes, Claude Bernard nous donne une vision de la science diamétralement opposée à celle de Bacon. Bernard montre que dans une véritable découverte, l’esprit humain commence par émettre une hypothèse sur le fonctionnement de l’univers, puis soumet cette hypothèse à l’épreuve en organisant une expérience qui, si l’hypothèse est correcte, fera apparaître un fait n’ayant jamais été observé auparavant mais ayant néanmoins été anticipé grâce à l’hypothèse. Bien entendu, l’expérimentateur prend un risque : si ce fait anticipé n’apparaît pas comme souhaité, l’hypothèse doit être rejetée sans regret et il faut en trouver une autre. Donc ici, la pensée précède le témoignage des sens .
Pour le dire autrement, l’empiriste veut expliquer le passé, tandis que l’expérimentateur veut prévoir l’avenir. Ceci étant posé, Bernard n’a aucun mal à montrer que l’empiriste se condamne à ne découvrir que ce qui est déjà connu, ce qui souligne une évidence : Bacon n’a jamais fait la moindre découverte malgré sa réputation de savant.
Voici le jugement de Bernard sur Bacon :
Cependant Bacon n’était point un savant, et il n’a point compris le mécanisme de la méthode expérimentale. Il suffirait de citer, pour le prouver, les essais malheureux qu’il en a faits. Bacon recommande de fuir les hypothèses et les théories ; nous avons vu cependant que ce sont les auxiliaires de la méthode, indispensables comme les échafaudages sont nécessaires pour construire une maison.
En fait Bernard ne se contente pas de critiquer l’incompétence des empiristes à faire des découvertes, mais il montre en plus que l’empirisme est une impossibilité : il n’existe pas d’observation de « faits objectifs » sans idée préconçue. Le simple fait d’observer quelque chose plutôt qu’autre chose est, en soi, un acte qui implique un choix, donc une idée préconçue, sur ce qu’il est important d’observer… Inversement, l’expérimentateur compétent a un regard critique sur sa propre pensée et s’efforce d’être conscient de ses idées préconçues.
L’empiriste est inconscient de ses préjugés et se rend ainsi vulnérable à toute sorte de manipulations de la part de ceux qui auront cerné sa manière de penser .
Bacon était très certainement conscient de la stérilité de sa théorie de la connaissance. Sur le plan politique, on peut le considérer comme un précurseur de ce qu’on appela plus tard l’Empire britannique. Quelle est la principale menace à la stabilité et l’équilibre d’un pouvoir impérial ? La pensée humaine. Par exemple, un seul individu qui fait une découverte scientifique utile pour le progrès de l’humanité, peut ruiner un empire qui base sa suprématie sur le contrôle d’une ressource rendue obsolète par cette découverte (comme le montrent la vie et la disparition de Denis Papin, une puissance qui contrôlerait les mers du monde par sa marine à voile, pourrait se sentir menacée par la découverte d’une machine à vapeur capable de naviguer). Donc par principe, un empire fera tout pour empêcher que de nouvelles découvertes voient le jour, à moins de pouvoir mettre la main dessus.
Ce n’est pas tant le résultat des découvertes qui pose problème, mais l’acte de découverte : le fait que des individus indépendants soient capables de penser, de découvrir et, pire encore, d’inspirer leurs semblables à en faire autant. C’est pourquoi Bacon est hostile à l’idée chère aux humanistes que le peuple puisse être éduqué. Dans un rapport écrit pour Jacques 1er, il l’exprime ainsi :
Concernant l’avancement du savoir, je souscris à l’opinion d’un des plus sages et plus grands hommes de notre royaume : à savoir que les écoles [grammar schools] sont déjà trop nombreuses, et qu’en conséquence la prévoyance ne consiste pas à ajouter là où il y a excès : car (…) à cause [du grand nombre d’écoles] dans les campagnes et dans les villes on manque à la fois de domestiques à la terre et d’apprentis dans les métiers (…).
Que la main d’œuvre soit donc la moins savante possible !
C’est dans cette perspective que Bacon a écrit un certain nombre de textes sur les sciences, pour conseiller la politique du roi d’Angleterre. Dans sa Nouvelle Atlantide , il décrit une société de sages qui vivent sur une île (devinez à quelle région du monde correspond cette métaphore) et qui s’efforcent d’y rassembler tout le savoir de l’humanité. Il s’agit notamment d’envoyer des espions à travers la planète pour s’emparer d’inventions d’une part, et d’inviter les inventeurs à s’installer sur l’île d’autre part. Cette société de sages devra décider quels sont les fruits des découvertes qu’on peut rendre publics, et quels sont ceux qu’il faut maintenir au secret, étant donné qu’en dehors d’un petit groupe d’initiés, l’humanité n’est pas jugée assez raisonnable pour accéder au savoir…
C’est sur ces principes qu’a été fondée par la suite l’Académie des sciences britanniques, ou la Royal Society . L’un des épisodes les plus significatifs du rôle de cette académie est, un siècle après Bacon, le moment où elle instruisit une parodie de procès pour déterminer qui, entre son président Newton, d’une part, et Leibniz, d’autre part, avait inventé le calcul différentiel. Sans surprise dans une affaire où elle était à la fois juge et partie, la Royal Society décida que Newton était l’inventeur d’un calcul… qu’il ne maîtrisait même pas par ailleurs. Cet épisode fut utilisé pour discréditer l’influence de Leibniz, tant d’un point de vue de méthode scientifique, que d’un point de vue politique.
S’étonnera-t-on ensuite qu’il se soit trouvé des escrocs capables de répandre la légende selon laquelle Francis Bacon aurait écrit secrètement les poèmes et les pièces de théâtre les plus sublimes de l’histoire de l’humanité, en les faisant signer par un obscur prête-nom, dont l’existence même serait douteuse, et qui s’appellerait William Shakespeare ?
Pourtant, les pensées de ces deux hommes ne peuvent cohabiter dans l’esprit d’un même individu.
Mises en garde de Shakespeare
Il n’est pas besoin de chercher très loin dans l’œuvre de Shakespeare pour y trouver des exemples de personnages commettant des erreurs parce qu’ils jugent à partir de ce qu’ils voient ou entendent. L’un des cas les plus célèbres est sans doute celui d’Othello croyant que sa femme Desdémone le trompe avec son lieutenant Cassio. C’est en voyant dans les mains de Cassio le mouchoir de Desdémone, et en entendant le rire et les plaisanteries de Cassio parlant avec Iago de sa maîtresse sans la nommer, qu’Othello se convainc de la culpabilité de sa femme et décide de la tuer. En bon empiriste, Othello ne se rend pas compte que Iago le manipule pour le prédisposer à accepter, pour « preuves », des faits aussi dérisoires.
Sur un ton peut-être plus léger, dans Le marchand de Venise , un certain nombre de personnages ont également le malheur de se fier aux apparences. Dans cette pièce, le père de la belle Portia est mort avant que l’histoire commence, sans avoir pu marier sa fille. Comme il lui laisse une fortune considérable et que les prétendants ne manquent donc pas, il a voulu que celui qui épouserait sa fille, réussisse l’épreuve suivante. Le prétendant qui veut tenter sa chance devra tout d’abord s’engager, s’il échoue, à ne plus jamais chercher à se marier de toute sa vie, et à se taire sur ce qui se sera passé pendant l’épreuve. On lui présente ensuite trois coffres, un en or, un en argent, un en plomb dont un seul contient le portrait de Portia. Pour réussir, il doit deviner lequel est ce coffre, étant donné qu’à chacun est associé une énigme. Pour le coffre en or, le message dit : « Qui me choisira gagnera ce que beaucoup d’hommes désirent » ; pour le coffre en argent : « Qui me choisira aura tout ce qu’il mérite » ; et pour le coffre en plomb : « Qui me choisira doit donner et risquer tout ce qu’il a. »
Deux princes ayant choisi successivement le coffre en or et celui en argent, ont échoué à l’épreuve. Le Vénitien Bassanio, quant à lui, néglige les métaux précieux et choisit le coffre en plomb, le « vil métal ». A l’intérieur, il découvre le portrait de Portia ainsi que le message suivant :
Vous qui ne choisissez point sur l’apparence,Vous avez bonne chance et bon choix !Puisque ce bonheur vous arrive,Soyez content, n’en cherchez pas d’autre ;Si vous en êtes satisfaitEt si votre sort vous fait bonheur,Tournez vous vers votre dameEt réclamez-là par un tendre baiser.
Ceci appelle un certain nombre de remarques. Tout d’abord, il est clair que celui qui réussit, c’est celui qui ne s’accroche pas aux apparences. L’énigme du coffre en plomb associe ce genre d’attitude à une certaine prise de risque. Quel risque ? Le plus fondamental : celui de se changer soi-même . En fait, c’est le paradoxe que rencontre toute personne envisageant un projet pour son avenir – un mariage par exemple. Mais c’est aussi le propre de la condition humaine : nous ne vivons réellement que par nos projets qui nous transforment (il n’y a que les morts ou les gens très ennuyeux qui ne changent pas). Et ce futur inconnu vers lequel nous nous engageons, s’accompagne nécessairement d’une certaine forme d’inquiétude, parce que nous ne pouvons ni le voir, ni l’entendre, ni le sentir, mais seulement l’imaginer.
En somme, ce que Shakespeare suggère à travers ce conte, c’est que le fait de juger selon les apparences, d’une part, et la peur de changer, d’autre part, sont les deux expressions d’un même problème qui nous gâche la vie si nous ne le surmontons pas.
Pouvons-nous surmonter ce problème une fois pour toutes ? En fait, non : nous devons le faire à chaque instant. Et c’est pour nous rappeler cette nécessité d’un changement permanent que Shakespeare s’amuse, plus loin dans la pièce, à faire trébucher Bassanio là où il avait réussi précédemment. En effet, lorsque Portia se retrouve au procès d’Antonio, l’ami de Bassanio, déguisée en docteur en droit pour pouvoir le défendre contre l’usurier Shylock, Bassanio, trompé par les apparences du costume d’homme de loi, ne la reconnaît pas. Sous cet accoutrement, elle parvient à sauver la vie d’Antonio. Bassanio se déclare alors prêt à donner à « Portia-homme de loi » tout ce qu’elle voudra en récompense. Voulant le mettre à l’épreuve, elle lui demande et obtient l’anneau qu’il tenait de « Portia-fiancée »… à laquelle il avait pourtant juré plus tôt de le garder jusqu’à la mort. Ainsi il trahit son serment au moment même où il se laisse abuser par les apparences . Pour se moquer de lui jusqu’au bout, « Portia-fiancée » lui demande plus loin de lui montrer l’anneau qu’il ne possède évidemment plus, avant de lui révéler le piège dans lequel elle l’a fait tomber. Ainsi Bassanio, parjure pris la main dans le sac, ne peut que jurer – une fois de plus – qu’il tiendra ses serments à l’avenir… à une Portia, amoureuse de lui non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il peut devenir. Portia se montre ainsi la digne fille de son père.
Ce personnage du père, quant à lui, présente une particularité remarquable. Lorsque la pièce se déroule, il n’apparaît pas sur scène, puisqu’il est mort. Paradoxalement, il nous semble plus proche de nous, plus réel que tous les autres personnages, parce que la vérité de ce qu’il nous communique, s’impose à nous avec plus de force que tout ce que disent les autres. Ces derniers font partie d’une histoire fictive, alors qu’à travers les messages du père, nous avons presque l’impression que c’est ce farceur de Shakespeare en personne qui sort de la scène de théâtre et s’adresse à nous autres spectateurs – bien qu’il soit mort lui-même depuis longtemps. Lorsque les prétendants de Portia sont soumis à l’épreuve des trois coffres, le défi qui leur est jeté, s’adresse aussi à nous d’une certaine manière. L’âme du père qui sollicite notre imagination au-delà de la mort, est pour nous plus réelle que les autres personnages que nous pouvons voir et entendre dans la pièce.
Quelques années après Shakespeare, le peintre Rembrandt toucha à quelque chose de très voisin lorsqu’il peignit son tableau Aristote contemplant le buste d’Homère . On y voit un Aristote qui regarde le buste d’Homère avec une certaine tristesse impuissante dans le regard. Sa main droite est posée sur la tête du buste comme si, par le sens du toucher, le vivant espérait attraper quelque chose du génie du mort. Et le buste semble lui-même regarder Aristote dans une attitude nous suggérant qu’il se dit au même moment : « Quel idiot ! » L’objet de pierre représentant un homme dont les idées se réverbèrent parmi nous au-delà de sa mort, est ainsi plus vivant que le philosophe connu pour détester les idées .
De la même manière dans Le marchand de Venise , l’esprit du père de Portia semble penser, à propos des prétendants qui ont ouvert les coffres en métaux précieux : « Quels idiots ! » En effet, dans le coffre en or se trouve une tête de mort avec le message suivant :
Tout ce qui luit n’est pas or,Vous l’avez souvent entendu dire ;Bien des hommes ont vendu leur vie,Rien que pour me contempler.Les tombes dorées renferment des vers.Si vous aviez été aussi sage que hardi,Jeune de corps et vieux de jugement,Votre réponse n’aurait pas été sur ce parchemin.Adieu ! Recevez ce froid congé.
On retrouve là, bien entendu, le thème, très répandu à la Renaissance, des vanités. Ce sont des peintures ou des dessins sur lesquels un certain nombre d’objets suggérant la richesse ou le pouvoir sont associés à un crane humain (et parfois aussi un symbole du temps qui passe : une chandelle ou un sablier). L’une des plus célèbres est celle des Ambassadeurs de Hans Holbein le jeune. Sur cette peinture, les deux personnages parés de vêtements d’apparat, sont entourés d’instrument de musique (pour le prestige) et de différents objets scientifiques ayant trait à la navigation (par définition, un ambassadeur voyage à l’étranger). De l’ensemble de cette composition se dégage une ambiance d’opulence que rien ne viendrait troubler, si ce n’est une tâche oblique au premier plan que l’on n’identifie pas au premier regard. En regardant le tableau sous un angle oblique, on se rend compte qu’il s’agit d’un crane en anamorphose qui, d’un trait de peinture, nous rappelle que tout le reste de ce qu’on voit de la composition n’a aucune valeur durable, malgré les apparences.
Cette idée de vanité dans les préoccupations humaines habituelles, ne vient pas de la représentation des richesses, ni de la représentation de la tête de mort – c’est-à-dire de ce que nous voyons – mais de la tension entre ces deux mondes par principe contradictoires. Nous ne voyons pas directement cette métaphore ; elle ne s’adresse pas à nos yeux, mais à notre imagination .
Ces remarques sur les métaphores des vanités vont nous servir de base pour examiner maintenant la forme de métaphore qui se trouve au cœur de la pièce Henry V de Shakespeare. Mais juste avant cela, un dernier point sur la vanité du coffre en or. Comme nous l’avons vu plus haut, ce coffre est associé à une énigme : « Qui me choisira gagnera ce que beaucoup d’hommes désirent ». Mais quelle est cette chose que beaucoup d’hommes désirent ? Le prince qui ouvre le coffre en or, dit que c’est la belle Portia, ce qui nous porte évidemment à sourire, puisqu’il y a beaucoup plus d’hommes sur Terre qui s’intéressent à l’or, que d’hommes qui connaissent seulement Portia. Le prince lui-même est d’abord attiré par l’or du coffre (et peut être aussi par la richesse que le père de Portia laisse à sa fille) – ce qui souligne sa bêtise puisqu’il mélange dans son esprit les apparences extérieures du coffre avec ce qu’il croit trouver à l’intérieur. La réalité qu’il découvre à l’intérieur, c’est une tête de mort. Cependant, il se trouve bien peu d’hommes pour affirmer que ce qu’ils désirent c’est la mort ! Au contraire, presque tous diront qu’ils ne voudraient jamais mourir. Alors pourquoi le père de Portia semble-t-il affirmer que beaucoup d’hommes désirent la mort ? Aurait-il menti ?
Laissons cette question de côté pour l’instant et passons à Henry V .
Les vertus d’Henry
Lorsque le rideau se lève, un personnage qui apparaîtra entre chaque acte et à la fin de la pièce, entre en scène et s’adresse directement au public. C’est le chœur qui, en référence aux tragédies grecques, n’intervient jamais dans le drame proprement dit. Dans ses premières paroles enthousiastes, il nous annonce, au nom de la troupe théâtrale qui va jouer la pièce, qu’on va assister aux exploits guerriers d’un des plus glorieux rois d’Angleterre, Henry V, et en particulier à la célèbre bataille d’Azincourt qui se solda par une victoire anglaise contre une armée française largement supérieure en nombre.
Cependant, il ajoute qu’une scène de théâtre – dérisoire à côté d’un champ de bataille – ne peut pas donner à nos yeux et à nos oreilles un spectacle aussi grandiose que la réalité. Réclamant donc l’indulgence du public, il lui demande de se fier davantage à son imagination qu’au témoignage de ses sens :
Comblez nos lacunes à force de pensée.Qu’un seul homme pour vous en représente mille,Et l’imagination vous créera une armée !Quand nous parlerons de chevaux, voyez-les en espritImprimer leurs fiers sabots sur le sol ameubli,Car ce sont vos pensées qui doivent vêtir nos rois,Les porter çà et là, enjambant les époques,Réduisant ce qui fut l’œuvre de mainte annéeAu laps d’un sablier.
Les apparences ne sont donc qu’un support à l’imagination. Commençons donc par nous intéresser aux apparences du personnage qui donne son nom au titre de la pièce. Qui était Henry V ?
Au milieu du XIVe siècle, le roi d’Angleterre Edouard III lance contre la France ce qu’on appellera ensuite la guerre de Cent Ans. Edouard III réclame pour lui la couronne de la France, en tant que seul héritier en ligne directe de Philippe le Bel. Edouard est le fils d’Isabelle de France, la fille de Philippe. Philippe avait également trois fils morts sans laisser de fils. Selon la loi salique respectée officiellement en France, la couronne ne peut se transmettre que par des héritiers mâles. Ce sont donc les descendants mâles du frère de Philippe, les Valois, qui montent sur le trône de France. L’argument d’Edouard III est que la loi salique n’ayant pas toujours été respectée, il ne la reconnaît pas. Les chevauchées meurtrières des fils d’Edouard qui détruisent et massacrent tout sur leur passage, sont l’une des raisons pour lesquelles ce siècle s’est appelé par la suite « Age des ténèbres ». Ayant conquis la plus grande partie de la France, Edouard a le temps, avant de mourir, de tout voir repris grâce à un roi de France exceptionnel, Charles V. Ceci, joint à des guerres internes à l’Angleterre, met provisoirement un terme à cette opération de pillage.
Lorsque Henry V, l’arrière-petit-fils d’Edouard, monte sur le trône d’Angleterre en 1413, il décide de relancer la guerre et s’empare de la France. Pour assurer la stabilité de la couronne de ses descendants, il épouse Catherine, la fille du roi de France Charles VI, auquel il a prévu de succéder après sa mort. Et c’est sur la scène du mariage entre Henry et Catherine que s’achève la pièce Henry V . Cependant, à la mort de Charles VI, ce n’est pas Henry V, mais son fils Henry VI qui est couronné roi de France au berceau, car Henry V est mort deux mois avant son beau-père.
Alors sous quelles apparences Shakespeare nous montre-t-il Henry V ?
Lors de sa première apparition sur la scène, il demande à des religieux de son entourage si cette guerre qu’il envisage pour reprendre la France serait une guerre juste, s’il peut risquer de faire couler le sang de milliers d’hommes sans avoir à répondre plus tard de crimes devant Dieu. Les prélats lui ayant répondu que sa cause est juste, il décide de lancer l’opération. Plus loin, après sa victoire éclatante à Azincourt, il proclame que puisque une armée anglaise si réduite en nombre a gagné la bataille, c’est bien la preuve que Dieu était de son coté et que cette guerre était bel et bien légitime.
La nuit précédant Azincourt, il parcourt le campement déguisé en simple soldat pour ne pas être reconnu de ses hommes, et s’efforce d’expliquer à un groupe démoralisé, que si des soldats commettent des crimes, la faute ne doit pas en retomber sur la tête du roi. Par ailleurs, il fait pendre Bardolph, l’un de ses anciens compagnons d’avant qu’il soit roi, car ce dernier profite de la guerre pour piller une église. Bref : ce roi présente toutes les caractéristiques d’un roi humble, pieux et plus préoccupé de justice que de lui-même. Cette impression est renforcée par le fait qu’Henry apparaît presque toujours calme et aimable, malgré les provocations de ses ennemis, et ne se montre en colère que lorsqu’il découvre que les Français ont tué les enfants qui gardaient le campement anglais.
Avec la justice et l’humilité, le courage. La situation anglaise à la veille d’Azincourt semble effectivement désespérée : l’armée anglaise a remporté beaucoup de victoires, mais se trouve décimée et épuisée par le nombre de batailles qu’elle a menées. En face, les troupes françaises sont fraîches et plus nombreuses. Henry surmonte sa propre peur, qu’il exprime au cours d’un monologue mais qu’il cache en public. Au contraire, il redonne courage à ses hommes démoralisés au moment où la bataille va s’engager en ce 25 octobre, jour de la Saint Crépin, par ce discours :
Et Crépin Crépinien ne reviendra jamais,De ce jour à la fin du monde, sans que soit évoquéNotre souvenir, celui d’un petit nombre,D’un heureux petit nombre, d’une bande de frères,Car celui qui aujourd’hui verse avec moi son sangSera mon frère ; si basse que soit sa condition,Cette journée l’anoblira.
Le roi et ses « frères » gagnent donc la bataille. Dans le dernier acte de la pièce, Henry courtise Catherine de France. La jeune fille apeurée et limitée par sa mauvaise connaissance de la langue anglaise, parle peu dans cette scène. Henry lui déclare qu’il se trouve très embarrassé pour lui parler d’amour, car il n’est qu’un soldat et que, par conséquent, il ne connaît pas les usages et le langage des courtisans qui s’efforcent de plaire. Ce qui est une manière évidente de dire que, contrairement aux autres, il parle avec simplicité et franchise – des qualités auxquelles Catherine n’est évidemment pas habituée à la cour de France…
Bref, pour chacune de ces qualités de bon roi, que Shakespeare nous présente dans le personnage d’Henry V, le défaut correspondant se retrouve dans le camp français, et en particulier dans le personnage du dauphin, le fils de Charles VI. En se basant simplement sur les apparitions d’Henry V sur scène, il s’avère donc impossible de voir dans la pièce autre chose qu’un éloge vibrant du jeune roi.
Le contrepoint de Pistol
Une qualité suprême de courage pourrait peut-être figurer également dans le tableau précédent : le courage de se remettre soi-même en question. En effet, on apprend dès le début, dans la discussion de deux prélats, qu’Henry V a surpris tout le monde lorsqu’il est arrivé au pouvoir. De débauché, il est devenu vertueux et a abandonné d’un coup toutes ses anciennes fréquentations et ses mauvaises habitudes. Il faut préciser ici que la pièce Henry V , est la quatrième et dernière d’une tétralogie comprenant Richard II et les deux parties d’ Henry IV . On voit effectivement, dans Henry IV , le prince Harry, le futur Henry V, fréquenter des brigands, des ivrognes et des maquerelles. Le jour où il accède à la responsabilité suprême, il abandonne tout ceci comme une vieille peau. Cependant, certains de ses anciens compagnons, Pistol, Nim et Bardolph, prennent part à l’expédition de son armée contre la France. Un jeune page, jadis confié par le prince Harry à l’ancien chef de la bande, les accompagne et les juge pour ce qu’ils sont réellement : des voleurs sans scrupules mais plutôt minables, et surtout, les soldats les plus lâches de toute l’armée anglaise.
Pourquoi Shakespeare nous montre-t-il ces personnages qui personnifient l’antithèse du roi, dans une pièce où le chœur commence par nous tenir en haleine en disant qu’on va assister à un spectacle destiné à évoquer des exploits guerriers ? En réalité, il n’y a aucune scène de bataille dans toute la pièce Henry V ! Ceci est d’autant plus étonnant que Shakespeare ne s’est pas gêné pour nous en montrer dans d’autres circonstances. Dans la première partie d’ Henry IV , par exemple, on voit le jeune prince Harry combattre héroïquement et vaincre Percy, le chef de l’armée ennemie. Ici rien de tel. Chaque fois qu’une bataille se déroule, c’est en coulisse, et pendant ce temps on voit Pistol et ses comparses discuter entre eux tout en essayant de se cacher.
Le summum du comique est atteint au moment de la fameuse bataille d’Azincourt, qui est censée être l’évènement le plus important de toute la pièce, si l’on en croit les annonces du chœur. Or que se passe-t-il alors ? Pistol, flanqué du jeune page, se retrouve malgré lui nez-à-nez avec un chevalier français encore plus terrorisé que lui. Avant même qu’un coup ait été échangé entre les deux, le Français implore la pitié de Pistol qu’il prend pour le plus vaillant guerrier de toute l’armée anglaise. Le page qui parle français rassure alors Pistol en lui expliquant que le chevalier est en train de se rendre et de lui proposer une rançon en échange de sa vie. Bien entendu, on peut penser que si le plus grand lâche de toute l’armée anglaise parvient ainsi à vaincre un Français, cela signifie que le reste de l’armée anglaise doit se comporter vaillamment sous le commandement du grand roi. Après tout, le chœur ne nous a-t-il pas invités à faire l’usage de notre imagination :
Qu’un seul homme pour vous en représente mille,Et l’imagination vous créera une armée !
On a un doute, tout de même. Imaginez que vous multipliez Pistol par mille, qu’obtiendrez-vous ? Par ailleurs, cette scène se déroule alors qu’Henry vient de prononcer son « morceau de bravoure » et que ses paroles résonnent encore dans nos esprits :
Celui qui aujourd’hui verse avec moi son sang sera mon frère
Quoi ? Pistol, frère de sang d’Henry V ? Shakespeare nous jette dans l’embarras. Notre sentiment de perplexité ne s’arrête pas là, puisqu’au début du cinquième acte, le chœur nous annonce le retour triomphal d’Henry V en Angleterre, et qu’on ne voit pas sur scène Henry V revenir en Angleterre. Au contraire, lorsque le roi réapparaît sur scène, c’est au moment où, reçu à la cour de France, il négocie sa victoire et son mariage. En fait, le personnage qui, revenant en Angleterre, succède au chœur sur scène, c’est Pistol. On le voit recevoir une correction de la part du capitaine gallois Fluellen, qui le force à manger un poireau, emblème du Pays de Galles dont Pistol s’était moqué précédemment.
Les comportements respectivement digne et ridicule d’Henry et de Pistol, agissent ainsi, tout au long de la pièce comme deux voix dans un contrepoint musical. Il nous est tout autant impossible de douter du courage d’Henry que de la couardise de Pistol. Mais où cela nous mène-t-il ? Où est la résolution de cette énigme ?
Un premier élément de réponse nous conduit à revenir sur une autre pièce : la première partie d’ Henry IV , au moment où le personnage du prince Harry, encore loin d’être roi d’Angleterre, apparaît sur scène pour la première fois. Il se trouve alors dans les bas fonds de Londres au milieu de ses compagnons de débauche et de rapine. Laissé seul un instant par ces derniers, le personnage se tourne alors vers les spectateurs de la pièce et prononce un monologue dans lequel il nous explique sa conduite. Il dit qu’il se donne délibérément les apparences d’un voyou pour pouvoir aller dans ces endroits mal famés qui lui seront fermés une fois qu’il aura été couronné roi d’Angleterre. Il prétend ainsi apprendre à connaître le cœur de ses futurs sujets pour ne pas se laisser tromper par eux plus tard.
Par ailleurs, il compte sur ce stratagème pour provoquer un choc et affermir son pouvoir, en jetant le masque le jour où il succèdera à son père. On l’admirera d’autant plus pour sa nouvelle vertu, dit-il, qu’on aura été habitué à le voir débauché ; inversement, son mérite apparaîtrait moindre, sans ce changement d’apparence . Et en effet, le jour de son couronnement, à la fin de la seconde partie d’ Henry IV , il rejette brutalement ses anciens complices à la surprise générale, et affirme avec force que désormais son comportement sera exemplaire. Au moment où cette pièce s’achève, l’idée d’une très prochaine invasion de la France est évoquée dans l’entourage du nouveau roi.
Quelle confiance accorderiez-vous à quelqu’un qui vous dirait : « Je vais vous dire la vérité : je suis un menteur. » ? C’est en substance, le langage que Shakespeare met dans la bouche du prince Harry. Tout ceci nous rappelle un fait indissociable de la fonction de roi : un tel personnage se trouve, en permanence, en représentation – comme un acteur de théâtre. En effet, un roi est sans arrêt entouré d’une multitude de personnages ; il sait que chacun de ses actes et chacune de ses paroles seront connus du plus grand nombre. Lorsqu’il parle, son attention n’est pas simplement fixée sur la véracité, ou l’absence de véracité, de ce qu’il dit, mais aussi et surtout, sur l’ effet que cela va produire. En d’autres termes, beaucoup d’évènements de la vie du roi semblant spontanés sont en réalité soigneusement calculés.
Par exemple, il est indéniable, d’après tout ce qui précède, que le personnage du roi Henry V veut paraître humble et pieux. Il le paraît, en effet ; mais l’est-il réellement ? Est-ce réellement de l’humilité et de la piété, de faire proclamer que la victoire d’Azincourt n’est pas celle du roi, mais celle de Dieu ? Ou n’est-ce pas plutôt une habile propagande destinée à décourager ceux qui voudraient, par la suite, lever une armée contre Henry V ? (Serait-ce prudent de vouloir faire la guerre à celui dont la cause est juste car Dieu l’a favorisé ?)
Il peut sembler, à première vue , difficile de répondre à ces questions dans un sens ou dans un autre. L’acteur qui joue Henry V doit séduire le spectateur, et la présence de Pistol en contrepoint, laisser un certain sentiment de perplexité. Cependant, pour mieux comprendre la composition dans son ensemble, il nous faut maintenant ajouter une troisième voix à ces deux-là.
L’entrée des évêques
La pièce Henry V débute par le prologue du chœur dont il a été question ci-dessus, mais la première scène du premier acte est un dialogue entre l’archevêque de Cantorbéry et l’évêque d’Ely. Ils sont d’accord dans le jugement qu’ils portent sur le jeune roi, qui reflète effectivement le changement d’apparences annoncé par le prince Harry :
Cantorbéry. – Le roi est très pieux et pour nous plein d’égards.Ely. – C’est un sincère ami de notre sainte Eglise.Cantorbéry. – Rien dans sa jeunesse ne l’eût laissé prévoir.
Mais le véritable sujet de préoccupation de ces deux prélats, est une proposition de loi que les Communes veulent faire adopter, et qui entraînerait la mise sous séquestre d’une bonne partie des biens de l’Eglise d’Angleterre pour l’entretien des dépenses de la cour. Que pense le roi de cette proposition ? C’est ce dont discutent les deux religieux. Lorsque la scène s’achève, ils sont arrivés à la conclusion que le roi ne touchera pas aux biens de l’Eglise, si l’Eglise lui propose un meilleur moyen de renflouer ses coffres. Et un moyen très simple se présente : la conquête de la France. Il ne leur reste donc plus qu’à convaincre Henry de se lancer dans ce projet.
En 1979, David Giles a mis en scène la pièce Henry V dans un projet lancé par la BBC d’une intégrale des pièces de Shakespeare filmées pour la télévision. Dans l’entrevue de ces deux prélats, il a fait un choix particulièrement heureux. Ce que le spectateur entend , c’est évidemment la discussion chuchotée, très intéressée, des deux compères sur leurs biens et sur la guerre ; mais ce que le spectateur voit , c’est deux religieux isolés dans une chapelle, et occupés aux exercices de prière habituels de leur fonction. On comprend qu’ils procèdent ainsi parce qu’ils ne veulent pas que leur conversation soit surprise ; mais du coup, il y a ici une contradiction complète entre ce que le spectateur voit et ce qu’il entend. Et de cette contradiction naît un sentiment qui n’existerait pas avec la vision seule ou l’audition seule de la scène : ces deux individus sont de purs hypocrites, pas si différents que ça, dans leurs préoccupations, des créatures fréquentées autrefois par Harry dans les bas-fonds.
Dès lors, entendre ces deux prélats louer le jeune roi pour sa piété, fait surgir de nouvelles interrogations dans notre esprit. Sont-ils en train de dire : « Nous pouvons manipuler cet idiot à volonté » ? ou alors : « Le roi est un des nôtres : un voyou » ? ou autre chose encore ? Quoi qu’il en soit, on s’éloigne quelque peu du portrait héroïque que venait de nous donner le chœur dans le prologue, quelques instants auparavant. Lorsque la discussion cesse, le roi entre en scène et c’est précisément vers ces deux doctes personnages qu’il se tourne pour poser la question fondamentale qui reviendra sous différentes formes, implicites ou explicites, tout au long de la pièce : « Ma guerre est-elle juste ? »
Au moment où Henry pose cette question pour la première fois, il est important de réaliser qu’il s’adresse à deux personnages qui, du fait de leur apparence, de leurs titres, de leurs vêtements… constituent la référence morale pour l’ensemble de la société qui assiste à cette discussion. Autour du roi et des religieux se trouvent tous les dignitaires du royaume qui seront appelés à participer à l’expédition contre la France. Que le roi soit ou non sincère dans son questionnement, il est important que ceux qui vont s’associer à lui, voient la question et entendent la réponse. Or, les porte-parole de l’Eglise « montrent » de manière irréfutable, à coup d’études généalogiques, que la France n’a pas toujours respecté la loi salique, et donc que la guerre d’Henry est juste. CQFD. Dieu est donc avec Henry, et on peut partir en France, tuer et piller avec lui en toute innocence !
Si la démonstration généalogique est à ce point irréfutable, pourquoi la question de la justesse de cette guerre se repose-t-elle à tout moment dans la pièce ? Parce qu’un doute subsiste encore. L’art de Shakespeare consiste justement à maintenir cette situation ambiguë pratiquement tout le temps, pour le plus grand inconfort intellectuel de son public. Cependant, au fur et à mesure que le drame se déroule, le doute se développe et la guerre apparaît de plus en plus pour ce qu’elle est réellement : une guerre d’agression et de pillage. Henry V le dit lui-même de manière presque explicite à la fin, lorsqu’il courtise Catherine de France dans quelque chose qui ressemble à un langage d’amour, mais qui laisse percer ses véritables motivations :
Catherine – Est-il possible que j’aime l’ennemi de la France ?Le roi – Non, il n’est pas possible que vous aimiez l’ennemi de la France, Kate. Mais en m’aimant, vous aimeriez l’ami de la France, car j’aime tant la France que je ne veux pas en perdre un seul village, je la veux à moi tout entière (…)
Drôle d’amitié qui veut vous réduire en esclavage ! Henry ne s’intéresse pas au bien de la France et à son avenir, mais plutôt à la posséder comme sa chose. Et il se comporte évidemment de la même manière avec la jeune fille qu’il veut séduire et épouser. Celle-ci s’en rend d’ailleurs compte et lui dit qu’il utilise un langage trompeur, et lorsqu’il lui demande si elle veut de lui, elle lui répond, en jeune princesse bien élevée et qui n’a que le choix d’obéir, que ce sera selon le bon plaisir de son père… lequel n’a pas non plus d’autre choix que de marier sa fille au roi d’Angleterre, puisqu’il a perdu la guerre. Henry n’a pas gagné les cœurs malgré l’ambiance apparemment amicale de toute la scène.
Le chœur atemporel
Pourquoi Shakespeare écrit-il ? Cette question peut paraître déplacée à une époque comme la nôtre où l’on considère en général que l’art est une forme de divertissement parmi tant d’autres. Cependant, pour un véritable artiste comme Shakespeare, l’art est précisément le contraire du divertissement. Le travail du dramaturge ne vise pas à bannir le plaisir des préoccupations humaines, mais plutôt à créer un certain type de relations sociales, de discussions entre les spectateurs, etc., où, naturellement, les gens prendront plaisir à devenir plus intelligents…
Considérons la pièce Henry V . Quel est l’enjeu ici ? Shakespeare nous présente des personnages ambigus et des situations contradictoires. Nous prenons plaisir à suivre le drame mais, en même temps, notre jugement est sans arrêt mis à l’épreuve du fait de toutes ces contradictions. Au terme de la représentation, nous nous retrouvons avec beaucoup de questions à l’esprit. Et c’est précisément là le but : le chemin vers l’intelligence passe par la perplexité. Où est la vérité ? Nulle part dans ce que nous voyons ou entendons, mais les contradictions que nous renvoient nos sens, nous poussent à chercher la vérité au-delà de tout cela. Dans notre imagination.
C’est ici qu’il faut considérer plus spécifiquement le chœur d’ Henry V . Ce personnage a un statut très particulier : il se situe complètement hors du temps et de l’action du drame, il n’interagit avec aucun des autres personnages, mais il s’adresse directement au spectateur de la pièce. Contrairement aux autres personnages qui se débattent un peu comme des fourmis dans l’ici et maintenant, le chœur a une connaissance d’ensemble de tous les instants et de toutes les situations. Il est donc celui qui connaît la vérité.
Mais alors, ironie suprême !, il nous raconte certaines choses qui semblent elles-mêmes contredire des évènements que nous voyons et entendons se dérouler sur scène. Nous ment-il ? Pas vraiment : il dit et répète que la vérité se situe à un niveau supérieur, et nous invite sans arrêt à « voir » par l’imagination et l’esprit. Et c’est ainsi que nous sommes invités à nous conduire à chaque instant de notre vie, une fois sortis du théâtre.
Dans les derniers instants de la pièce, après plusieurs heures d’ambiguïté, la chute est énoncée dans un dernier monologue du chœur :
Peu d’années mais, de cet astre d’Angleterre,Ce peu vit la grandeur. Forgée par la Fortune,Son épée conquit le plus beau jardin de la TerreDont il laissa son fils l’impérial souverain.Henry VI, au maillot couronné roi d’AngleterreEt de la France, à ce monarque succéda, mais tantDe gens eurent la direction de son étatQu’ils perdirent la France et mirent l’Angleterre en sang,Ce que notre scène a souvent représenté,En souvenir de quoi, que votre aimable espritAccorde bon accueil à ce spectacle-ci.
On se souvient que l’argument qu’Henry croit décisif pour montrer que sa guerre est juste, c’est que Dieu lui a fait gagner la bataille d’Azincourt. Cet argument est balayé du revers de la main par ces quelques vers, car la réalité de ce que le roi laisse de durable pour la postérité, ne se trouve pas dans son succès présent, mais dans la ruine future de ce qu’il s’imagine avoir bâti. Autrement dit, Dieu, pour qui le passé, le présent et le futur sont simultanés, n’est donc pas du côté d’Henry V… (Un examen approfondi de l’ensemble des pièces historiques de Shakespeare, auquel il est fait référence dans cet épilogue, permettrait d’étoffer davantage ces affirmations, mais ceci nous conduirait trop loin par rapport à l’objectif de cet article).
Comment exécuter Shakespeare
En 1989, Kenneth Branagh réalisa un film de cinéma intitulé Henry V . Un véritable tour de force : il réussit, à partir de coupes effectuées sur le texte de Shakespeare, à atteindre la pureté absolue, c’est-à-dire l’absence totale d’ambiguïté. Pas besoin de se creuser la tête pour comprendre son « message ». Il s’agit ici d’exalter la guerre, la violence, le triomphe de la volonté, etc., et de se poser en demi-dieu, en héros admirable car, en toute modestie, Branagh s’est attribué à lui-même le rôle du roi d’Angleterre pour se faire filmer avantageusement sous tous les angles… bref, un projet exactement opposé à l’intention de Shakespeare.
La scène du discours de la Saint Crépin et celles qui suivent sont assez représentatives de l’ensemble du film. Apparemment Branagh doit considérer que le texte de Shakespeare manque de puissance, puisqu’il a cru bon de se faire accompagner d’une musique hollywoodienne qui va crescendo jusqu’à l’apothéose au fur et à mesure qu’il débite le discours. Ceci étant fait, les soldats se mettent en ordre de combat, avec les visages crispés filmés en gros plan – ce qui n’est pas très original mais qui nous rappelle que le cinéma contemporain s’est beaucoup inspiré de Leni Riefenstahl.
L’armée française arrive au galop et la bataille commence. La bataille ? Et oui ! Il y a une bataille là où Shakespeare avait placé la scène comique de Pistol et du chevalier français. Exit Pistol, chez Branagh, on ne rit pas : on a du sang, de la tripe, de la boue, et pour être sûr que le public ne manque rien, certains passages sont même filmés au ralenti. Il va sans dire, que le tout est dominé par un vacarme tel que l’ouïe, aussi bien que la vue, soient complètement saturées. En excitant ainsi le public, on cherche à susciter en lui des émotions violentes et convergentes, et l’ empêcher de penser . La réalité se limite alors au témoignage des sens.
L’émotion sans la pensée ? Ce genre de procédé a déjà été testé dans de célèbres discours politiques dans l’Allemagne des années 1930, et il ne serait pas inapproprié, ici, de faire une remarque sur la manière dont les nazis procédaient avec Shakespeare. Hitler appréciait tout particulièrement Le marchand de Venise . Il faut savoir que dans cette pièce, il y a un « méchant » évident : l’usurier juif Shylock. Au début, Antonio veut emprunter une somme d’argent très importante et n’a d’autre choix que de s’adresser pour cela à Shylock qu’il déteste par ailleurs. L’usurier accepte le prêt, mais y met une condition : si Antonio ne le rembourse pas dans les délais prévus par le contrat, Shylock pourra prélever une livre de chair d’Antonio à l’endroit qui lui plaira. Or, le moment venu, Antonio n’a pas l’argent et Shylock exige son dû devant les autorités de Venise. Bien que tous les chrétiens de la cité des doges soient des amis d’Antonio, les lois donnent raison au juif et Antonio semble condamné. Au dernier moment, Portia entre en scène déguisée en avocat pour défendre Antonio. Dans sa plaidoirie, elle oppose à la haine et à la rancune de Shylock, l’un des principes fondateurs du christianisme : le pardon des offenses, et appelle l’usurier à s’élever en suivant de meilleurs sentiments. Celui-ci refusant de pardonner, elle utilise alors des lois vénitiennes oubliées de tous, pour retourner la situation in extremis . A la fin, le juif est même contraint de se convertir au christianisme. Happy end.
Ainsi, Le marchand de Venise a été promu dans les années 1930 comme œuvre de propagande antisémite. Néanmoins, ceux qui acceptent ce genre de calomnies contre Shakespeare confondent la réalité avec ce qu’ils voient et entendent, et s’avèrent donc stupides comme des nazis. En effet, comme le faisait remarquer le metteur en scène John Barton, dans une émission diffusée sur Channel Four en 1984 et intitulée « Playing Shakespeare », où il discutait avec Patrick Stewart et David Suchet (ce dernier étant lui-même juif), deux acteurs shakespeariens connus pour leurs interprétations de Shylock, le fait que la plupart des personnages de la pièce soient antisémites, ne signifie pas que Shakespeare soit lui-même antisémite.
Que Shylock soit un horrible individu ne fait pas l’ombre d’un doute, mais ceci entraîne-t-il nécessairement que ses ennemis soient de grands humanistes ? On peut en douter, car chaque fois que Shylock donne des raisons de son comportement haineux envers les chrétiens, il explique qu’il ne fait que reproduire la manière haineuse dont les chrétiens se comportent envers lui :
Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas ? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas ? Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas ? Et si vous nous outragez, ne nous vengerons-nous pas ? Si nous sommes semblables à vous dans tout le reste, nous vous ressemblerons aussi en ce point. Si un juif outrage un chrétien, quelle est la modération de celui-ci ? La vengeance. Si un chrétien outrage un juif, comment doit-il le supporter d’après l’exemple du chrétien ? En se vengeant. Je mettrai en pratique les scélératesses que vous m’apprenez ; et il y aura malheur si je ne surpasse pas mes maîtres.
Comme un miroir, Shylock renvoie à la bonne société vénitienne l’image de sa propre corruption, et surtout de sa propre hypocrisie. Ce ne sont pas les principes d’amour du prochain à la base du christianisme, que Shakespeare attaque ainsi. Au contraire, il s’appuie sur ces principes pour dénoncer tous ceux qui se disent chrétiens et ne les respectent pas. Ainsi, Le marchand de Venise n’oppose pas judaïsme et christianisme, mais vise plutôt ceux dont les actes contredisent les paroles, en particulier chez les chrétiens.
On oublie trop souvent qu’une telle polémique n’a rien d’un exercice abstrait à l’époque où Shakespeare écrit ses pièces. Nous sommes en plein dans les guerres de Religion, entre et à l’intérieur de nations nominalement chrétiennes. Catholiques contre protestants, calvinistes contre luthériens, anglicans contre papistes… compte tenu des crimes commis dans le passé, chacun a de bonnes raisons de haïr son prochain comme soi-même ; tous s’entretuent en prétendant détenir la véritable foi, et tous trahissent leurs propres principes. En faisant réaffirmer ces principes par Portia, l’un des seuls chrétiens de la pièce à ne pas manifester de haine envers le juif, Shakespeare montre la voie de la paix.
Epilogue
Les guerres de Religion ravageront encore l’Europe pendant une bonne trentaine d’années après la mort de Shakespeare. L’acte qui consacra leur fin, le Traité de Westphalie, fut signé en 1648. Ce texte repose sur la mise en application, sur le plan politique et économique, d’un certain nombre de principes communs aux anciens ennemis, et en particulier le pardon des offenses et l’avantage d’autrui. On reconnaît là les fondements du christianisme pour lesquels Shakespeare, entre autres, s’est battu toute sa vie. Il ne serait donc pas exagéré de dire que si Shakespeare avait vécu assez longtemps, il aurait pu dire à propos de la Paix de Westphalie : « C’est mon œuvre la plus belle. » Shakespeare n’a jamais pu voir le Traité de Westphalie, ni même en entendre parler, et pourtant, en concevant certaines idées immatérielles, il a contribué volontairement à son existence future.
Répétons-le : la réalité, c’est le futur. La motivation de Shakespeare, c’est de bâtir le futur au-delà de sa propre mort. En fait, il y a en chaque être humain quelque chose qui résonne d’une certaine manière avec ce genre de désir. Shakespeare essaie de jouer là-dessus. Mais il ne faut pas se laisser manipuler par de faux prophètes. Voici ce que dit l’un d’entre eux :
Et Crépin Crépinien ne reviendra jamais,De ce jour à la fin du monde, sans que soit évoquéNotre souvenir (…)
Ce que le personnage d’Henry V essaie de faire croire à ses soldats, c’est que, par leur sacrifice, ils vont également laisser quelque chose d’éternel après leur mort : le souvenir. Mais, comme nous l’avons vu, il s’agit ici d’une fausse éternité. La véritable éternité ne se trouve pas dans une gloire personnelle, mais dans ce qu’on laisse de bon aux générations futures. C’est pour cela que certains ont donné et risqué tout ce qu’ils avaient, y compris leur vie ; paradoxalement, c’est en donnant leur vie, qu’ils l’ont réellement gagnée. Quant aux malheureux qui ne donnent et ne risquent rien, ce qu’ils désirent, en réalité, c’est donc la mort.




 COMMENTAIRES
COMMENTAIRES