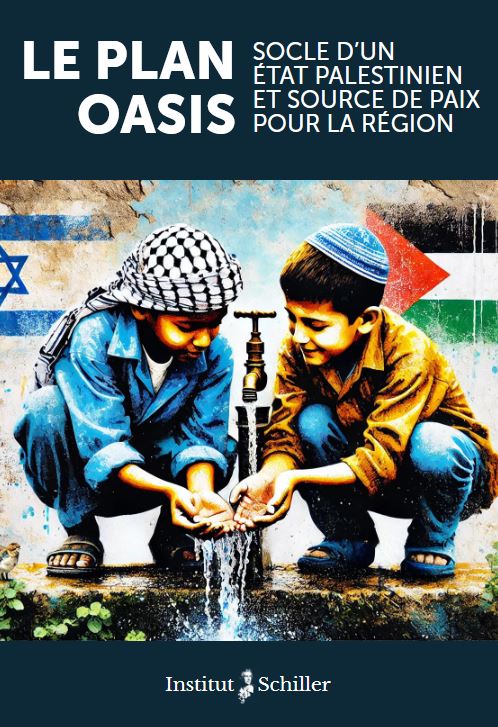Par Karel Vereycken
Le 22 septembre, par une déclaration d’Emmanuel Macron devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, la France, renouant avec sa position historique, a enfin reconnu l’État palestinien. Le temps est venu.
Le président français a resitué sa décision dans le cadre de la « déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États », véritable feuille de route détaillant en 42 points les étapes pour aboutir à une paix israélo-palestinienne durable, avec des annexes réunissant de nombreuses propositions concernant les mesures concrètes nécessaires à la reconstruction de Gaza (eau, énergie, enseignement, santé, sécurité, infrastructures, etc.) dans le cadre d’une paix régionale.
Il faut souligner que cette déclaration, rédigée à l’issue de la conférence qui s’est tenue du 28 au 30 juillet au siège des Nations unies à New York, n’émane pas seulement de ses deux coprésidents, la République française et le Royaume d’Arabie saoudite, mais également des coprésidents des huit groupes de travail :
• Brésil,
• Canada,
• Égypte,
• Espagne,
• Indonésie,
• Irlande,
• Italie,
• Japon,
• Jordanie,
• Mexique,
• Norvège,
• État du Qatar,
• Royaume-Uni,
• Sénégal,
• Turquie,
• Ligue arabe,
• Union européenne.
Adoptée à l’ONU
Le 12 septembre, la France a introduit la « déclaration de New York » pour un vote à l’Assemblée générale de l’ONU. Parmi les 193 membres que compte l’ONU, elle a été adoptée par 142 voix pour, 12 abstentions et 10 voix contre (Argentine, États-Unis, Hongrie, Israël, Micronésie, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay et Tonga).
Ainsi que l’a précisé le représentant de la France, qui présentait le texte, cette déclaration, élaborée après consultations avec tous les États participants, dresse une feuille de route unique pour matérialiser la solution à deux États, « et ce grâce à des engagements majeurs pris par l’Autorité palestinienne et les pays arabes pour la paix et la sécurité de tous dans la région ».
Cette feuille de route (dont on peut néanmoins regretter les manquements et lacunes) passe par un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération de tous les otages, l’établissement d’un État palestinien viable et souverain, le désarmement du Hamas et son exclusion de la gouvernance de Gaza, la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes et la mise en place de garanties de sécurité collectives intégrant Israël, a précisé le délégué français.
Le déroulement des événements
Pour comprendre la dynamique qui a engendré ce qui vient de se produire à l’ONU, voici une chronologie mettant en lumière la dynamique de la guerre et ceux qui tentent de la renverser.
2023 :
L’administration Biden tente de réussir là où « Trump I » avait échoué : convaincre l’ensemble des pays arabes de signer les « Accords d’Abraham », conclus en 2020 à la Maison-Blanche entre Israël, le Bahreïn et les Émirats arabes unis afin de normaliser leurs relations.
En échange d’une ratification de ces accords, Washington offrait à Riyad une grosse récompense : un traité de défense mutuelle entre l’Arabie saoudite et les États-Unis. Du fait que cela nécessitait une ratification du Sénat américain, cela aurait été plus facile sous Biden que sous Trump, faisait valoir Blinken à Mohammed Ben Salmane (MBS). Pour celui-ci, qui voudrait entrer dans l’histoire comme un dirigeant ayant sorti son pays du sous-développement, l’Arabie saoudite ne peut pas rester un simple champ pétrolier. Mieux encore, les États-Unis aideraient les Saoudiens à développer un programme nucléaire civil, en échange de quoi l’Arabie saoudite resterait attachée à la domination du dollar et aux intérêts américains dans la région.
—Le 7 octobre. L’opération « surprise » du Hamas, avec des centaines de civils tués et pris en otage, et la riposte sanguinaire qu’elle provoqua contre Gaza, anéantit toute perspective d’une généralisation des « Accords d’Abraham » — le but recherché selon certains analystes. Mais l’administration Biden persiste.
Comme l’écrit, le 25 septembre 2024 The Atlantic :
Le seul hic : l’impact de l’holocauste palestinien, transmis en direct par toutes les télévisions du monde, sur l’opinion publique, en particulier dans le monde arabo-musulman. Selon l’Atlantic, MBS a rapidement exigé des Américains qu’ils forcent les Israéliens à accepter la création d’un Etat palestinien.
MBS pensait qu’il pouvait finir comme l’ancien président égyptien Aouar el-Sadate, assassiné par les Frères musulmans, déterminés à liquider tout chef d’État arabe disposé à faire la paix avec Israël.
2024
—Janvier. Grâce à une médiation chinoise, l’Arabie saoudite, haut lieu de l’islam sunnite, normalise, par l’accord de Beijing, ses relations avec l’Iran chiite, posant les bases permettant d’en finir avec les manipulations géopolitiques destructrices.
—Janvier. L’Arabie saoudite annonce qu’elle rejoint le groupe des BRICS. Mais sous la pression de Washington, elle temporise et reste un pied dedans, un pied dehors. D’un côté, la Chine représente un client pétrolier incontournable et un acteur économique majeur dans la stratégie de diversification saoudienne, notamment via la Vision 2030. De l’autre, les États-Unis demeurent un allié clé sur le plan sécuritaire, technologique et diplomatique. Riyad est donc engagé dans un délicat numéro d’équilibriste, qui l’oblige à retarder son alignement formel avec les BRICS pour préserver ses intérêts stratégiques avec Washington.
—Le 17 septembre, les services israéliens, qui craignent une attaque à partir du Liban, tentent de neutraliser les responsables du Hezbollah au Liban et en Syrie en faisant exploser à distance leurs systèmes personnels de communication (« bipeurs » et talkies-walkies, tuant 42 personnes et en blessant près de 3500 autres).
—Le 20 septembre, La Cour internationale de justice (CIJ) a annoncé que le Brésil a rejoint l’action par laquelle l’Afrique du Sud accuse Israël de génocide à Gaza. Le Brésil s’est appuyé dans sa demande d’adhésion, présentée le 17 septembre courant, sur l’article 63 du Statut de la Cour.
–Le 26 septembre, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Bin Farhan, annonce la création d’une « alliance pour une solution à deux Etats », une initiative nouvelle visant à établir un Etat palestinien en réunissant des soutiens internationaux. MBS participe personnellement à une réunion des équipes diplomatiques en charge de l’initiative.
—Le 2 décembre. Macron est reçu à Riyad pour des discussions sur l’avenir du Liban et le conflit israélo-palestinien. Un accord de partenariat est signé. Selon Le Monde :
2025
—Avril. Emmanuel Macron annonce que la France pourrait reconnaître l’État palestinien en juin 2025, lors d’une conférence internationale coprésidé par l’Arabie saoudite.
—Juin. Avec le feu vert des Etats-Unis, Israël bombarde pendant 12 jours l’Iran, soupçonné de fabriquer la bombe atomique.
—Le 27 août, Donald Trump reçoit pendant une heure à la Maison Blanche Tony Blair dont l’Institut a élaboré le plan américain pour faire de Gaza une « nouvelle French Rivièra ».
— Le 28 août, une frappe israélienne sur Sanaa, au Yémen, provoque la mort de plusieurs hauts responsables houthis, dont le Premier ministre. L’armée israélienne affirme avoir ciblé « un site militaire du régime terroriste houthi », ajoutant que l’opération a été validée par le ministre de la Défense, le chef d’état-major et les principaux commandants de l’armée, en coordination avec Benjamin Netanyahou.
—Le 31 août a eu lieu le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin, près de Beijing. La création d’une plateforme permettant d’organiser les échanges des pays membres en devises nationales est annoncé. C’est une rupture avec la NBD des BRICS et la BIIA, dont la majorité des transactions se font toujours en dollars.
—Le 8 septembre, prenant la parole au Musée de la Bible, Donald Trump lance une vaste campagne de prières à l’occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance.
—Le 9 septembre, sans l’aval des Etats-Unis, Israël effectue des frappes sur Doha, capitale du Qatar. Les négociateurs du Hamas, qui y résident, en réchappent de justesse. Pour les analystes, Netanyahou, dans ses relations avec Trump, est passé de la culture de « la demande de permission » à celle du « pardon ». Furieux, Trump clame à ses conseillers que Netanyahou « se fout de sa gueule », mais il l’est encore plus lorsqu’il apprend que les frappes israéliennes ont raté leurs cibles, une victoire qu’il aurait pu inscrire à son propre crédit...
—Le 12 septembre, la « déclaration de New York » est adoptée par 140 voix aux Nations unies.
—Le 16 septembre, la Commission des droits de l’Homme des Nations unies conclut qu’on assiste bel et bien à un « génocide » à Gaza
—Le 17 septembre, l’Arabie saoudite et le Pakistan annoncent avoir signé un pacte d’assistance militaire. Toutes les armes du Pakistan, y compris ses 170 têtes nucléaires, pourront servir de riposte en cas d’agression. D’autres pays du Golfe envisagent de rejoindre cet accord.
—Le 17 septembre, la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne et vice-présidente de la Commission, Kaja Kallas, propose un ensemble de mesures, dont la plus importante est la suspension de la composante commerciale de l’accord d’association UE-Israël.?Le coût de cette mesure pour les exportateurs israéliens est estimé à 227 millions d’euros. Or, pour être mise en œuvre, cette sanction nécessite un vote à la majorité qualifiée des 27 États membres, ce qui sera difficile à obtenir. Le même jour, dans une tribune libre publiée dans Al Jazeera (absente de la presse française), 376 anciens ambassadeurs de l’UE et des Etats membres de l’UE demandent des sanctions beaucoup plus sévères (notamment sur les ventes d’armes et les accords financiers) et appellent tous les Etats membres de l’UE à reconnaître la Palestine.
—Le 18 septembre, l’ONU constate que le délai d’un an s’est écoulé sans qu’Israël ait appliqué les résolutions exigeant le retrait de Gaza et de la Cisjordanie.
—Le 19-20 et 21 septembre : emmenés par l’initiative franco-saoudienne, dix membres de l’ONU annoncent la reconnaissance de l’État palestinien : France, Belgique, Royaume-Uni, Canada, Australie, Monaco, Luxembourg, Portugal, Saint-Marin et Andorre, alors que, cédant aux menaces israéliennes et américaines, le Japon, la Nouvelle-Zélande et Singapour y renoncent temporairement.
Conclusion
La reconnaissance de la Palestine ne consiste pas simplement à reconnaître un Etat, mais aussi ses citoyens, leur droit à l’auto-détermination, à la vie et à la dignité. Les Etats « reconnaisseurs » se déclarent ainsi responsables pour les accompagner dans un avenir partagé, celui de la civilisation humaine. Sauront-ils à la hauteur de leurs engagements ?
De ce fait, les déclarations et le processus en cours aux Nations unies ont créé un « momentum », potentiellement le « punctum saliens » (dénouement) d’un drame qui n’a que trop duré. Oui, le temps est venu.
Dans les faits, la feuille de route que contient la « Déclaration de New York », adoptée par 140 pays membres de l’ONU, trace une ligne rouge en mettant chacun devant ses responsabilités existentielles :
En premier lieu Israël et son protecteur américain, tous deux sous l’emprise d’extrémistes messianiques. Accepteront-ils enfin la main tendue du reste de la planète ? Ou continueront-ils, au mépris de la majorité mondiale, à commettre un génocide pour faire triompher leur volonté de puissance dans une séquence que Pieter Thiel qualifierait de « moment straussien » ? Converti par René Girard, pour qui le prix à payer pour toute paix passe obligatoirement par le sacrifice d’un bouc émissaire, Thiel est le fondateur de Palantir, société qui est fière d’équiper les proxies de l’empire techno-fasciste de Silicon Valley et de la City, notamment Israël et l’Ukraine, avec les technologies digitales permettant d’exterminer ceux que leurs maîtres ont désignés comme les « boucs émissaires ».
A moins de faire le ménage au sommet, Israël et les Etats-Unis sombreront dans cette barbarie.
L’ONU elle-même pourrait disparaître. Depuis le sénateur Rand Paul, les appels dans le camp conservateur et libertarien continuent à s’amplifier pour exiger que les Etats-Unis quittent l’ONU, à qui certains Américains reprochent de se retourner contre eux et contre leurs intérêts. L’ONU, y compris l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial, sans parler même des missions de maintien de la paix, déjà privés du financement américain, risquent de ne plus pouvoir assumer leurs missions.
Ensuite, et mis peut-être encore davantage au pied du mur, les 140 pays signataires de la « déclaration de New York », qui stipule une série d’actions concrètes à prendre et entreprendre pour parvenir à une paix durable en Asie du Sud-Ouest. Sauront-ils ramener Israël, et surtout les Etats-Unis, à la raison ?
Espérons, et surtout faisons en sorte, que le temps soit venu.
Intervention de Jacques Cheminade sur le même thème :