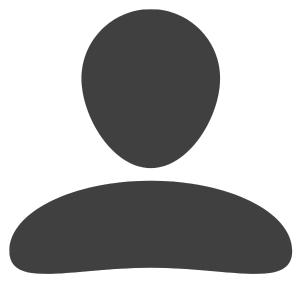[sommaire]

Il y a de constant dans les scandales financiers et les affaires d’Etat qui surgissent aujourd’hui, un dégoût prononcé de la vérité. Un Glass-Steagall global, c’est au contraire regarder en face l’escroquerie financière qu’est devenue notre économie. Les invocations à la régulation, à la moralisation et aux renflouements n’expriment, elles, que la résignation.
Pourtant la France fut bien dotée après-guerre : du combat contre le fascisme est né un système de crédit dirigé, dans lequel on ne cédait pas à la dictature de l’instant et de l’argent facile. Dès 1945, les banques ont été mises au service d’un avenir commun : c’était le Glass-Steagall français et son dispositif d’émission de crédit public. Face au péril, nous devons en raviver l’esprit.
Un Glass-Steagall, c’est quoi d’abord ?
Le Glass-Steagall fut l’un des instruments clés du dispositif de Franklin Roosevelt, qui permit de castrer légalement Wall Street et d’ouvrir la voie à une relance massive de l’économie physique américaine. Dès sa victoire présidentielle de novembre 1932, Franklin Roosevelt donna son appui à la Commission bancaire du Sénat pour faire juger Wall Street sur la place publique. En missionnant auprès de la commission le procureur de New-York Ferdinand Pecora, les représentants du peuple disposaient soudain des pouvoirs judiciaires nécessaires à une investigation méticuleuse. Les révélations furent stupéfiantes : les banques new-yorkaises s’étaient infiltrées au plus haut niveau de l’Etat, elles finançaient les régimes fascistes en Europe et leurs pratiques financières avaient délibérément provoqué le krach de 1929 et la misère et la faim qui s’abattaient sur le peuple américain. Ce fut un pari gagnant pour Roosevelt : en faisant connaître la vérité au peuple, il avait désormais la pleine légitimité pour remettre Wall Street à sa place. Promulguée le 16 juin 1933, la loi Glass-Steagall permit de briser les oligopoles bancaires et de dresser un coupe-feu entre activités de banque et spéculation. Elle établit une séparation stricte entre les banques d’affaires et les banques de dépôt.
Le Glass-Steagall français arrive en 1945
« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine » , le gouvernement provisoire avait les coudées franches pour mettre à bas la « dictature professionnelle » qui avait dominé l’économie, donc la politique française. Le 2 décembre 1945, la loi 45-15 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l’organisation du crédit, venait concrétiser les résolutions prises sous l’occupation par le Conseil national de la Résistance. [*]
Cette loi définit clairement « trois catégories de banques : les banques de dépôt, les banques d’affaires, les banques de crédit à long terme et à moyen terme » ; institue un Conseil national du Crédit, représentatif des forces vives de la nation, aux pouvoirs réglementaires et non simplement consultatifs ; établit un dispositif sérieux de « contrôle des banques d’affaires » en nommant pour chacune d’elles un commissaire du gouvernement, muni de pouvoirs d’investigation et chargé de veiller à la régularité de leurs opérations et à leur conformité avec « l’intérêt national ». Soyons clairs : ce Glass-Steagall français est à l’opposé de ce qu’on appelle aujourd’hui « régulation ». Il ne s’agit pas d’une simple surveillance a posteriori des organismes de crédit, comme il est d’usage aujourd’hui, mais d’une réglementation intégrale des activités bancaires afin que l’allocation du crédit privé s’adapte aux lignes fixées par le Plan.
Les pouvoirs magiques du Glass-Steagall
Pris comme une simple mesure technique, séparer les banques ne sert à rien. Si le dispositif créé par la loi du 2 décembre 1945 a pu engendrer les Trente Glorieuses, c’est qu’il a créé les conditions d’un véritable système de crédit productif, implicitement anti-monétariste. En nationalisant la Banque de France, le gouvernement a pu déclencher une politique de crédit public sans précédent, en utilisant pour l’équipement à long terme la capacité du Trésor public de présenter ses effets à l’escompte de la Banque de France à des taux préférentiels. Il s’agit pour le Trésor (au nom du gouvernement), dans le cadre de la planification et d’une politique cohérente de développement du territoire, d’obtenir en création monétaire auprès de la Banque de France, l’équivalent des richesses futures que créera l’utilisation de ce crédit. Pour la première fois dans notre histoire, l’Etat put devancer le développement économique, assurant ainsi un cycle long de croissance physique.
D’ailleurs, nous devons bien avoir conscience que ce mécanisme vertueux ne pouvait avoir lieu que dans le cadre du système de taux de change fixe établi à la conférence de Bretton Woods, en juillet 1944. Des taux de changes flottant au bon gré des spéculateurs ne permettent pas de politique d’investissement à long terme. Le Glass-Steagall global de demain ne peut qu’aller de pair avec un nouveau Bretton Woods protégeant les systèmes de crédit au sein de chaque économie nationale.
L’esbroufe de la banque « universelle »
Aux Etats-Unis, la loi Glass-Steagall fut abrogée en 1999, par l’entremise du secrétaire au Trésor de l’époque Larry Summers (aujourd’hui conseiller économique en chef de Barack Obama), avec les conséquences que l’on connaît. La France, quant à elle, avait déréglementé bien plus tôt. C’est sous l’égide de Jacques Delors, ministre de l’Economie et des Finances de François Mitterrand, que la loi bancaire 84-46 du 24 janvier 1984 (dite de « modernisation » !) abrogea la loi du 2 décembre 1945. Elle fit disparaître la distinction fondamentale des activités bancaires sous un titre unique, les « établissements de crédit » , les libérant ainsi de toute contrainte sur l’origine et l’investissement de leurs ressources. C’est ce qu’ils nomment fièrement « banque universelle » . A la tribune de l’Assemblée nationale, Delors avait prétexté la nécessité de s’adapter à l’environnement international pour justifier la création d’une véritable « communauté bancaire » au nom de « la liberté d’association » (sic) . La séparation « entrave le développement d’une saine concurrence » , disait-il. On a vu le résultat : aujourd’hui, la banque française est devenue un véritable oligopole contrôlé par les « quatre gros » (ils ont tout avalé) : BNP-Paribas, Société générale, Crédit agricole et Caisse d’épargne-Banque populaire.
Investigation et mise en règlement judiciaire
Le premier scandale de la banque universelle fut probablement l’affaire du Crédit lyonnais. Ses activités financières hasardeuses entre 1988 et 1993 la menèrent à une faillite retentissante qui aurait vu disparaître les dépôts des épargnants si l’Etat n’avait injecté 130 milliards de francs (20 milliards d’euros). L’obsession financière et anti-économique de la banque universelle s’est encore affichée au grand jour depuis deux ans : des dizaines de milliards d’euros d’actifs dépréciés avec la crise des subprimes, le vacillement de la SG après l’affaire Kerviel (5,5 milliards de perte sèche), la très « familiale » Caisse d’épargne qui perd 700 millions sur des paris spéculatifs, etc. Nos prestigieuses banques « universelles » ne doivent leur salut qu’à l’aide accordée en 2008 par l’Elysée, au recyclage des actifs toxiques organisé par la BCE, au contribuable américain (elles ont touché 25 milliards dans le renflouement d’AIG organisé par Goldman Sachs) et à une comptabilité probablement très créative. Aujourd’hui encore, le mystère demeure sur l’état réel de leurs comptes. En février, Société générale a évacué vers une structure de défaisance (fosse septique) près de 45 milliards d’euros de titres toxiques.
Les partisans de la « régulation » n’ont plus le choix. Nous devons mobiliser l’opinion en constituant une commission d’enquête parlementaire sur la crise financière, dotée de pouvoirs judiciaires. L’on pourra réquisitionner temporairement les banques pour aller librement éplucher leurs comptes et leur bilan. Fort des vérités qui auront été dites, il faudra profiter de l’élan pour rétablir un système de crédit productif, seul capable de servir le travail et l’équipement du territoire. Sans cela, les niveaux de vie continueront de baisser, durement et sûrement, et nous n’aurons plus qu’à planter des bananiers sur ce qui a failli être une république.
Les principes oubliés de l’antifascisme économique

Les femmes et les hommes du monde qui ont combattu et vaincu le fascisme dans les heures les plus sombres de notre histoire, ont non seulement compris qu’il trouve toujours son origine dans le corporatisme financier, mais que pour s’assurer qu’il ne ressurgisse jamais, la dignité et le travail humain doivent être le motif directeur de toute politique économique.
En mars 1944, notre Conseil national de la Résistance (CNR) affirmait le « droit au travail » et à un salaire qui « assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie pleinement humaine » ; « un plan complet de sécurité sociale » ; « une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours » . Ces principes se retrouvent institutionnalisés dans le Préambule de 1946, repris aujourd’hui dans notre Constitution en vigueur.
Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, Franklin Roosevelt avoue à son peuple, le 11 janvier 1944, que « la recherche du bonheur » , clé de voûte de la Constitution américaine, n’est plus rien s’ils n’adoptent pas une « deuxième déclaration des droits » fondamentaux garantissant « le droit à un travail utile et rémunérateur », « le droit à des soins médicaux adéquats et la possibilité de jouir d’une bonne santé », « le droit à une protection adéquate contre les incertitudes économiques de l’âge, de la maladie, des accidents et du chômage » et « le droit à l’éducation ».
Réunis le 10 mai 1944, la Conférence internationale du travail adopte sa « déclaration de Philadelphie », refondant l’Organisation internationale du travail et s’adressant « à tous les humains ». Elle affirme : « Le travail n’est pas une marchandise », « la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous », « une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale », « tous les êtres humains (…) ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales » ; cela « doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale ». On retrouve aussi dans cette déclaration tous les droits sociaux proclamés par le CNR et Roosevelt sur la santé, l’éducation, les loisirs, la sécurité sociale et bien sûr le travail. Et il y a là une source d’inspiration profonde pour nous aujourd’hui : il faut assurer « l’emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun ».
Mais l’avertissement le plus cinglant pour la France d’aujourd’hui est délivré par le CNR qui veut « la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui ont les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires ».
Lire la suite de cet article :
Le Glass-Steagall global et le précédent français (suite)
Donner une mission à l’économie
Lire aussi :
- La loi Glass-Steagall : comment FDR remit les banquiers à leur place
- Franklin Delano Roosevelt, ou comment gagner la bataille contre Wall Street et l’impérialisme britannique
- L’indispensable Commission Pecora (vidéo)
 COMMENTAIRES
COMMENTAIRES