[sommaire]
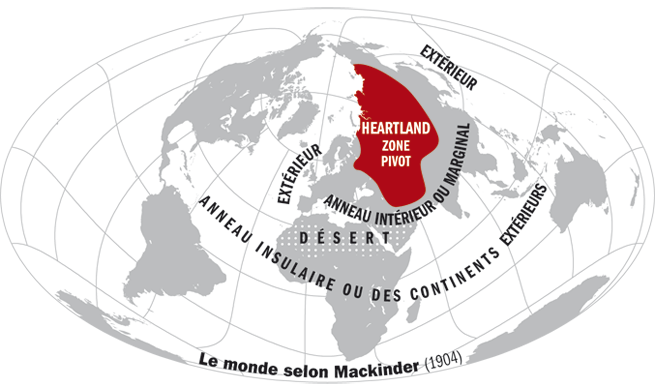
Par Michael Liebig, mars 1992.
Dans les jours qui ont suivi la chute du mur de Berlin, la mauvaise humeur du président américain George Bush était si évidente que les journalistes de la Maison Blanche le lui ont fait remarquer. Le président a répondu, à propos de l’ouverture des frontières, qu’il n’aimait pas verser dans « l’émotion » et qu’il n’irait pas « danser sur le mur ».
George Bush s’inquiétait pour deux raisons. D’une part, la chute du mur et la réunification prévisible de l’Allemagne signifiaient la fin du système de Yalta. D’autre part, le conflit Est-Ouest, qui avait dissimulé les fondements géopolitiques du système de Yalta derrière la lutte entre le communisme et le « monde libre », tirait à sa fin.
A la fin de 1989, la classe politique à Washington, Londres, Paris et Moscou avait bien compris que les changements en Europe de l’Est étaient devenus irréversibles. Dès le sommet de Malte de décembre 89 et au gré des discussions entre chefs d’Etat, les quatre puissances victorieuses ont cherché à établir de nouveaux principes géopolitiques en Europe, sur les cendres du conflit Est-Ouest.
Les axiomes de la géopolitique
Mais qu’entend-on par « géopolitique » ? Considérant les événements historiques et les relations entre Etats, la géopolitique donne la priorité aux « facteurs objectifs », comme l’« espace » et les « masses », en opposition aux facteurs « subjectifs » comme le développement culturel et technique. On compte parmi les principaux fondateurs de la géopolitique :
- Friedrich Ratzel (1844-1904), dont le livre La géographie politique (1897) passe pour donner les fondements théoriques généraux de la géopolitique ;
- L’amiral américain Alfred T. Mahan, auteur du livre L’influence de la puissance maritime sur l’histoire (1890), qui a fait des « espaces océaniques » et du rôle des « puissances maritimes » les notions centrales de la géopolitique ;
- Sir Halford J. Mackinder (1861-1947), qui est le véritable fondateur de la géopolitique opérationnelle. Pour lui, le conflit géopolitique central se résume à l’opposition d’intérêts entre le « centre continental eurasiatique » et les « îles à la périphérie », à savoir les puissances maritimes anglo-américaines ;
- Karl Haushofer (1869-1946), pour qui l’avancée ou la chute des Etats et des peuples se manifestent dans l’expansion ou, au contraire, la contraction des espaces qu’ils dominent. Haushofer eut une forte influence sur le national-socialisme et aussi sur la géopolitique soviétique.

La géopolitique postule que les conditions géographiques, climatiques et démographiques déterminent en premier lieu le cours de l’histoire. Mackinder dit que la tâche de la géopolitique est « de comprendre l’interaction entre l’homme et l’environnement. (...) L’homme est avant tout le produit de son environnement géographique. (...) Nous cherchons une formule qui permette d’exprimer certains aspects de la causalité géographique de l’histoire universelle . »
La géopolitique repose sur la prémisse réductrice selon laquelle la géographie, ou la surface de terre disponible, sont inchangeables tandis que les masses d’hommes sont dynamiques. En raison des limites objectives de l’espace géographique, les luttes de pouvoir et de domination entre peuples et Etats sont inévitables. La possession du sol et de ses ressources doit faire l’objet de combats politiques et militaires entre peuples concurrents. Pour citer Friedrich Ratzel : « Pour l’homme et son histoire, la superficie des terres est inchangeable. Le nombre d’hommes augmente, le sol sur lequel ils vivent et agissent reste toujours le même ». Le sol est « le seul facteur de cohésion matériel, pour chaque peuple. (...) Au fil de l’histoire, l’épanouissement progressif des pouvoirs spirituels n’a pas affaibli ce lien, qui s’accroît en même temps que le nombre d’hommes. (...) Les grands espaces assurent à leurs [habitants] la protection inhérente aux grandes distances. (...) C’est pourquoi nous voyons, dans la compétition entre les peuples forts et faibles, que les faibles s’effacent plus vite dans des espaces étroits »
La doctrine de la géopolitique tient ses axiomes idéologiques de la théorie des physiocrates du XVIIe siècle, qui voyaient dans la valeur inorganique et organique du sol la seule source de richesse économique. Plus tard, la géopolitique s’appuiera sur les prémisses - économiquement injustifiées - que Thomas Malthus développe dans son œuvre On Population, où il est question d’une contradiction soit-disant insurmontable entre la croissance démographique et la production de nourriture, contradiction qui mène logiquement à la « nécessité » de réduire la population.
On retrouve ce courant de pensée défendu en Angleterre dans la deuxième moitié du XIXe siècle : seuls les plus « forts » survivront dans la lutte pour le sol et ses richesses naturelles, affirment alors ceux qui se réclament du « darwinisme social ».
La civilisation judéo-chrétienne s’est bâtie autour de conceptions qui sont à l’opposé de la doctrine géopolitique, dont les postulats sont économiquement indéfendables et moralement inacceptables.
Le nazisme étant la négation par excellence de la culture judéo-chrétienne, il n’est pas étonnant que Hitler fut aussi un grand admirateur de la géopolitique de Ratzel, Mackinder et Haushofer. Il étudia l’oeuvre principale de Ratzel peu avant d’écrire Mein Kampf. Karl Haushofer était membre de la « Société de Thulé » de Munich, l’organisation embryon du national-socialisme, au début des années 20. Le nazisme a incorporé dans ses axiomes les notions géopolitiques de « Iutte pour l’espace vital » et d’attachement « au sol et au sang ». Parallèlement, dans les années 20 et 30, Karl Haushofer avait une influence importante dans le Komintern et parmi les intellectuels communistes « politisés » en Union soviétique. Mentionnons simplement les relations étroites qu’il entretenait avec Richard Sorge, qui était à l’époque l’un des dirigeants du renseignement soviétique.
Il n’est évidemment pas question de confondre les axiomes idéologiques de la géopolitique avec les catégories économiques réelles de la géographie politique. Il va sans dire que toute analyse ou planning stratégique doit tenir compte de notions comme la position géographique, l’espace, les frontières, la constitution du sol, les voies de transports naturelles, la densité de population, les pays voisins, etc.
Mackinder, le père de la géopolitique
En suivant l’itinéraire d’Halford Mackinder, on peut suivre très précisément la mise en oeuvre opérationnelle des concepts géopolitiques dans la politique étrangère de l’Angleterre, dès la fin du XIXème siècle. Les dirigeants britanniques reconnaissaient alors que la puissance économique, scientifique, et aussi militaire de leur empire s’affaiblissait par rapport à celle des Etats-Unis, d’une part, et celle de l’Europe continentale (Allemagne, Russie, France) d’autre part. L’oligarchie britannique décida en conséquence d’élaborer un nouvel impérialisme autour d’un groupe constitué entre autres de Cecil Rhodes, lord Milner, lord Grey et lord Rothschild. Baptisé le « kindergarden » (jardin d’enfant) de Milner, le groupe comptait également dans ses rangs Halford Mackinder.
A l’époque les dirigeants britanniques savaient, après les défaites de 1783 et de 1814, qu’une troisième guerre contre les Etats-Unis, dont la population et la puissance économique et militaire s’étaient considérablement accrues, était exclue. La puissance de la marine américaine était à elle seule suffisamment dissuasive.
Incapable de vaincre militairement les Etats-Unis, la Grande Bretagne a tenté alors de les convaincre de devenir les partenaires et, en fin de compte, les alliés de l’empire britannique. Elle utilisa, pour ce faire, des arguments géopolitiques.
Reprenant les théories de l’amiral Mahan, Mackinder affirmait que les intérêts géopolitiques fondamentaux des deux puissances maritimes (Etats-Unis et Angleterre) se confondaient. Du fait même de la géographie, d’après Mackinder, la « périphérie d’îles et de continents extérieurs » s’oppose a priori aux terres « centrales » eurasiatiques.
Si un Etat ou une alliance d’Etats devait réussir à imposer son hégémonie sur le continént eurasiatique, cela constituerait une menace mortelle pour les puissances maritimes des « îles ». Toujours selon Mackinder, la Grande Bretagne et les Etats-Unis devaient donc rejoindre leurs forces pour empêcher la consolidation d’une hégémonie quelconque sur le continent.
La politique britannique envers les grandes puissances eurasiatiques - Russie, Allemagne, France - sera par conséquent guidée par le « rapport de forces » au sein du « concert européen ». Depuis le XVIIème siècle, la Grande Bretagne avait pris l’habitude de s’allier - par entente publique ou secrète - avec la deuxième ou troisième puissance du continent, pour s’opposer à la première. Dans la logique du rapport de forces, la puissance dominante ne peut maintenir sa position que si les puissances secondaires sont maintenues dans un état perpétuel de concurrence politique ou militaire. Autrement dit, le plus fort exerce vis-à-vis des autres le principe de « diviser pour régner ».
Après 1871, la France avait cédé à l’Allemagne la première place sur le continent. Par là même, pour la diplomatie britannique, l’Allemagne devenait - automatiquement pourrait-on dire l’ennemi numéro un. En même temps, la diplomatie britannique se trouvait confrontée à un nouveau défi : les progrès fulgurants de l’ensemble du continent dans les domaines industriels et techniques, notamment dans les transports. Le risque était que les trois grandes puissances continentales, mettant une sourdine à leurs rivalités habituelles, œuvrent en faveur d’une coopération économique mutuelle.
La mise en place d’un réseau ferré ouvrait de nouvelles perspectives d’échanges commerciaux dans tous les pays, mais plus important encore, la construction d’une ligne transsibérienne et de la ligne Berlin-Bagdad risquaient de concurrencer la domination britannique des mers. Le chemin de fer transcontinental menaçait l’empire britannique bien plus que la flotte allemande.
Du coup, la diplomatie britannique d’avant la Première guerre mondiale eut pour objectif essentiel d’empêcher par tous les moyens une entente continentale entre la France, l’Allemagne et la Russie. Mackinder allait élaborer les catégories géopolitiques appropriées pour exprimer cet objectif ; l’espace eurasiatique fut divisé entre le « cœur « (Heartland) ou le centre - la Russie -, et une « zone périphérique » ouest et centre-europeenne (Rimland) longeant la Méditerranée jusqu’au Proche-Orient. Cette deuxième zone incluait les Balkans, une région qui, dans les décennies précédant la Première guerre mondiale, était source des tensions les plus fréquentes entre l’Allemagne, la Russie et la France. Une région par conséquent propice à l’activation d’un conflit tel que celui de la Première guerre mondiale, qui ravagea les trois grandes puissances du continent...
Le système de Versailles
Une fois l’Allemagne défaite en 1918, la Grande Bretagne avait atteint son objectif : un « nouvel équilibre » s’était créé entre les puissances du Continent ; mais les visées géopolitiques de la Grande Bretagne transparaissaient dans le système mis en place lors du Traité de Versailles :
- L’Allemagne était détruite sur les plans politique et économique, isolée et paralysée sur le plan extérieur ;
- La France était foncièrement opposée à l’Allemagne. Epuisée, elle suivait la volonté britannique dans les négociations ;
- La Russie était économiquement hors jeu, mais politiquement imprévisible, du fait de la dictature bolchevique.
Fidèle aux postulats géopolitiques, la diplomatie britannique s’efforcera par la suite d’assurer la division du continent en créant un « cordon sanitaire » autour de l’Europe de l’Est, de l’Europe centrale et du Sud-Est. Il s’agissait moins de limiter le droit à l’auto-détermination des peuples de la région que de séparer l’Allemagne du « coeur » russo-soviétique.
Économiquement et politiquement, le système de Versailles ne pouvait cependant pas tenir. De fait il s’effondrera dans la période 1929-33. L’Allemagne nazie développe alors son potentiel économique et militaire et la Russie stalinienne redevient une grande puissance impériale. A partir de 1938, la diplomatie britannique cherche à nouveau à rétablir sa domination en poussant les deux pays l’un contre l’autre, espérant les amener à se livrer à une guerre meurtrière prolongée. La géopolitique nazie, d’une part, fondée sur la conquête d’« espace vital » à l’Est, et l’expansionnisme de l’empire soviétique, de l’autre, rentrent parfaitement dans le cadre des objectifs britanniques.
Le système de Yalta
Après la défaite de la France en 1940, Churchill fait en sorte que l’alliance des puissances maritimes (Etats-Unis et Angleterre) se concentre prioritairement sur l’écrasement de l’Allemagne. Si l’Allemagne est totalement vaincue en 1945, la victoire est essentiellement russo-américaine. La Grande Bretagne joue désormais un rôle secondaire, elle n’est pas en mesure de maintenir son empire uni, n’a plus la force d’imposer l’équilibre des pouvoirs, et ne peut donc plus diriger le « concert européen » en solo ; elle compte néanmoins persuader les dirigeants américains d’incorporer les prémisses géopolitiques du système de Versailles dans le nouvel ordre de l’après-guerre, le système de Yalta. L’espace européen, ainsi que le territoire allemand, seront brutalement divisés par un « rideau de fer ». Le centre (le « coeur ») revient à l’empire russo-soviétique tandis que la « zone périphérique » ouest- et centre-europé-Unis, l’Angleterre maintiendra une certaine influence sur le destin de l’Europe. Encore aujourd’hui, l’Establishment diplomatique américain, de George Kennan à George Bush, en passant par Henry Kissinger, pense selon les catégories de Mackinder.
Les conceptions géopolitiques russo-soviétique n’étaient pas incompatibles avec cette nouvelle vision. Même au moment des épreuves de force les plus dramatiques de l’après-guerre, les règles de jeu de Yalta ont tenu.
L’analyste politique Peter Gladkov de l’Institut des études USA-Canada disait avec raison que « l’honnêteté élémentaire veut que les deux puissances (USA et URSS) reconnaissent le fait qu’elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir une Europe, ainsi qu’une Allemagne, divisée et dépendante ».
L’ambigüité de l’OTAN
La division de l’Europe et l’émergence des deux superpuissances dans le cadre de Yalta ont assuré la faiblesse des pays européens. L’Allemagne fut presque totalement mise à l’écart de 1945 à 1958 tandis que la puissance de la France diminuait constamment. Ceci allait changer sous de Gaulle, qui comprenait mieux que tous les autres dirigeants politiques, que l’OTAN était conçue dès le départ comme le cadre stratégique par lequel imposer à l’Europe de l’Ouest l’hégémonie anglo-américaine.
Il retirera la France de l’organisation militaire intégrée en 1966 - non pas de l’alliance - lorsque les Etats-Unis lui refuseront sa juste part de responsabilité. Si l’OTAN représente d’une part l’institutionnalisation de la domination anglo-américaine dans les « zones périphériques », elle joue incontestablement en même temps un rôle d’endiguement et de dissuasion vis-à-vis de l’empire soviétique. Pour cette raison, on ne peut pas mettre sur le même plan la position hégémonique des Etats-Unis au sein de l’OTAN et celle de l’Union soviétique vis-à-vis des pays satellites. L’empire russo-soviétique imposera par la force et, le cas échéant, par l’agression, sa domination.
Il va sans dire que l’Union soviétique et les pays occidentaux ont constamment essayé - que ce soit pendant la « guerre froide » ou pendant la « détente » - de modifier à leur propre avantage le rapport des forces en Europe. Mais en fin de compte, Moscou s’est montrée plutôt prudente et réservée à l’égard des pays membres de l’OTAN.
Un des principaux objectifs stratégiques de l’Alliance atlantique était de contrôler l’Allemagne. En 1955, l’Allemagne s’était vu accorder une souveraineté relative à condition qu’elle rejoigne l’OTAN.
Rappelons la célèbre phrase du premier secrétaire général de l’Alliance, lord Ismay, qui déclarait sans ambages que la mission de l’OTAN était de « maintenir les Russes en dehors, les Américains au dedans, et les Allemands à genoux ».
Paradoxalement, Mikhail Gorbatchev a confirmé ce rôle de l’OTAN en juillet 1990, en acceptant que l’Allemagne unifiée rejoigne l’alliance, car le dirigeant soviétique considérait cette adhésion non pas comme une menace pour l’union soviétique mais plutôt comme une assurance contre la montée en puissance de l’Allemagne.
L’affirmation politique de la France à partir de de Gaulle, le renforcement économique et aussi politique de l’Allemagne depuis Adenauer et la croissance du poids de la Communauté européenne n’ont pas fondamentalement changé les structures géopolitiques en Europe. Le système de Yalta est resté intact. Depuis que l’élite anglo-américaine s’est aperçue dans le milieu des années 80 que la crise économique et politique en Union soviétique risquait de bouleverser le statut quo dans toute l’Europe, elle a cherché à modifier le système de Yalta - non pas à y renoncer mais à en changer simplement la forme.
Au plus tard en 1985, on discutait à Moscou et Washington des moyens d’« assouplir » la division de l’Allemagne, tout en la maintenant. On parlait de « désarmer » l’OTAN et le Pacte de Varsovie, sans mettre en question leur existence. On prévoyait, dans le cadre de la CSCE, le rapprochement politique des deux parties de l’Europe, mais seulement de façon progressive et strictement contrôlée par les deux superpuissances.
La Grande Bretagne n’était pas contre une modification du système de Yalta, à condition que ses structures fondamentales restent en place. La position de la France et de François Mitterrand était analogue. Le sommet Bush-Gorbatchev de décembre 1989 à Malte fut en quelque sorte la dernière tentative pour sauver le système de Yalta. Les changements révolutionnaires qui ont eu lieu de 1989 à 1991 en Europe de l’Est ont réduit à néant les plans de l’élite dirigeante à Londres, à Paris, et à Washington, comme ceux de la nomenklatura à Moscou. Il n’était plus possible de « modifier » le système de Yalta. Mais cela ne signifiait pas pour autant l’abandon de la géopolitique en Europe. Tout au contraire.
La géopolitique depuis 1989
La fin de la division de l’Europe et de l’Allemagne ouvrait la perspective d’une vaste coopération entre les économies dévastées d’Europe de l’Est et celles d’Europe occidentale et centrale. En termes géopolitiques classiques, le « coeur » continental pouvait joindre ses forces à la « zone périphérique » et réussir relativement vite et bien la reconstruction de l’Est. Dans cette perspective, Lyndon LaRouche proposait de créer un vaste réseau intégré d’infrastructures en Europe.
Dans la matrice géopolitique, une telle perspective était synonyme de cauchemar ; la reconstruction de l’Est menaçait d’affaiblir les puissances maritimes. Suivant les mêmes prémisses absurdes, il fallait empêcher la France, l’Allemagne et les pays successeurs de l’Union soviétique de se lancer dans un développement économique commun. Un grand espace de développement donnerait à l’Europe, pensait-on, un trop grand poids économique, au détriment des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, comme si les Etats-Unis ne pouvaient pas prendre part à la reconstruction eurasiatique et en tirer des bénéfices pour leur propre économie !
A Londres, Mme Thatcher, Douglas Hurd, Allan Clark, lord Ridley et Connor Cruise O’Brien ont décidé de revenir aux conceptions de Mackinder, datant d’avant 1914. Réaction similaire à New York et à Washington. La politique étrangère anglo-américaine s’est ainsi basée, de 1989 à 1992, sur la négation et l’obstruction de la reconstruction européenne.
Géopolitique contre stratégie
Avant d’exposer les grandes lignes de la géopolitique anglo-américaine telle qu’elle se présente depuis 1989, esquissons en contraste ce que serait une stratégie raisonnable, conforme à l’ordre naturel des choses. Ce faisant, l’irrationalité des postulats de la géopolitique apparaîtra encore plus clairement.
A la différence de la géopolitique, la stratégie se fonde sur une évaluation qui tient compte des facteurs culturels, politiques, sociaux, techniques, économiques, et ensuite seulement des facteurs politiques et géographiques. De là, la stratégie définit les objectifs d’un Etat ou d’une alliance d’Etats en prenant pour référence le développement optimal de ses potentiels intellectuels et matériels.
Enfin, la stratégie établit les moyens avec lesquels elle se réalisera. La stratégie commence donc par un « état des lieux », pour définir ensuite des objectifs, et un plan. Cette notion de stratégie a été élaborée du point de vue de ce que nous appellerons ici la loi naturelle, par Lyndon LaRouche. Les objectifs de toute stratégie efficace et stable dans le temps doivent, selon LaRouche :
- s’inspirer de la conception chrétienne de l’homme à l’image de Dieu, qui considère l’homme comme « co-créateur » avec Dieu, et contribuant à poursuivre le processus de la Création. Dans cet esprit, la société et l’Etat sont responsables du développement intellectuel et matériel de ses membres ;
- favoriser le progrès scientifique et technique qui est la condition préalable de l’augmentation de la densité démographique potentielle par unit& de surface, et qui permet de définir constamment de nouvelles ressources et d’assurer par la progression constante du niveau de vie - intellectuelle et matérielle - le développement continu de la science et de la technique ;
- respecter le principe d’une communauté de principe , entre nations, régie en conformité avec la loi naturelle ;
- défendre les principes de gouvernement républicain et de souveraineté nationale.
En développant la notion de communauté de principe, LaRouche reprend et développe, pour les relations internationales, les conceptions de Leibniz concernant la loi naturelle. S’opposant à Thomas Hobbes, pour qui les relations « naturelles » entre les individus se résument au « chacun pour soi », Leibniz affirme que l’intérêt primordial de chaque Etat est de voir les autres Etats se développer au maximum. Chaque Etat doit oeuvrer de son côté au développement maximal des potentiels intellectuels et matériels de sa propre population, de façon à pouvoir ensuite former, avec d’autres Etats ayant eu le même privilège, une communauté de principe fondée sur un développement mutuel. La géopolitique se caractérise en grande partie par le rejet de la notion de développement mutuel.
Le « Quatrième Reich »
Après la chute du mur de Berlin, une campagne de presse a été lancée en Grande Bretagne, aux Etats-Unis et en France. Elle tournait autour de quatre thèmes récurrents :
- La réunification allemande va mener à l’émergence d’un « Quatrième Reich », qui dorninera toute l’Europe d’abord sur le plan économique, puis politique et militaire ;
- L’Allemagne unifiée va détruire l’équilibre des pouvoirs en Europe, provoquant par là de nouveaux conflits et tensions, comme avant la Première guerre mondiale ;
- Entre l’Allemagne et l’Union soviétique en pleine crise, un nouveau pacte de « Rapallo » anti-occidental va être conclu ;
- Le nationalisme « pan-germanique », le racisme et, ensuite l’expansionnisme vont se répandre comme un feu de brousse dans l’Allemagne unifiée.
Cette campagne menée par des journaux « sérieux » en Angleterre, en France et aux Etats-Unis a coïncidé avec une diplomatie hyperactive qui a abouti, entre la fin de 1989 et le milieu de 1990, à un endiguement géopolitique de l’Allemagne et de la Russie.
Dix-neuf jours après la chute du mur, le chef de la Deutsche Bank Alfred Herrhausen fut abattu par de prétendus terroristes qu’on n’a jamais retrouvés. Herrhausen, qui jouissait d’une grande influence et d’un pouvoir économique important, défendait une stratégie de coopération étroite entre l’Est et l’Ouest pour la reconstruction des infrastructures et des économies à l’Est.
Il s’était prononcé contre la politique monétariste du Fonds monétaire international en Europe de l’Est et en Union soviétique. Le « message » que son assassinat a livré au monde correspondait aux objectifs de la stratégie d’endiguement géopolitique anglo-américaine : éviter la création d’un espace économique « de l’Atlantique à I’OuraI ».
Après la mort de Herrhausen, les dirigeants politiques et économiques de Bonn ont effectivement laissé au FMI le soin de déterminer les réformes économiques à l’Est.
La « thérapie de choc » administrée depuis lors en Europe de l’Est et dans l’ancienne Union soviétique a fini par achever l’économie réelle, les infrastructures, et par provoquer une hyperinflation et une misère de masse. Pour appliquer la thérapie de choc, on s’est appuyé sur des éléments influents de la nomenklatura soviétique. Les capacités économiques en Europe de l’Est, déjà saignées à blanc sous le communisme, ont encore chuté d’au moins 50 % depuis la fin des années 80.
Le consensus répandu au sein de l’Estabilshment anglo-américain, veut que les Etats-Unis et la Grande Bretagne se concentrent d’ici la fin du siècle sur la réduction de l’endettement public et privé. Pendant cette longue période de « consolidation » de la dette, il n’y aura pas de reprise de l’économie réelle. En effet, une reprise ne pourrait réussir que si l’immense dette était gelée pour permettre aux Etats d’émettre des crédits productifs pour l’infrastructure, l’industrie et la formation des travailleurs.
En l’absence d’une telle perspective, la logique veut que si les puissances anglo-américaines se privent de développement économique pendant cette période, tous les autres pays doivent faire de même. C’est pourquoi toutes les tentatives de lancer une reconstruction à l’échelle de l’Europe ont été torpillées. Les effets catastrophiques de la thérapie de choc ne sont pas le résultat d’une erreur de jugement ou de calcul. Ils ont été voulus. L’intention était de maintenir la Russie, l’Ukraine, et les autres pays d’Europe de l’Est dans une position permanente de faiblesse.
La situation à l’Est fait que la sécurité en Europe de l’Ouest est également menacée. Le déclin économique, social et culturel mène forcément à la « poursuite de la politique par d’autres moyens », à savoir les conflits, les guerres civiles, et les migrations de masse. Cette situation renforce à son tour la dépendance militaire de l’Europe, notamment vis-à-vis de la super-puissance nucléaire américaine.
La guerre des Balkans
Considérons maintenant brièvement « Ie » grand exploit stratégique de George Bush après 1989. Entre l’été 1990 et le printemps 1991, les ressources économiques et politiques de l’Europe ont été détournées de leur destination urgente en Europe de l’Est et absorbées par la Guerre du Golfe. Le gouvernement Bush, qui avait soutenu pendant des années le régime de Saddam Hussein, a tendu un piège dans lequel le président irakien est tombé pieds et poings liés, en envahissant le Koweit. Le 4 août 1990, l’International Herald Tribun publiait un éditorial intitulé « Mise en garde à l’Europe" : « Pour l’Europe, l’invasion du Koweit est un choc. ( ... ) Si l’Europe pensait pouvoir suivre sa propre voie vers un avenir sans souci, le 2 août 1991 lui a brutalement rappelé la réalité . »
Quatre mois après la fin de la guerre du Golfe, la guerre des Balkans a éclaté. Evidemment, les causes de la guerre dans l’ancienne Yougoslavie sont aussi intérieures et relèvent de conflits historiques. Mais ce n’est qu’une partie de la vérité. Depuis la fin du XIXème siècle, la Serbie a été « poussée » par la France, la Grande Bretagne et la Russie comme contre-poids géopolitique à l’Allemagne et à la monarchie habsbourgeoise.
La domination brutale des Serbes sur les autres peuples slaves du Sud a été promue après 1918 précisément dans ce but. L’attitude des gouvernements britannique, français et russe aujourd’hui se situe dans le droit fil de cette pensée. Le ministre soviétique de la Défense d’alors, Dimitri lasov, le secrétaire d’Etat américainjames Baker, et les gouvernements de Margaret Thatcher et de François Mitterrand ont encouragé les dirigeants serbes à s’opposer militairement à l’indépendance de la Slovénie et de la Croatie.
Au printemps 1992, le même feu vert a été donné pour la conquête de la Bosnie. Depuis deux ans, les négociations internationales sans fin (sous Carrington, ou Vance et Owen) ont permis à la Serbie de poursuivre et d’élargir sa guerre d’agression. Devant le génocide, les crimes de guerre et les pires vagues de réfugiés depuis la Deuxième guerre mondiale, l’Europe est restée paralysée.
La guerre dans l’ancienne Yougoslavie illustre les conséquences de la doctrine géopolitique. Outre les Balkans, un dangereux arc de crises eurasiatiques se dessine partant de la Baltique, traversant la Moldavie et le Caucase, et aboutissant dans les républiques d’Asie centrale de l’ancienne URSS. Dans l’ensemble de l’ex-territoire soviétique, un processus de « weimarisation » avance à pas de géant.
On peut affirmer sans beaucoup se tromper que si les préceptes géopolitiques suivis par Londres et Washington depuis 1989 continuent à être suivis, l’Europe connaitra en cette fin du siècle les conditions d’une nouvelle guerre de Trente ans. Celle-ci pourrait mener à une Troisième guerre mondiale. Il est urgent de dénoncer et de rejeter les prémisses géopolitiques de la politique occicientale. Margaret Thatcher et George Bush ont quitté la scène. Il doit en être de même de leur conception géopolitique.
