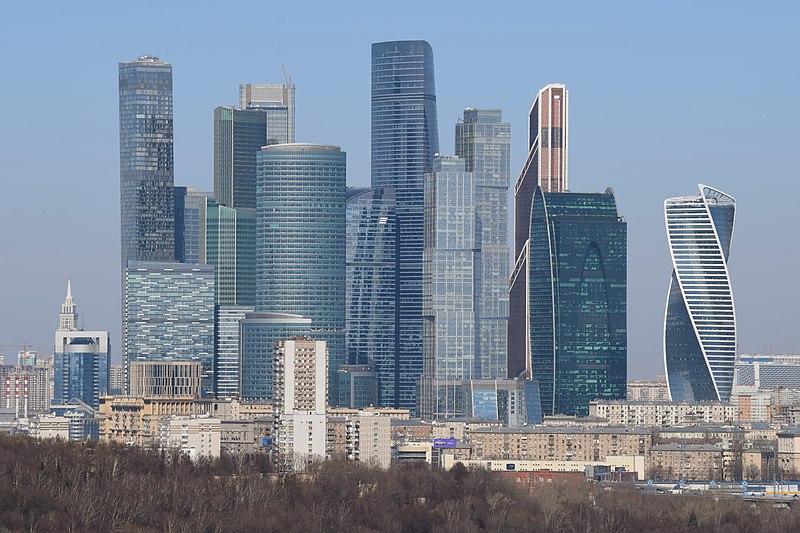Par Christine Bierre
Voyons tout d’abord les statistiques du FMI pour 2024. Selon le dernier rapport de cette auguste institution de Bretton Woods, l’économie russe vient de conquérir la quatrième place des principales économies du monde, jadis occupée par le Japon, si l’on calcule le PIB en termes de parité de pouvoir d’achat (PPA). Après la Chine, les États-Unis et l’Inde, vient donc la Russie. Vladimir Poutine s’est félicité d’avoir ainsi atteint les objectifs qu’il avait fixés au Forum de Saint-Pétersbourg, en avril 2023. Le FMI a également revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la Russie en 2024, à 3,6 %, tout comme la Banque mondiale, à 3,2 %.
Fini le temps où les Américains pouvaient se moquer de la Russie en la traitant de « pompe à essence avec des armes nucléaires ». Fini le temps où les Bruno Le Maire de ce monde pouvaient encore prétendre « provoquer l’effondrement de l’économie russe » avec quelques coups de fusil.
La transformation de l’économie russe
Que s’est-il passé ? Ce sont deux économistes français, experts de l’économie russe, David Teurtrie et Jacques Sapir, qui l’expliquent le mieux. La guerre en Ukraine, provoquée notamment par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, a donné l’occasion à la Russie, qui avait maintenu depuis la chute du Mur une économie très libérale, de revenir à une politique économique beaucoup plus dirigiste.
Les oligarques ont été obligés de rapatrier leurs profits en Russie. L’Etat a réorienté cet argent, ainsi que des fonds provenant d’autres sources, vers la création d’industries de « substitution », pour remplacer les entreprises étrangères qui avaient dû quitter la Russie à cause de la guerre, et les importations affectées par les sanctions. Ces investissements ont bénéficié en grande partie au secteur manufacturier, dans des domaines tels que l’aéronautique, l’automobile, l’extraction de gaz et de pétrole et l’agriculture, où la Russie est devenue leader mondial. A cela s’ajoutent les investissements dans de grandes infrastructures, permettant à la Russie de réorienter la plus grande partie de ses échanges, de l’Europe vers l’Asie.
Résultat, des performances très importantes dans l’économie. La baisse de la production en 2022, attendue par certains en Occident, à -10 %, et par la Russie elle-même à -4 %, n’a finalement été que de -1 %. Et aussi un taux de croissance de 3,6 % en 2023 et de 4 % en 2024.
Sans oublier, selon Jacques Sapir, qui cite la Banque de Russie comme source, des hausses de salaires de 20 %, dont bénéficie 20 % de la population russe en général, et de 40 % dans les zones très industrielles du pays. Ces hausses de salaires sont le résultat de ce boom économique, mais aussi d’une pénurie de travailleurs, due non pas tant à la mobilisation de guerre (de 200 000 à 400 000 départs), mais surtout à la démographie russe en berne depuis quelques années. « On manque de travailleurs, et les salaires flambent ! » Autre signe d’une redistribution de la richesse, la part des salaires qui, avant la guerre, représentait environ 39 % du PIB, est passée à 43 % en 2024.
Ce développement se traduit par une hausse du taux d’inflation en Russie, passé de 6 % avant la guerre à 8,5 %, dont les commentateurs antirusses occidentaux font leur miel dans les médias, se prenant à rêver que c’est le début de la fin d’un Poutine rendu impopulaire par ces hausses. Ils ne savent pas que cette augmentation est due pour moitié aux effets des sanctions et pour l’autre, à la hausse des salaires.
Ce tour des indicateurs de l’économie russe ne serait pas complet sans mentionner que, pour tenter de bloquer l’inflation, la Banque centrale de Russie a fait monter le taux directeur du rouble à 21 % ! Ceci, alors que le président Poutine et l’économiste russe Sergueï Glazyev, ancien conseiller présidentiel, aujourd’hui ministre de l’Intégration et de la macro-économie de l’Union économique eurasiatique, ont tous deux déclaré « qu’il ne fallait paniquer » car les facteurs fondamentaux sont bons, voire très bons. « Nous exportons plus que nous n’importons, beaucoup plus. En outre, alors que nous connaissions auparavant une fuite de capitaux considérable, de l’ordre de 100 milliards de dollars par an, les sanctions empêchent aujourd’hui les sorties d’argent. Par conséquent, pour stabiliser le rouble, il suffit de bloquer l’influence des facteurs spéculatifs et [autres] facteurs. »
Selon Glazyev, « les principaux spéculateurs sont les banques russes, qui ont commencé à accumuler des devises étrangères, puis ont encaissé des superprofits lorsque le taux de change de ces devises a été artificiellement augmenté ; elles jouaient contre le rouble et facilitaient sa dévaluation. En son temps, a-t-il rappelé, [l’ancien gouverneur de la Banque centrale de Russie] Viktor Gerachtchenko avait appliqué une tactique très simple. En 1998, il a gelé la position en devises des banques commerciales. » Cette politique de la Banque centrale ne fait pas consensus, rapporte Jacques Sapir de son côté, qui note qu’elle est mise en cause à la Douma, le parlement russe.
Tout va très bien, Madame la Marquise ?
Il reste quand même un problème de fond. Si la transformation de l’économie russe s’est faite de façon très intelligente pour bénéficier à un secteur manufacturier dont les applications sont duales, civiles et militaires, il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui, selon les informations russes, 30 % de l’économie du pays est consacrée à l’effort de guerre, ce qui ne manquera pas d’avoir un impact négatif sur son économie productive. Le Victory Program, lancé par le président Roosevelt pour préparer l’Amérique à s’engager dans la Deuxième Guerre mondiale, avait aussi ce côté dual, ce qui a permis à l’économie américaine de repartir de plus belle après la guerre, profitant des découvertes scientifiques et des avancées technologiques, dans l’aviation, l’électronique et autres secteurs industriels nécessaires pour gagner la bataille du progrès.
A condition que cette guerre ne s’éternise pas, l’économie russe aura connu une véritable transformation pour le mieux.