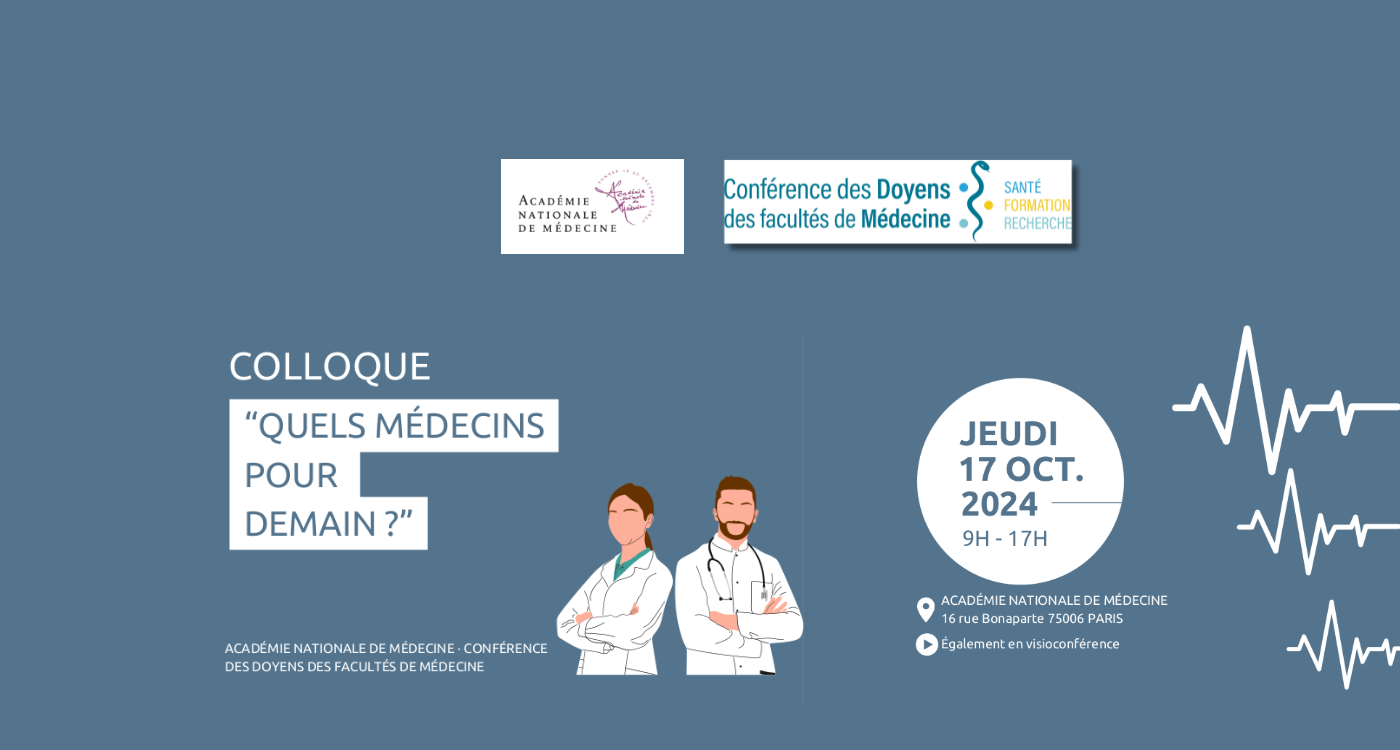Le 17 octobre 2024, l’Académie nationale de médecine a tenu un colloque sur l’évolution des besoins de santé en France. Outre les académiciens et d’éminents représentants du monde médical, des invités internationaux ont fait part de leur expérience tant au Canada qu’en Suisse, en Hollande, en Belgique ou en Espagne.
Les débats ont surtout porté sur les nouveaux moyens médicaux matériels, notamment le nouvel outil que représente l’IA, ainsi que les moyens humains à privilégier pour faire face au vieillissement de la population et au manque d’accès aux soins dont souffre une partie de la population.
Si les participants ont réclamé une « loi de programmation claire sur l’avenir du système de santé » de la part des décideurs politiques, ils ont demandé aussi un véritable pouvoir décisionnel du personnel médical et la mise en place d’une sorte de contrat social qui engagerait un partenariat, non seulement avec les paramédicaux (infirmiers praticiens, pharmaciens, aidants, etc.), mais aussi avec leur patientèle.
Un débat passionnant qui se déroule au moment où, dans un contexte de dérive libérale, le nouveau gouvernement français a bricolé en urgence un projet de loi de finances, avec une nouvelle nomenclature de la mission santé modifiée principalement pour recevoir des financements européens. Dans ce pacte faustien, il faudra bien rendre la monnaie.
L’effet Docteur Knock
Tout au long de ce colloque, trois objectifs ont été soulignés :
- une espérance de vie de qualité plutôt qu’un simple allongement,
- la résolution des inégalités territoriales,
- un retour sur investissement des décisions prises en santé.
En effet, avec le vieillissement de la population, la France fait face à une recrudescence des maladies chroniques (cardiovasculaires, psychologiques et cancéreuses). De plus, la désertification médicale atteint 87 % du territoire. Visiblement, c’est aussi un constat mondial. Si face à ce problème, d’autres pays ont déjà entamé un virage dans leur politique de santé, la France a pris du retard et a « du médecin une vision figée, datant de 1972 » selon Patrice Diot, doyen honoraire de la Faculté de Tours. La politique du numerus clausus aurait des effets néfastes jusqu’en 2025.
Henri Bergeron, directeur de recherche au CNRS, a abordé le désengagement du personnel médical et la crise du recrutement à laquelle fait face le monde hospitalo-universitaire, dont la cause serait « un organocène, c’est-à-dire une société saturée d’organisation », qui a mené le système de santé à une crise systémique.
Par exemple, le paiement à l’acte, qualifié d’« effet Docteur Knock » par Rutger Van der Gaag, président de la Dutch Association of Healhtcare Executive (NVZD), qui est non seulement coûteux pour la Sécurité sociale mais aussi chronophage pour le personnel médical. Aujourd’hui, dans les pays européens, quatre médecins sur dix sont en situation d’épuisement professionnel.
Comme le souligne Franck Chauvin, ancien président du Haut Conseil de la santé publique, le personnel médical officie dans un « business model », qui a pour conséquence un « système santé fournisseur de soins et non de santé ». Un système de gouvernance qui produit des inégalités et a fait fuir le personnel hospitalier.
« Apprendre pourquoi on apprend »
Les intervenants ont fortement souligné le rôle du « médecin citoyen dans la cité » et son apport humaniste auprès de la population. Ici, les intervenants appellent à un décloisonnement du système universitaire, trop centralisateur, vers les territoires selon un maillage géographique, pour que les étudiants en médecine s’habituent à une approche de vie différente des grandes zones urbaines et s’insèrent mieux dans la société rurale. Ainsi, au Québec, la formation d’étudiants-médecins en « universités délocalisées » est assurée par des médecins cliniciens régionaux et les médecins scolaires sont des infirmiers en pratique avancée, comme le souligne Patrick Brossette, doyen de la Faculté de médecine de Montréal.
Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique, appelle à un socle commun d’études au départ (avant le choix d’options professionnelles), suivi d’études en milieu hospitalo-universitaire (INSERM).
Thierry Moulin, doyen de la Faculté de médecine de Besançon, ajoute que le médecin de proximité (le médecin de premier recours) doit être comme « un chef d’orchestre comme Barenboïm », pour travailler en partenariat avec les autres branches soignantes, incluant les nouveaux métiers du numérique qui sont les emplois du futur.
Il précise que nous n’avons pas forcément besoin de plus de médecins, mais de plus de métiers de soins paramédicaux autour de ce médecin chef d’orchestre de proximité, tout en valorisant les soins de première ligne dans les études (infirmiers, kinésithérapeutes, centre de dépistage, problèmes médicaux fréquents, etc.).
Comment formaliser le rôle du médecin dans la société ? En réponse à cette question, Antonine Nicoglou, maîtresse de conférences à la Faculté de médecine de Tours, propose « une approche réflexive sur une demande de formation des médecins aux affaires de la Cité » pour gagner en confiance, mais aussi pour mieux connaître la place de la science dans la société. Notamment la vision que les patients peuvent acquérir sur la santé à partir des pseudo-sciences diffusées sur les réseaux sociaux. Un phénomène récurrent auquel font face la plupart des praticiens aujourd’hui.
La présence à la tribune de syndicats estudiantins, dont les responsables ont apporté un témoignage de volonté de relève, tout en étant conscients qu’« être médecin est une profession dans laquelle on s’engage, avant d’être une matière d’étude », comme le souligne Catherine Tourette Turgis, fondatrice et directrice de l’Université des patients :
L’Université des Patient·es-Sorbonne, fondée en 2010, est la première université au monde à avoir conçu des diplômes à destination des malades qui désiraient faire reconnaître et transformer leur expérience vécue de la maladie, en compétences et en expertise au service de la collectivité.
Cette université forme 100 patients par an avec l’obtention d’un diplôme de Patient co-chercheur, patient-partenaire ou patient-enseignant.
La vice-présidente de l’Académie nationale de médecine, Catherine Barthélémy, a clôturé en précisant que le compte-rendu de cette journée sera remis dans les mains du gouvernement.
12 % du PIB
C’est la part des dépenses de santé en France, qui, d’ailleurs, n’est pas plus élevée que dans les autres pays, selon les intervenants à ce colloque, qui précisent qu’elles ne peuvent augmenter. C’est vrai dans la situation de contraction économique dans laquelle est plongée la France, et d’autant plus que la souveraineté économique du pays est mise à mal. En effet, la France a perçu, en 2023, un soutien européen de six milliards d’euros en six ans pour l’investissement en santé :
L’investissement en santé, doté de 6 milliards d’euros, représente une part importante des
40 milliards d’euros attribués à la France au titre de la Facilité pour la relance et la résilience. Ces fonds à destination de la sécurité sociale transitent par le nouveau programme 379 rattaché à la mission « Santé », doté de 906,9 millions d’euros pour 2024. » (Vincent Delahaye, rapporteur spécial, sénateur de l’Essonne.)
Il va sans dire que les institutions européennes exigent la « traçabilité des fonds » et quelques réformes et réductions des coûts, dont ceux de l’Aide médicale d’Etat, qui doivent être rapprochés des aides existant ailleurs en Europe.
Soulignons toutefois que 12 % du PIB, dans un pays qui consacre son budget à une relance infrastructurelle garantissant le plein emploi, c’est un enrichissement qui valorisera cette part consacrée à la santé sans en augmenter le pourcentage. Souhaitons que le gouvernement fasse bon usage du compte rendu du colloque de l’Académie nationale de médecine car ici, tout est question de proportion et la décision ne peut être que politique.
Sources :
- L’Université des Patient·es-Sorbonne : https://universitedespatients-sorbonne.fr/
- Projet de loi de finances pour 2024 MISSION « SANTÉ » : https://www.senat.fr/rap/l23-128-328/l23-128-328-syn.pdf
- Projet annuel de performances, Budget général, PROGRAMME 183, Protection maladie 2024 : file :///C :/Users/Agn%C3%A8s/Downloads/FR_2024_PLF_BG_PGM_183.pdf