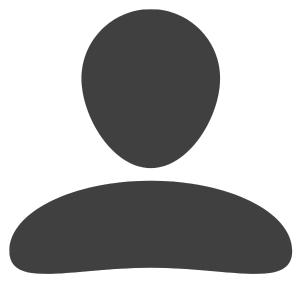Après l’entretien qu’a bien voulu nous accorder François Asselineau, nous publions celui avec le candidat présidentiel Alexandre Langlois, afin de permettre à nos lecteurs de juger « sur pièces » son engagement et son combat. Nous avons apprécié sa façon très directe de s’exprimer et pensons que son apport mérite une considération particulière en vue de l’union nationale à laquelle nous avons appelé dès le 30 janvier dans ce journal, en indiquant qu’elle devait en être, selon nous, l’inspiration.
Nouvelle Solidarité : Vous êtes candidat à l’élection présidentielle. En quoi votre projet est-il original par rapport aux autres candidats déclarés ou à venir ?
Alexandre Langlois : La première caractéristique essentielle de ce projet, c’est qu’il propose d’abord d’adhérer à des fondements communs. Il existe des principes de respect de la personne, de lien social et de justice qui, selon nous, doivent prendre le pas sur l’individualisme et le matérialisme actuel.
Ces fondements, résumés sur notre site, sont le premier ciment de notre équipe et de nos soutiens, et définissent les contours d’un modèle de société désirable. Dans son article LRM, le vaisseau fantôme de la Macronie paru récemment dans Le Monde, Solenn de Royer fait une analyse des raisons de la désertion des militants LRM qui m’a particulièrement interpellé : elle y dresse le portrait d’un mouvement qui ne reposait sur aucun fondement commun. Un phénomène résumé par le fameux « en même temps » qui permet à chacun de retenir le bout de phrase qui fait écho à ses propres convictions. C’est de la communication, pas de la politique. Cela m’a conforté dans notre approche qui n’est pas de gagner « quoi qu’il en coûte » en faisant du clientélisme, mais bien de construire une vision politique alternative, radicale, réaliste et fondée.
La seconde spécificité c’est la cohérence. Mon équipe comme moi sommes des personnes engagées, pour qui il n’y a pas de différence entre la parole et l’action. La parole donnée a une valeur, et elle doit s’ancrer dans le réel. Nous avons non seulement l’espoir de transformer le quotidien de nos concitoyens pour le meilleur, mais surtout la volonté très concrète de poser des actions pour y parvenir.
La troisième différence est notre choix de conduire un mouvement à vocation majoritaire. Cela rejoint le point précédent : je ne suis pas là pour faire une candidature de témoignage sur mes sujets de prédilection, je propose un programme qui a l’ambition de faire advenir ce que souhaite une majorité de Français. Même si au sein du mouvement, beaucoup ont des idées particulièrement visionnaires sur différents sujets, il ne s’agit pas de faire campagne sur des mesures qu’une majorité de Français n’attendent pas, ne comprennent pas ou ne souhaitent pas à ce jour. D’une part cela mène à l’échec, donc à l’impuissance à agir, d’autre part ça n’est pas la conception que je me fais de la démocratie. Cela ne signifie aucunement que l’on renonce à un idéal, cela signifie avancer au rythme de la société, et faire que, dans cinq ans, des actions aient été posées qui remettent la France sur un bon chemin.
Vous avez dit vous définir en fonction d’objectifs et de moyens d’y arriver. Comment comptez-vous, pour commencer, obtenir vos 500 parrainages ?
Tout d’abord, il faut savoir que nous avons la chance d’avoir près de 48 000 personnes qui sont en mesure de donner leur parrainage en France. 500 est un chiffre atteignable. A ce propos, le politologue britannique Adrian Pabst précise que même si une campagne en dehors des grands partis est ardue en France, elle est tout bonnement impossible en Grande-Bretagne. Même si les obstacles à faire campagne en France sont nombreux, il faut savoir reconnaître cette chance que nous avons encore de pouvoir oser. Par ailleurs, il y a de plus en plus de maires et d’élus sans étiquettes, donc autant de parrains potentiels qui ne seront pas soumis à la pression de leur organe national. C’est une chance de plus. Très concrètement, nous avons eu l’honneur d’être rejoints rapidement par des soutiens un peu partout en France, qui sont justement en train de contacter le maximum d’élus locaux, y compris dans les territoires d’Outre-Mer. J’irai voir prochainement tous les maires ayant accepté de me rencontrer. Je me réjouis que la campagne passe d’abord par ces échanges avec des personnes de terrain. Non seulement pour aller à la rencontre encore plus en profondeur de notre pays, mais aussi parce que j’ai la conviction qu’énormément peut être fait à l’échelon d’une ville ou d’une commune, et que c’est là que se joue pour beaucoup l’avenir de notre pays. Le principe de subsidiarité est d’ailleurs au cœur de notre projet politique.
Vous avez déclaré que la France a besoin d’un Plan. Par quels moyens financiers comptez-vous soutenir les buts qui seront fixés ?
Oui, la France a besoin d’avoir une vision stratégique à moyen et long terme, pour créer une dynamique économique, dans un cadre juridique stable, permettant de fiabiliser les investissements. Le Plan à la française n’est pas coercitif, mais incitatif. Pour cette planification stratégique de l’économie, il est nécessaire d’avoir un commissariat général au Plan, inspiré de celui mis en place par le général De Gaulle à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, la planification ne serait pas tournée vers la reconstruction d’après-guerre, mais vers la transition écologique et la relocalisation de nos industries, en priorité les plus stratégiques. Chaque époque a ses défis à relever même si, 75 ans après le premier Plan, refonder l’Hôpital et l’Education nationale sont à nouveau un enjeu hélas, justement à cause d’une gestion sans vision de la France. Le commissariat général au Plan étant une structure de pilotage stratégique, non de commande, il n’aura pas besoin d’un apport financier important par rapport au budget de l’Etat. Néanmoins, pour améliorer les finances publiques, il existe des leviers qui ont été beaucoup cités sans être jamais réellement appliqués, et qu’il est temps de poser dans le réel : la sobriété de la dépense publique à travers une profonde réorganisation de l’Etat, et la lutte contre la fraude, qu’elle soit fiscale ou sociale. Enfin, quand il est question d’investissement de long terme, et si les taux d’intérêt sont bas, il n’y a pas de honte à parler d’emprunts et de dette.
Est-il possible que la France poursuive une politique de souveraineté nationale et de justice sociale au sein de l’Union européenne et de l’OTAN ?
Non, en effet, pas avec l’Union européenne actuelle. La justice sociale est sacrifiée par le dogme d’un libre-échange sauvage, qui oppose les entreprises européennes et favorise les moins-disants socialement et écologiquement. On a cru à une subsidiarité administrative et juridique : ce serait la hiérarchie des normes juridiques, la soumission des normes nationales et locales aux normes européennes, qui ferait l’Europe. Cette approche est néfaste. Une Commission qui bénéficie des mécanismes de blocage politique de la décision entre Etats pour imposer ses solutions ; des juridictions qui imposent le droit abstrait qui en découle ; des gouvernements nationaux qui n’assument pas sur le théâtre de la démocratie nationale les décisions prises à la discrétion à Bruxelles. Tel est l’engrenage qui résulte de cette conception, basée sur une approche bureaucratique combinée à un droit abstrait et tout-puissant. C’est pourquoi je suis profondément eurocritique. Il doit y avoir une continuité démocratique entre la démocratie à l’échelon local, la démocratie à l’échelon national et la démocratie à l’échelon européen, si nous voulons que chaque problème, chaque enjeu soit traité de manière efficace, reliée, dans un même rythme. Chaque décision locale fait l’Europe. Chaque décision européenne doit nous laisser assumer, si nous en avons le courage, une traduction locale souple. C’est l’idée pleinement reconnue de la subsidiarité. Mais il faut la remettre sur pied. Aussi, je crois aussi profondément qu’une autre construction est possible, en s’inspirant du modèle qu’avait proposé le général De Gaulle avec le plan Fouchet, tout en l’adaptant aux enjeux de notre siècle. Une confédération qui aurait pour but « de rapprocher, de coordonner et d’unifier la politique des Etats membres dans les domaines d’intérêt commun : politique étrangère, économie, culture, défense » (article 2 du plan Fouchet de 1962). Par ailleurs, je crois dans une Europe à plusieurs vitesses. Il faudra se battre pour des coopérations renforcées à partir de trois pays. Aujourd’hui, à 27, rien n’est possible hélas. Concernant l’OTAN, à court terme cette alliance est nécessaire, mais il serait souhaitable de questionner la participation de la France au commandement intégré. Pour pouvoir prendre nos distances avec l’OTAN, il faut d’une part que les armées françaises retrouvent leur autonomie, avec un budget national qui nous permette à nouveau d’atteindre les cinq espaces d’affrontement : terre, mer, air, espace et cyber. Il faut, d’autre part, redéfinir le contour de nos alliances, et pourquoi pas justement commencer ce travail de coopération renforcée sur la Défense avec des pays proches. Car sur ce sujet-là, encore plus que sur les autres, la France ne peut vivre en autarcie.
Vous avez dit que les politiques veulent voir la réalité à travers un tableau Excel. Pourquoi, selon vous, sont-ils ainsi ?
La majorité des élus les plus médiatisés proviennent en réalité d’un nombre de moules limité : écoles de commerces, sciences politiques, ENA… L’uniformité de la provenance de nos femmes et hommes politiques explique en partie l’uniformité de la vision qu’ils ont du monde : un monde ouvert aux quatre vents, mondialisé avec si peu de barrières et si peu de protections. Un monde technocratique, vertical et abstrait, que des lois et des circulaires pourraient modifier d’un claquement de doigts. Le premier écueil provient des rapports. Nos dirigeants ont appris à voir la réalité à travers les rapports qu’ils ont étudiés dans un premier temps, qu’on leur a demandé de rédiger par la suite, puis que maintenant ils commandent, souvent à des organismes eux aussi formatés. Ces rapports trop volumineux, synthétisés en graphiques et belles phrases, sont peu à peu devenus ainsi la seule représentation de la réalité qu’ont nos politiques.
L’avènement des « rapports » a aussi coïncidé avec l’alignement du public sur la nouvelle culture managériale du privé : la « gouvernance par les nombres » dont parle Alain Supiot. Il s’agissait alors d’évaluer les performances des services publics à travers des indicateurs. Si l’intention de suivre le bon usage de l’argent public était louable, hélas peu à peu ces indicateurs ont remplacé toute réalité sous-jacente. Les indicateurs notamment financiers sont devenus le seul moyen d’évaluer les performances des politiques publiques, des institutions, etc.
Cette « culture du tableur », du reporting et du contrôle, déjà contre-productive dans les entreprises, comme le décrit Pierre-Yves Gomez dans L’Esprit Malin du Capitalisme, s’est pourtant généralisée dans le public, sans jamais être remise en question. On aboutit à des aberrations : quand on évalue la performance du système de santé en euros par malade… mieux vaut avoir beaucoup de malades. Ce qui est pourtant la définition d’un mauvais système de santé. Autre exemple dans la police nationale que je connais bien : tous les ans, les chiffres de la délinquance sont annoncés en baisse. A force ils vont devenir négatifs, ce qui est statistiquement possible, mais impossible dans la réalité. Les tentatives de cambriolages sont requalifiées en dégradations volontaires, transformant un délit en contravention. Un vol à l’arraché est requalifié en vol simple, faisant diminuer les vols avec violence. Ces bonnes statistiques permettent à des chefs de service et des directeurs de toucher des primes très importantes, et d’avoir des promotions. Ces chiffres fantasmés confortent nos politiques dans leur vision biaisée de la réalité. Malheureusement, les effectifs de police sont déployés en fonction de ces indicateurs quantitatifs.
Ces tableaux et indicateurs sont ceux transmis à l’INSEE, à l’Europe, et consultés par toutes les banques et organismes internationaux. Il y a là un troisième écueil. Ces tableaux servent à construire des indicateurs économiques (PIB, part de prélèvement obligatoire, taux d’endettement, taux d’intérêts), qui servent alors à comparer les nations entre elles. Quelle est la plus grande croissance ? le plus haut PIB. Pour des questions d’orgueil, d’ambition, ou peut-être juste par esprit de compétition – mais aussi parfois par nécessité louable – nos politiques ont cherché à améliorer ces indicateurs économiques à travers l’amélioration de leurs propres tableaux Excel.
Ainsi on passe de rapports tentant de décrire le réel, à des politiques qui ne cherchent à améliorer ni le service rendu, ni la performance pour le citoyen, mais uniquement les indicateurs internationaux. Qu’importe le réel, pourvu qu’on soit bien noté par le FMI. Or la réalité, c’est que l’Etat coûte de plus en plus cher alors que le service rendu au citoyen est de plus en plus déficient et lointain ! Il est urgent de réintroduire du qualitatif dans nos analyses. Enfin, soyons honnête, quand on vous présente quatre pages et deux tableaux en vous disant : « Voici l’état de l’hôpital », cela à l’air tellement simple, compréhensible. On peut vraiment croire qu’il suffit de jouer avec les numéros dans les cases pour tout remettre d’aplomb. Comme un coup de baguette magique.
Il est temps d’accepter la complexité et l’imprévisibilité parfois du réel, le fait qu’il est avant tout constitué par des personnes et non des chiffres… Il est temps de revenir au sens profond, au fondement de l’action des services de l’Etat. De cela découleront les actions à mettre en place, les bonnes gouvernances correspondantes et les indicateurs adéquats. C’est un profond changement à opérer, mais tout le reste est une impasse.
Croyez-vous qu’il y ait réellement une urgence climatique et écologique, ou n’est-ce pas plutôt un moyen de détourner les citoyens des vrais défis ?
Il y a assurément une urgence climatique et écologique. Celle-ci est d’autant plus grave qu’elle se corrèle avec une urgence sociale et économique. Nous ne pouvons plus nier les effets du changement climatique qui nous touche chaque jour un peu plus, tant en France que dans le reste du monde. Très concrètement, pour faire face au changement climatique, les agriculteurs modifient leurs cultures, leurs vergers. Nous plantons dans l’Est de la France des forêts d’arbres en provenance du Sud, pour mieux résister aux sécheresses. Nous modifions nos villes pour nous y adapter, nous regardons nos rivages se faire grignoter. Ces urgences écologiques ne sont pas à dissocier de notre vie quotidienne, car nous en vivrons chaque jour les impacts. Le changement climatique, la dégradation des écosystèmes, les pollutions massives impacteront tout d’abord notre alimentation, notre air et nos ressources énergétiques. Et les plus touchés par cette crise écologique seront les classes les moins aisées, ceux qui ne peuvent pas payer une alimentation trop chère, ceux qui ne peuvent pas choisir de vivre loin de zones de pollutions, ceux qui ne pourront pas payer plus de chauffage ou de climatisation.
Crise écologique, crise sociale et crise démocratique : ce ne sont pas trois crises distinctes, mais bien trois faces d’une seule et même crise. Quand les services publics s’éloignent de plus en plus pour se regrouper dans les grandes villes, c’est pour beaucoup de Français l’obligation de prendre la voiture, malgré le coût et la pollution engendrés.
Quand des Français peinent à boucler les fins de mois, comment s’offrir le luxe du bio ? Quand les réseaux de distribution, d’eau notamment, ne sont pas assez entretenus, ce n’est pas seulement de l’eau potable qu’on gaspille, mais nos concitoyens que nous privons d’eau vitale. Nous vivons une crise multiforme qu’il ne sera pas possible de résoudre en se contentant de regarder telle face, puis telle autre. Et les solutions à la crise sociale passeront par des réformes démocratiques et écologiques.
Comment convaincre les Français que le chemin de la raison doit toujours passer par le cœur et que c’est possible en politique ?
Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de convaincre les Français que la raison doit passer par le cœur. Ils le savent et l’ont déjà souvent éprouvé. Au niveau collectif, ils pressentent que la raison sans le cœur conduit au totalitarisme quelle qu’en soit la forme.
En revanche, il est urgent de convaincre les responsables politiques de remettre l’humain au centre de leur action, d’être à l’écoute des besoins des plus faibles comme de ceux qui travaillent dur et ne s’en sortent pas. Ce que sait le cœur est su, sans preuve. Pas besoin de statistiques ni de rapports. La récente sécession électorale atteste que c’est l’âme citoyenne de la France qu’il faut ranimer. L’heure n’est plus à la réforme mais à une refondation.
Vous vous êtes référé à Aristote et au « juste milieu ». Est-ce la même approche que celle de Valéry Giscard d’Estaing, qui comptait réunir deux Français sur trois au nom de la même expression ? Dans Le Politique, Aristote part de la société telle qu’elle est pour analyser ce qu’on peut faire. Est-ce votre cas ?
En effet, il me semble assez insolite de ne pas partir du réel pour faire de la politique ! Il faut prendre la société telle qu’elle est, partir d’un point donné, et pas à pas concrétiser des décisions, des choix qui vont vers une société meilleure pour chacun. Il faut tracer un chemin, et se fixer des objectifs radicaux et réalistes dans le temps. On ne peut pas emmener une société au-delà de ce qu’elle peut accepter à un instant donné. Enfin si, on peut toujours, mais ça n’est plus la démocratie.
Que comptez-vous faire pour parvenir à un statut de l’élu ?
Dans une démocratie, l’élu agit au nom des citoyens, pour les citoyens qu’il représente. L’éloignement, de plus en plus important ces dernières années, entre élus et citoyens est le syndrome d’une démocratie chancelante. Quand les citoyens, exaspérés par les jeux politiques figés, en viennent à s’abstenir en masse aux élections, les résultats sont ressentis comme illégitimes.
Les décisions prises par nos élus, les lois votées, le sont alors elles aussi. Comment faire société si les Français considèrent que leurs élus ne les représentent pas. Cet éloignement provient notamment de la différence entre la strate des élus et les Français. Il y a trop peu d’agriculteurs, de chefs d’entreprise, d’ouvriers parmi les députés. Il est nécessaire de permettre une réelle représentativité, et cela passe, pour moi, par un statut de l’élu. Comment fait un agriculteur qui serait élu député, avec ses cultures et son bétail ? Comment fait l’entrepreneur quand, à la fin de son mandat, il doit remonter son entreprise de zéro ? Actuellement, nos élus sont principalement des fonctionnaires pour qui ces questions ne se posent pas, ou des professionnels de la politique qui s’accrochent à leurs mandats. Ils se représentent encore et encore aux élections, oubliant le vœu de renouvellement qu’ils appelaient au début de leur carrière. Ils accumulent les mandats, et sentant le vent tourner, ils passent d’une députation à une mairie, d’une mairie à une région.
Le statut de l’élu n’est pas là pour garantir des avantages à une élite dirigeante ; il doit garantir à chaque citoyen la possibilité d’être élu à un moment de sa vie pour servir la communauté dans de bonnes conditions, et à la fin de son mandat reprendre une vie normale. Ainsi, avec ce statut, le renouvellement des femmes et hommes politiques pourra être exigé, car tout élu se verra garantir des conditions qui lui permettent de reprendre une vie « civile » ordinaire.
Face à l’oligarchie des portes tournantes public-privé, qui engendre la soumission de l’État aux priorités d’une véritable oligarchie financière, que proposez-vous ?
En politique, l’oligarchie ne peut être vaincue que par la démocratie. La démocratie ne doit pas s’arrêter aux portes de l’entreprise. C’est pourquoi je défends la mise en place d’une co-détermination dans les entreprises, à travers la représentation des salariés dans les instances de gouvernance, à hauteur de 30 % des sièges.
Les entreprises comme les salariés tendent à voir leurs rôles réduits à celui de simples agents économiques, ce qui réduit leur relation au seul rapport de force, dans la défense d’intérêts réputés antagonistes. L’absence de représentation des salariés auprès des instances dirigeantes des entreprises crée de fortes fractures entre salariés et direction.
S’il existe bien un Comité social et économique (CSE) pour le dialogue entre les salariés et l’entreprise, ces instances n’ont pas vocation à intervenir ou même à être consultées sur les choix stratégiques, ni sur des orientations de développement.
La financiarisation de l’économie, accompagnée de court-termisme, le poids de l’Etat en termes de réglementation et de prélèvements, le climat de méfiance avec un syndicalisme politiquement « orienté » ont creusé le fossé.
Et pourtant ce n’est pas une fatalité : la représentation des salariés dans la gouvernance des entreprises est en place depuis de nombreuses années dans près de la moitié des pays européens (de 30 à 50 % de représentation salariale). Il s’agit principalement de l’Allemagne, des Pays-Bas et d’autres pays d’Europe centrale, ou du nord, qui ont, lors des deux décennies passées, réussi à garder leurs industries. Des études sur les inégalités primaires (différences sur les salaires bruts, avant tout redressement par l’impôt ou aides) montrent que dans les pays où cette co-détermination existe, les inégalités primaires sont moins fortes. L’échange et l’implication des salariés sont également une chance de plus que les décisions de l’entreprise soient orientées vers le long terme et le bien de la collectivité. Je suis convaincu que notre économie a besoin d’entreprises fortes de toutes tailles et que les véritables entrepreneurs qui s’investissent dans le long terme et des emplois pérennes contribuent au bien commun.
Dans le même temps, comme j’ai pu le détailler dans mon combat pour la mise en place d’un IGPN Citoyen, il faut que les institutions/administrations soient également contrôlées par des organismes indépendants, composés de professionnels mais surtout d’usagers citoyens. Avec la possibilité de révoquer des responsables nommés, qui n’œuvrent pas pour le bien commun mais pour des intérêts particuliers. Avec la mise en place de tels organes de contrôle dans le public comme dans le privé, je pense que nous créerons un réel garde-fou contre les pratiques évoquées, sans chasse aux sorcières ni interdictions spécifiques.
Prévoyez-vous un dialogue avec d’autres forces politiques que vous jugerez de la même sensibilité que la vôtre ?
Comme je le dis souvent quand on me reproche d’avoir fait une interview dans tel média classé à gauche ou tel autre classé à droite, je parle toujours à tout le monde. Et bien sûr, je parle régulièrement, comme aujourd’hui, à d’autres forces politiques. Aussi bien à des personnes qui partagent notre sensibilité qu’à celles avec qui nous sommes en désaccord, car c’est justement dans la respectueuse confrontation des différences que se créent les idées novatrices. Ce dialogue serein entre personnes en désaccord semble hélas avoir disparu, la recherche permanente de spectacle médiatique polarise le débat, et si les intervenants ne se battent pas, on confond alors dialogue et rapprochement.
Si par dialogue on entend accord ou arrangements, là par contre, ça n’est pas la politique telle que je l’entends. Comme je l’ai dit en réponse à votre première question, il y a des fondements qui sont à la base de ma candidature, c’est cela que je défends. Je ne suis pas là pour négocier des postes ou des mandats, pour un plan de carrière… Je souhaite fédérer les hommes et les femmes qui partagent ces fondements et souhaitent bâtir une alternative politique puissante.

 COMMENTAIRES
COMMENTAIRES