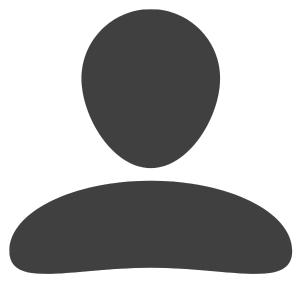[sommaire]
Introduction
Dans ce monde soumis à la pression d’une crise financière, stratégique et morale sans précédant, toutes les cohérences éclatent les unes après les autres, emportant la clôture qui séparait jadis la barbarie de la civilisation. C’est pourquoi il est crucial de déceler aujourd’hui où se trouve l’issue conduisant au progrès.
Alors que Londres et Washington entraînent le camp occidental vers une nouvelle guerre mondiale pour imposer leur hégémonie aux pays des BRICS qui tentent de s’en affranchir, une seule solution pacifique est avancée qui pourrait changer la donne. C’est la « Nouvelle route de la soie » proposée par le président chinois Xi Jinping, un projet ouvert à tous, visant à créer une dynamique de paix par le développement économique dans le monde.
La Chine peut être inspiratrice et moteur de ce projet, grâce aux progrès fulgurants qu’elle a réalisés et aux énormes réserves de change accumulées depuis le lancement de sa modernisation en 1979. Mais voilà qu’une campagne de diabolisation menée par les médias à la solde des centres financiers et des pouvoirs occidentaux, plus insidieuse même que celle orchestrée contre la Russie, nous empêche de comprendre cette opportunité.
Cet article sur l’un des fondements de la culture millénaire chinoise, la pensée de Confucius (551 à 479 av. J.-C.), est destiné à vous faire revoir ces préjugés. Non pour « rejoindre » le camp de la Chine, comme on rejoindrait une équipe de foot ! Mais pour comprendre que face à un camp occidental à la dérive, incapable de se réformer après la crise spéculative de 2008 et ne parlant plus qu’avec la force de la poudre, la participation de la France, si possible avec l’Allemagne, à ce projet de « nouvelle route de la soie », auquel sont désormais associés les BRICS, est le seul levier pour empêcher une nouvelle conflagration mondiale.
La Chine remet Confucius à l’honneur
La Chine vient de fêter, le 28 septembre, le 2565e anniversaire de la naissance de Confucius (551 – 479 av. J.C.). « La culture est l’âme de la nation », a déclaré M. Xi Jinping lors de la conférence de l’Institut Confucius international consacrée à cet événement, faisant un éloge vibrant de Confucius et incitant les Chinois à bien connaître leurs classiques.
Contemporain des présocratiques en Grèce, on pourrait dire que Confucius a été le Socrate de la Chine, un humaniste érudit mais empreint de sagesse qui, avec un groupe de disciples, a tenté, dans ces années troubles de la période dite des « Printemps et Automnes », de « poser quelques principes dans un monde en chaos ».
Au centre de ses conceptions, le Ren, notion très proche de l’agape gréco-chrétien : l’amour pour les autres qui n’attends rien en retour ; une vision de l’homme devant s’élever à la sagesse par une éducation accessible à tous, pauvres et riches ; une conception de la politique et de l’art de gouverner obéissant a cette obligation éthique ; un être humain existant au sein d’un univers lui-même gouverné par ces principes avec qui l’homme moral peut entrer en cohérence.
De son temps, malgré plus de dix ans de voyages incessants pour proposer ses idées dans les différentes provinces, les conceptions de Confucius n’ont pas été mises en pratique. Par la suite cependant, elles ont nourri de grandes périodes de renaissance en Chine, grâce notamment à Mencius (390-305), qui a repris l’offensive de Confucius. Son influence a conduit la Chine à adopter le confucianisme comme doctrine d’Etat dans la période Han (202 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.). Il fut surtout à l’origine de la renaissance de la période Song, entre le XIe et le XIIe siècle après J.-C., initiée par l’école néo-confucéenne Cheng/Zhu dont la figure la plus importante fut Zhu Xi.
Pourquoi appeler Confucius une fois de plus à la rescousse aujourd’hui ? L’un des problèmes auxquels les Chinois sont confrontés a été décrit avec une honnêteté remarquable, qu’on peine à avoir ici en France, par un haut responsable chinois, le Dr Cui Hong Jian, directeur à l’Institut chinois d’études internationales, lors d’une conférence de notre Institut Schiller en 2013. Bien que la Chine soit, du point de vue politique, encore un pays communiste avec une direction totalement centralisée, ce renouveau du Confucianisme montre que ce pays a bien plus de capacités à se renouveler que nos pays occidentaux dits démocratiques !
L’introduction de l’économie du marché, a-t-il dit, a remis en cause le style de vie traditionnel du peuple chinois.
En raison de la rapidité de la croissance de ces trente dernières années, la Chine fait maintenant face à d’énormes problèmes. Les gens sont mal à l’aise à propos de tout et le résultat est que le système traditionnel moral de la Chine doit être reconstruit. Ce qui est mauvais est que la plupart des gens ne vivent que pour gagner de l’argent le plus vite possible. Il y a quelques jours, j’ai eu un peu honte en apprenant que l’an dernier, la Chine avait dépassé les États-Unis dans l’achat de produits de luxe ! Certes, les Chinois deviennent de plus en plus riches, mais ça ne concerne qu’un petit nombre. La Chine est encore un pays pauvre. C’est pour cela que nous parlons de Confucius aujourd’hui. Le confucianisme est un ‘humanisme’. Confucius demandait aux dirigeants de son époque de pratiquer le Ren, qui veut dire ‘le bien’. ‘Qu’est-ce que le Ren ? demandait Confucius. C’est aimer l’autre !’
Un dialogue entre la culture chinoise et l’européenne
C’est le grand philosophe allemand, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), redoutable politique aussi, qui, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, fit découvrir aux élites européennes la nature confucéenne de la Chine, s’appuyant sur le travail des pères jésuites dans ce pays.
Leurs missions avaient réussi à s’introduire en Chine dès la fin du XVIe siècle pour tenter d’y développer la foi chrétienne en échange de l’apport des sciences mathématiques et de l’astronomie européenne. Le père italien Matteo Ricci (1552-1610) ayant appris le Chinois, a été le premier à pouvoir entrer dans les provinces chinoises, invité par quelques mandarins qui voulaient apprendre sa science. Dans son sillage est arrivé le père allemand Johann Adam Schall von Bell qui, grâce à ses talents, a pu améliorer considérablement la position des chrétiens en Chine, en étant nommé directeur européen du Tribunal astronomique ; et qui est devenu professeur et ami de l’empereur Chun-chih (1644-1661). A la fin de sa vie, Schall fit appel au père belge Ferdinand Verbiest (1623-1688) qui est devenu à son tour professeur de l’Empereur Kangxi (1645-1722) dès son plus jeune âge. Selon Leibniz, Kangxi consacrait 3 à 4 h par jour à l’étude des sciences avec Verbiest !
A la fin du XVIIe siècle, Leibniz apporta tout son soutien aux jésuites, les défendant contre les assauts répétés d’autres ordres qui y étaient totalement hostiles, franciscains et dominicains notamment, mais aussi des Vicaires du Pape ou encore de la Sorbonne.

La situation était précaire : en 1692, l’empereur Kangxi avait émis un édit de tolérance pour la religion chrétienne, point d’orgue du travail d’un siècle ! Mais en 1704, le pape Clément XI émit un décret confirmant la condamnation des rites chinois, rendant inévitable la décision de Kangxi en 1705, exigeant des missionnaires qu’ils signent un formulaire de respect des rites chinois, ce que ceux-ci ne pouvaient faire sous peine d’excommunication. Ce qu’on a appelé la « querelle des rites » ne finira qu’avec la suppression de la Compagnie de Jésus, pour ces raisons, en 1773.
Informé dès 1675 des projets orientaux de Jean-Baptiste Colbert (à moins qu’il n’en ait été l’instigateur, suggère l’historien Virgile Pinot), Leibniz fut la cheville ouvrière d’une mission de six jésuites scientifiques français qui arriva en Chine en 1687. Parmi les pères on trouvait Joachim Bouvet, qui publia un portrait élogieux de Kang-xi, et Jean François Gerbillon, qui fut du groupe des traducteurs et négociateurs sans lesquels le Traité de Paix de Nertchinsk, signé à la frontière sino-russe (le premier entre ces deux puissances), n’aurait pu voir le jour. Ces missionnaires, ainsi que Antoine Verjus, Le Gobien et l’italien Grimaldi ont été les correspondants de Leibniz dans cette aventure.
Le dessein eurasiatique de Leibniz

En 1697, pour défendre ces missions, Leibniz publie Les dernières nouvelles de Chine (Novissima Sinica). Il y explique l’importance stratégique des missions en Chine et informe ses lecteurs des dernières nouvelles de ce pays, dont il est informé grâce à ses correspondants.
Deux objectifs poussent Leibniz à soutenir ces missions. Toute la connaissance, bien sûr, qu’il y avait à tirer de ces échanges.
Dans une lettre inédite au père Antoine Verjus, datée de 1697, il écrit :
Je juge que cette mission est la plus grande affaire de nos temps, tant pour la gloire de Dieu (…) que pour le bien général des hommes, l’accroissement des sciences et des arts chez nous aussi bien que chez les Chinois ; car c’est un commerce de lumière qui peut nous donner tout d’un coup leurs travaux de quelques milliers d’années, leur rendre les nôtres et doubler pour ainsi dire nos véritables richesses de part et d’autre.

Leibniz avait aussi, dirions-nous aujourd’hui, une fenêtre d’opportunité unique dans l’histoire pour changer le cours des choses en Europe.
Il pouvait utiliser son influence auprès de l’empereur Kangxi, via ces missions, et celle qu’il exerçait sur Pierre Le Grand de Russie (1672-1725), dont il était devenu le conseiller, pour lancer un vaste dessein de progrès en Eurasie : promotion des échanges, de la science, de la technologie, du développement économique.
Se plaignant du climat politique délétère en Europe, Leibniz se réjouit dans l’une de ses lettres de la possibilité qu’il a de changer la vie de millions de gens, en conseillant leurs monarques !
On trouve dans ce dessein le germe, tout confucéen, de la Nouvelle route de la soie proposée aujourd’hui par M. Xi Jinping ! « Une disposition particulière de la Providence, à mon avis, a fait que la plus haute culture et l’ornement du genre humain se trouvent aujourd’hui comme concentrés aux deux extrémités de notre continent, l’Europe et la Tschine, laquelle, en tant qu’Europe de l’Orient, orne le bord opposé de la terre », dit Leibniz dans sa préface.
Peut-être la Providence suprême s’occupe-t-elle, en faisant se tendre la main les nations les plus policées mais les plus éloignées, d’élever tout ce qui se trouve entre elles à une meilleure règle de vie. Et ce n’est point par hasard, je pense, que les Moscovites, dont l’immense territoire relie la Chine à l’Europe, et qui maintiennent sous leur empire les Barbares du Nord les plus reculés le long des rivages de l’Océan glacial, sont portés à rivaliser avec nous en cette affaire : le monarque sur le trône [Pierre Le Grand] s’y efforçant le plus possible stimulé même, à ce que j’ai ouï dire, par les conseils du Patriarche.
Dans ce même texte, Leibniz compare les mérites respectifs de l’Europe et de la Chine, notant que « l’Empire chinois […] ne le cède pas en étendue à l’Europe cultivée, et même la surpasse en population » et que dans d’autres domaines, à armes égales, il est tantôt vainqueur, tantôt vaincu ! L’Europe l’emporte, dit Leibniz, par la profondeur des méditations et les matières spéculatives : la logique, la métaphysique, la connaissance des formes que l’esprit sépare de la matière comme les mathématiques.
Car les Chinois semblent s’être contentés d’une sorte de géométrie empirique, comme en usent les artisans. « Mais il convient de regarder la Géométrie en philosophe, et non en artisan » car « ceux-là seulement qui ont étudié les démonstrations des géomètres connaissent la nature des vérités éternelles et peuvent discerner le certain d’avec l’incertain. » Outre la géométrie pure, il fallait aussi enseigner aux Chinois « la Philosophie première, qui nous introduit à la connaissance des choses incorporelles ».
Mais là où Leibniz est littéralement ébloui, c’est au niveau de la philosophie pratique des Chinois :
Qui eût jamais cru qu’il existait sur la surface de la terre une nation qui l’emportât par des préceptes de civilité supérieurs aux nôtres, quand nous nous croyions rompus aux mœurs les plus raffinées ? Et c’est cependant ce que nous constatons chez les Chinois (…) C’est pourquoi, si nous sommes égaux dans les techniques, si nous les avons vaincus dans les sciences contemplatives, il est certain que nous le fûmes dans la philosophie pratique (cela fait presque honte de l’avouer), j’entends les règles de l’Éthique et de la Politique appropriées à la vie et à l’usage des mortels. On ne saurait dire en effet le bel ordre, supérieur aux lois des autres nations, qui règle chez les Chinois toutes choses en vue de la tranquillité publique et des relations des hommes entre eux, afin qu’ils s’incommodent le moins possible. Il est certain que les plus grands maux parmi les hommes naissent (…) de leurs rapports, et qu’il n’est que trop vrai que l’homme est un loup pour l’homme.
Et Leibniz de noter que Kangxi « s’est tellement accoutumé à se former à la vertu et à la sagesse » qu’il allait, par exemple, beaucoup plus loin que ceux qui lui étaient soumis, dans l’observance des lois et son respect des sages.
Plus loin, Leibniz souhaite que les Chinois enseignent aux Européens ces règles de vie et leurs autres arts !
L’état de choses chez nous me paraît tel, par le débordement de la corruption, qu’il me semblerait quasi nécessaire que les Chinois nous envoyassent des missionnaires pour nous enseigner l’usage et la pratique de la théologie naturelle, comme nous leur en envoyons pour leur enseigner la révélée.

L’humanisme de Confucius
Mais quelle est-elle, cette philosophie qui permit, mille ans après la mort du philosophe, les résultats rapportés par Leibniz ? La société française d’aujourd’hui peut-elle comprendre toute l’importance de cette question, dominée comme elle est par la sauvagerie d’une culture de jeux vidéo et de films trash, par la violence quotidienne de la vie ? Une éthique de vie serait-elle plus importante qu’un savoir mathématique en tant que tel ? Science sans conscience n’est que ruine de l’âme, disait un certain Rabelais.
La philosophie de Confucius était éminemment politique et si elle était destinée à tout le peuple, elle visait particulièrement la bureaucratie d’État qui gouvernait la Chine et dont il a fait partie. Il n’y a aucune distinction entre la politique et l’éthique, disait-il : l’ordre politique et l’harmonie ne sont possibles que si l’homme a su d’abord acquérir une harmonie morale intérieure.
Pour Confucius, la nature de l’homme est foncièrement bonne. Chaque individu apporte quatre éléments moraux à sa naissance : le ren, notion d’amour incluant l’agapè gréco-chrétienne, l’amour de l’autre qui n’attend rien en retour ; la vertu, qui inclut « l’amour de la justice » ; la « sagesse », qui inclut l’amour de la connaissance, et la « bienséance ». « Le peuple a besoin d’amour plus urgemment que d’eau ou de feu. Le principe de l’amour devrait être appliqué à ceux qui gouvernent, ainsi qu’aux gouvernés. »
Voyez la conception élevée que Confucius a de l’homme !
Ce que Dieu nous donne est la nature humaine. Accomplir la loi de notre nature humaine est ce que nous appelons la loi morale. Cultiver la loi morale est ce que nous appelons culture. Découvrir ce qui dans notre être moral nous unit à l’univers, voilà l’accomplissement le plus élevé de l’homme.
Mais c’est l’homme qui, par sa pensée, peut maîtriser l’Univers.
Aussi grand que soit l’Univers, l’homme ne s’en satisfait pas toujours. Car il n’y a rien de trop grand, que la pensée d’un homme moral ne puisse concevoir quelque chose de plus grand encore, que rien dans le monde ne puisse contenir. Il n’y a rien de si petit que la pensée de l’homme moral ne puisse concevoir quelque chose d’encore plus petit, que rien dans le monde ne puisse diviser.
Le Livre des Odes, plus ancien mais recommandé par Confucius :
Le vautour s’élance vers le ciel là- haut et les poissons plongent vers les profondeurs du bas. Cela veut dire qu’il n’y a pas, dans le ciel le plus haut ou dans les eaux les plus profondes, d’endroit où la loi morale ne puisse être trouvée. Pour l’homme moral, la loi morale commence dans la relation entre homme et femme, mais finit dans les vastes confins de l’Univers.
Enfin, autre notion clé chez Confucius, le li, que Leibniz compare à Dieu :
Le li est le grand canal par lequel nous suivons les lois de l’Univers, et dirigeons le cœur humain vers des expressions appropriées. (…) Si la société suit le principe du li, elle atteindra une grande harmonie.
Là, personne ne sera pauvre et le dirigeant conduira « le carrosse de la vertu, et aura, comme timonier, la musique » !
Un véritable dialogue de civilisation
Ce paradoxe d’une société qui n’avait pas connu la révélation divine mais où les uns et les autres se comportaient de façon plus civilisée que les « vrais chrétiens », plongea les Européens dans le désarroi. Les jésuites finirent par en être réellement séduits pendant que d’autres, préférant rester dans leurs certitudes, se sont accrochés aux différences superficielles entre la religion chrétienne et la philosophie confucéenne, pour les condamner.
Il en résulta la « querelle des rites », et des disputes incessantes sur les doctrines de la prétendue « religion » chinoise. Un chrétien pouvait-il rendre hommage à Confucius, et vice-versa ? Pour Leibniz, les rites consacrés à Confucius n’étaient pas religieux ; les Chinois organisaient aussi ce type de cérémonie pour leurs personnalités officielles, même de leur vivant.
Les questions de doctrines étaient plus fondamentales : le confucianisme faisait-il référence à un Dieu spirituel, qui, comme le Dieu des Chrétiens, aurait créé tout ce qui relevait de la matière, tout en étant totalement séparé de celle-ci ? Pour les ordres et le Vatican, il y avait incompatibilité : il fallait convertir les infidèles et les obliger à répudier leur prétendu « culte ».
Leibniz, au contraire, fournit le modèle de ce que doit être le dialogue des civilisations. Et d’abord le respect !
Comme il y a dans la Chine une morale extérieure admirable à certains égards, jointe à une doctrine philosophique, ou bien à une théologie naturelle, vénérable par son antiquité, établie et autorisée depuis trois mille ans ou environ, longtemps avant la philosophie des Grecs, laquelle est pourtant la première dont le reste de la terre ait des ouvrages, nos saints livres toujours exceptés ; ce serait une grande imprudence et présomption à nous autres nouveaux venus après eux, et sortis à peine de la barbarie, de vouloir condamner une doctrine si ancienne, parce qu’elle ne paraît point s’accorder d’abord avec nos notions scholastiques ordinaires. Et d’ailleurs, il n’y a point d’apparence, qu’on puisse détruire cette doctrine sans une grande révolution. Ainsi il est raisonnable de voir si on ne pourra pas lui donner un bon sens.
« La culture est l’âme des civilisations », a affirmé le président Xi jinping. Cela veut dire qu’entre une culture et une autre, on ne peut pas traduire mot à mot ; il faut s’approprier l’âme qui donne sens aux mots. C’est ce que fait Leibniz, en découvrant que les conceptions défendues par les Chinois à son époque ont été, par rapport aux textes anciens de Confucius, tout aussi dénaturées que la vraie doctrine chrétienne par la Scolastique. Pour les convertir au « christianisme », il faut donc d’abord les convertir à leurs propres doctrines d’origine !
Ensuite, Leibniz se plonge dans les meilleures traductions des textes anciens réalisées par les pères Longobardi et Sainte Marie. [1] Par un examen de la cohérence intérieure de cette philosophie, il découvre chez les anciens une « théologie naturelle » compatible, non pas avec la révélation chrétienne, mais avec la « métaphysique » des chrétiens.
Dans sa « Lettre à Rémond », Leibniz examine à fond cette question. Selon Longobardi :
Le premier principe des Chinois s’appelle Li, c’est-à-dire, raison ou fondement de toute la nature ; il n’y a rien de plus grand, ni de meilleur que le Li. Cette grande et universelle cause est pure, quiète, subtile, sans corps et sans figure, qui ne se peut connaître que par l’entendement. Du Li émanent cinq vertus, la Piété, la Justice, la Religion, la Prudence et la Foi.
Le li produit le ki (matière). Ce premier acteur et raison des autres choses est donc, selon Leibniz, ce que « je crois correspondre à notre divinité ». Etant donné que les textes anciens disent que le li est aussi présent dans la matière, Leibniz conclut qu’il y a un li, « loi qui dirige, et intelligence qui conduit les choses [comme par] une force naturelle », et un li qui participe aux choses créées. Le li « supérieur » peut donc être comparé au Dieu des chrétiens, et le li « inférieur », à ce que Leibniz décrit comme la « monade », l’essence de tout ce qui est, qui participe plus ou moins de l’intelligence ainsi que de la matière, car les choses de ce monde, y compris les « âmes raisonnables, ne sont jamais dépouillées totalement de tout corps ».
Nous voici donc en pleine « dynamique » de Leibniz, dont il a décelé la ressemblance avec la pensée de Confucius, et qui peut être la base d’un dialogue fructueux avec les Chinois !



 COMMENTAIRES
COMMENTAIRES