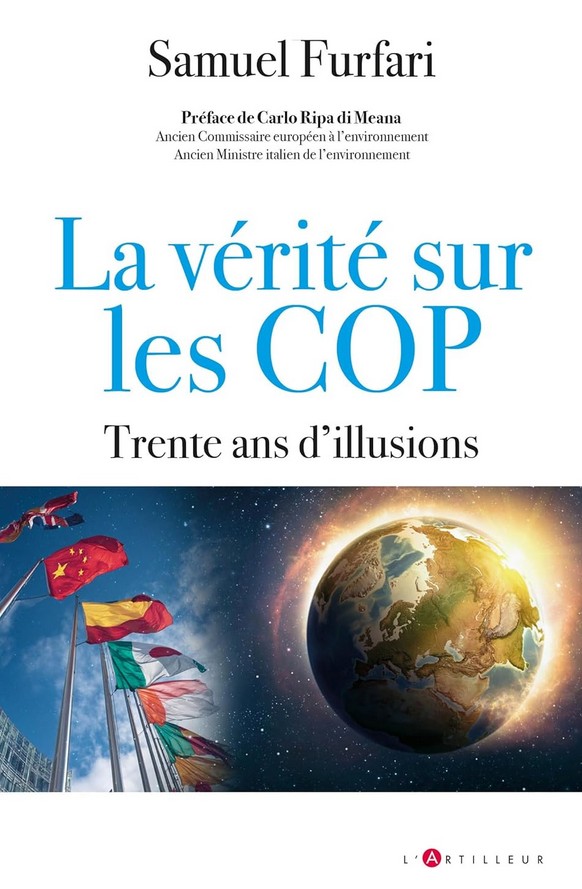CRITIQUE DE LIVRE
Par Pierre Bonnefoy
Sorti à la veille de la COP30 de Belém au Brésil, ce livre dresse un bilan des 29 COP (Conférence des parties) qui se sont déroulées ces trente dernières années, depuis le Sommet de Rio sur le climat de 1992. Partant du postulat que les émissions de gaz carbonique (CO2) issues de l’activité humaine réchaufferaient ou dérégleraient le climat de la planète, le but affiché de ces conférences est de coordonner une action internationale pour réduire, voire arrêter ces émissions.
Dans son ouvrage, Samuel Furfari ne discute pas de la validité scientifique de ce postulat, mais se contente d’évaluer les effets et les résultats de ces COP par rapport à leurs objectifs de départ. D’emblée, il précise d’où il parle :
Pour bien montrer que les fondements mêmes de ces grand-messes climatiques sont plus idéologiques et politiques que scientifiques, il commence par une attaque contre le malthusianisme ambiant issu des années 1970, orchestré par le Club de Rome, avec le « rapport Meadows », et par Maurice Strong.
Au Sommet de Rio de 1992, le discours de clôture du secrétaire général de l’ONU, Boutros Boutros-Ghali, reflète un néopaganisme inspiré de Strong – discours cité par Furfari et qu’il vaut la peine de reproduire ici :
Ceci étant posé, Furfari passe en revue l’ensemble du processus des COP depuis Rio, en s’arrêtant sur les plus significatives d’entre elles. Son jugement sur leur utilité se résume ainsi :
Les raisons de ce fiasco ?
Il faut tout d’abord reconnaître que bien qu’à chaque COP, un certain nombre d’objectifs et d’engagements soient décidés par les parties, il n’y a aucun véritable processus d’évaluation après coup des effets de ces décisions :
Rien d’étonnant à cette absence d’examen de la portée des décisions, puisqu’elles sont physiquement inapplicables et ne peuvent donc déboucher sur aucune mesure contraignante. Dès lors, l’une des principales motivations de ce spectacle se trouve dans des considérations de politique intérieure, surtout au sein de l’Union européenne, chaque responsable politique s’efforçant de paraître plus vert que les autres. Malheureusement, à ce petit jeu, la France s’est particulièrement illustrée en 2015, au moment de la COP21, alors que François Hollande cherchait désespérément à retrouver sa popularité perdue.
Pour « chauffer la salle » quelques semaines avant cet événement qu’il voulait historique, l’ancien président français s’est ridiculisé à l’Assemblée générale des Nations unies en déclarant :
Commentaire de Furfari :
Cependant, pour satisfaire les ONG avec lesquelles les politiciens européens se sont de plus en plus associés (comme le montre la nomination d’une ancienne présidente du WWF dans le second gouvernement Lecornu), les pays de l’Union européenne se sont engagés dans une décarbonation de leurs économies, dont l’effet est à peu près nul sur l’évolution des émissions de CO2 à l’échelle planétaire, mais dont la conséquence économique est une destruction masochiste de notre industrie et de notre agriculture.
Inversement, les pays du Sud, la « majorité planétaire », affirment de plus en plus ouvertement leur rejet des politiques vertes, qu’ils perçoivent à juste titre comme des formes modernes de néo-colonialisme, destinées à les maintenir dans un état de sous-développement en les condamnant à vendre bon marché leurs ressources naturelles et leur main-d’œuvre. En effet, les trois dernières COP (27, 28 et 29), organisées dans trois pays producteurs d’hydrocarbures, se sont caractérisées par un changement de paradigme.
Jusque-là, l’ordre du jour des COP était déterminé par les pays de l’UE et leurs ONG. L’accent était mis sur la décarbonation des économies et l’on proposait aux pays du Sud des aumônes, tels que les « fonds verts », pour qu’ils s’équipent d’éoliennes et de panneaux solaires. Cependant, conscients qu’ils ne pourront pas se développer sans utiliser massivement leurs hydrocarbures, les pays du Sud ont pris le contrôle de l’ordre du jour des COP, l’orientant davantage vers le bien-être des populations, comme ce fut le cas à la COP29 de Bakou, au grand dam des ONG.
Désormais, ces pays, en particulier ceux d’Afrique, rejettent le colonialisme vert :
« L’Afrique est aujourd’hui le continent qui incarne le plus clairement la pauvreté énergétique, un véritable frein au développement humain et économique. Ce continent, qui abrite près de 18 % de la population mondiale, ne représente pourtant que 6 % de la consommation d’énergie mondiale et à peine 3 % des émissions mondiales de CO2. »
Encouragé par les pays des BRICS, surtout par l’Inde et la Chine dont le secteur énergétique repose majoritairement sur le charbon, le Sud planétaire est de moins en moins enclin à se laisser dicter sa politique économique par l’Occident.
Pour conclure, Furfari espère que la COP30, qui commencera le 10 novembre 2025, sera la dernière, la fracture entre pays occidentaux et ceux de la majorité planétaire ne pouvant se résoudre tant que les premiers maintiennent leur posture hypocrite, exigeant des seconds qu’ils renoncent à se développer afin de sauver le climat, alors qu’ils ne sont aucunement responsables, à ce jour, des émissions de CO2 incriminées.
Il sera intéressant de voir le rôle que jouera Lula da Silva, le président du Brésil, où doit se dérouler cette COP. D’un côté, il s’est fait le champion de la lutte pour sauver le climat, mais de l’autre, il est également l’un des plus grands défenseurs de l’émancipation des pays du Sud, et il n’envisage certainement pas de réduire les activités pétrolières de son pays…