
Par Agnès Farkas
En ce début du XXIe siècle, notre société industrielle à haute densité technologique est entrée dans l’ère d’internet de manière fulgurante avec la robotisation, la digitalisation, l’automatisation et les biotechnologies. De la télémédecine à la chirurgie robotique, l’émergence de l’Intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé impacte déjà notre quotidien.
Sans vouloir aborder toute l’étendue des applications de l’IA, nous pouvons souligner brièvement l’histoire de ses avancées.
L’IA dans les soins de santé
L’IA est sur le point de révolutionner le domaine des soins de santé. A mesure que cette technologie évolue, elle touche de plus en plus de domaines d’application, non seulement dans le diagnostic pour identifier les maladies, comme l’imagerie médicale, ou la planification et la personnification des traitements aux patients atteints de cancer, mais aussi dans la robotisation de la chirurgie ou la surveillance à distance et la télémédecine.
Depuis le milieu du XXe siècle, les améliorations progressives et technologiques dans la recherche façonnent les progrès de l’IA dans le monde médical.
Aujourd’hui, son utilisation dans les soins de santé ne cesse de s’étendre, notamment dans les outils de diagnostic et de pronostic pour identifier les maladies, souvent avec une précision remarquable, comme des systèmes capables de diagnostiquer les maladies oculaires en analysant les scans de la rétine. Les robots chirurgicaux guidés par l’IA améliorent la précision et réduisent la fatigue du chirurgien.
La télémédecine et la surveillance à distance des patients ont connu un essor important pendant la pandémie de COVID-19. La capacité d’analyse de données complexes des systèmes d’IA, telles que des images médicales et des notes cliniques, améliore le diagnostic pour une médecine qui devient de plus en plus personnalisée. La rapidité d’accès à des analyses fondamentales comme la constitution génétique du patient permet des recommandations de traitement ciblé au patient, elle a fait déjà ses preuves chez les malades atteints de cancer.
Petite chronologie élaborée par Donald Smith :
Extraits
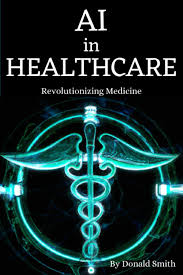
- Fin des années 1950 – début des années 1970. L’un des premiers exemples sur l’assistance des ordinateurs dans la prise de décision médicale est le programme Dendral, développé à l’université de Standford dans les années 1960 pour déduire les structures moléculaires.
- Fin des années 1970 – années 1990. L’avènement du Machine Learning (ML), un système capable d’apprendre à partir de données, ouvre la voie à l’un des premiers systèmes experts, MYCIN, une approche pour diagnostiquer les infections bactériennes.
- Année 2000 - début des années 2010. L’introduction des dossiers médicaux électroniques (DME) a constitué une immense quantité de données médicales numérisées, servant de base à l’apprentissage des algorithmes de l’IA.
- Du milieu des années 2010 à aujourd’hui. L’essor du Deep Learning (DL), un sous-domaine de l’apprentissage automatique, a permis une croissance rapide des applications de l’IA dans les soins de santé, comme la médecine personnalisée ou les diagnostics, tels la solution Aidoc pour la détection des hémorragies intracrâniennes aiguës ou IDx-DR pour le diagnostic de la rétinopathie diabétique.
La sécurité des données et des patients
Face à l’essor de l’IA, la protection des données est essentielle. Elles doivent être rigoureuses, sûres, efficaces et éthiques pour la sécurité des patients. Ces réglementations imposent des tests et une validation rigoureuses des algorithmes de l’IA, notamment qu’elles démontrent leur sécurité par le biais d’essais cliniques ou d’autres processus de validation appropriés.
De plus, la confidentialité et la sécurité des données personnelles sensibles du patient doivent être protégées par une réglementation rigoureuse sous protection des Etats, et une garantie du signalement de violation de données, condamnée par un appareil juridique formé à cet effet.
Une réglementation contrôlée est une garantie d’un principe d’équité et de non-discrimination car un biais algorithmique peut avoir des résultats injustes et discriminatoires. Il faut donc une transparence totale des utilisations de l’IA pour garantir cette équité. Cette technologie est à évolution rapide. Le défi est de maintenir les réglementations à jour face à cette évolution.
Un point important sera l’éducation des parties prenantes dans l’IA santé. La plupart des prestataires de soins de santé et des patients ne comprennent pas ce qu’est l’IA, ce qui risque de nuire à l’efficacité de la réglementation et à la sécurité de l’IA dans les soins de santé.
Le besoin de normes réglementaires mondiales s’intensifie et une collaboration des organismes internationaux exige la création d’un ensemble unifié de lignes directrices pour les technologies de l’IA dans les soins de santé.
Retirer les commandes aux GAFAMA
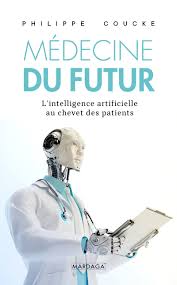
Selon Philippe Coucke*, on estime que la force de frappe des GAFAMA (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alphabet) et des NATU ((Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) surpasse largement l’indice du CAC 40. Cette nouvelle économie est estimée à 5 900 milliards de dollars. Les GAFAMA ont très vite compris la révolution culturelle et technologique que représente l’IA et ont rapidement investi dans le domaine de la santé.
Dans ce sens, en s’adressant d’abord au consommateur de soins, ils privatisent de facto le secteur de la santé, en lançant une véritable OPA sur la gestion de la santé publique. Cette privatisation grandissante, telle qu’on peut l’appréhender aux États-Unis, avec la connivence du gouvernement de Donald Trump, a pour conséquence la perte de contrôle des Etats sur les coûts de l’accès aux soins et la mise à l’écart d’une partie de la population qui ne peut y faire face.
Cinquante années de mauvaise gestion économique par des gouvernements successifs ont largement érodé nos capacités à investir dans ce secteur d’innovation technologique et laissé la main aux GAFAMA. Aussi, l’urgence n’est pas seulement de sauver un système hospitalier public en faillite mais, si l’on veut véritablement exploiter ces nouvelles technologies, d’instaurer une nouvelle politique transparente en matière d’utilisation des données informatiques, qui doivent être contrôlées par les Etats.
Les citoyens avertis ne doivent plus accepter de campagnes électorales où l’on ne souligne pas l’importance d’un budget consacré à la recherche fondamentale et à l’innovation, surtout dans le secteur de la santé. L’hôpital public de demain ne peut survivre sans ces nouvelles technologies. Des décisions politiques importantes s’imposent, avec des délais d’application très courts.
*Médecine du futur, Editions Mardaga
Les innovations à venir
L’impact de l’IA sur les soins de santé est vaste et encore largement inexploré. Une révolution se prépare dans le domaine des prothèses intelligentes capables de répondre à des signaux neuronaux ou dans celui de l’imagerie médicale où l’IA pourra identifier des schémas invisibles à l’œil humain.
Toutes ces évolutions ont un impact sur les professionnels de santé car elles remodèlent leur travail en prenant en charge les tâches répétitives, en réduisant le taux d’erreur et en aidant à la prise de décision. Interpréter des données médicales complexes permet de prendre des décisions plus éclairées et plus précises. La précision des diagnostics pilotés par l’IA a un impact sur les patients qui peuvent bénéficier d’une surveillance médicale continue.
Cependant, rien ne se fera sans des gouvernements engagés dans des politiques de financement adéquates dans ces nouvelles technologies, mais surtout qui abordent les aspects éthiques et juridiques de l’utilisation de l’IA. Développer les infrastructures immobilières de l’hôpital public est une absolue nécessité pour accueillir ces nouvelles technologies, ainsi qu’un personnel suffisamment formé à celles-ci, avec une garantie de cybersécurité des systèmes.
Il faut y ajouter une collaboration engagée entre les organismes de santé, les entreprises technologiques, les établissements universitaires et les gouvernements. Pour assurer le succès de ce partenariat, nos gouvernements doivent sortir de la tutelle des marchés financiers qui, par leurs pratiques d’endettement, bloquent le financement de l’innovation et de la recherche.

