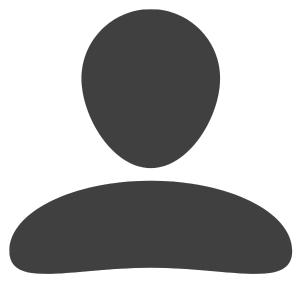En France et aux États-Unis, notre action continue en ce milieu d’été pour mobiliser la population contre une finance criminelle opérant à partir de Wall Street et la City de Londres. C’est le talon d’Achille de Trump, qui avait caressé l’idée de rétablir la séparation entre banques de dépôts et banques d’affaires, le Glass-Steagall Act de Roosevelt, mais qui n’a pour l’instant rien entrepris, laissant la barre à un secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dont l’allégeance aux intérêts de Wall Street est bien connue. C’est également le point faible de Macron qui, en se soumettant aux exigences financières et budgétaires des marchés, voit déjà sa période de grâce prendre fin. La rentrée de septembre s’annonce socialement chaude, et il est essentiel que l’on élève le débat au niveau des causes si l’on veut éviter de sombrer de nouveau dans les impasses de la contestation stérile et du rejet.
L’iceberg du système financier
Nous avons montré ces dernières semaines que les signes avant-coureurs d’un second krach de type 2008 sont là ; plusieurs bulles menacent d’éclater à tout moment. Les cas suscitant de plus en plus d’inquiétude sont aux États-Unis les crédits étudiants, les prêts automobiles ou les dettes des entreprises, et en Europe les « créances douteuses » des banques italiennes. Mais comme dans le cas des « subprimes » en 2007, cela ne constitue que la partie émergée d’un vaste iceberg, car chacun de ces crédits ou prêts est « titrisé » puis joué sur des marchés spéculatifs aussi opaques que risqués. Par exemple, aux États-Unis, rien que les défauts de paiement sur les prêts automobile représentent aujourd’hui 23 Md$, en hausse de 14 % par rapport à l’année dernière ; Bloomberg rapporte que 32 % des produits financiers « titrisés » (dits ABS – Asset backed securities ou titres adossés à des actions) sur la base de ces prêts émis en 2016 sont classés « risque très élevé », contre seulement 5 % en 2010, ce qui représente sans doute plusieurs milliers de milliards de dollars menacés par les défauts de paiement.
Cette réalité contraste de façon tragi-comique avec l’optimisme de façade des autorités financières et des politiques, à commencer par le président de la BCE Mario Draghi, pour qui tous les voyants du retour de la croissance sont au vert. Refusant de toucher au shadow banking et aux produits dérivés hors bilan, ils attirent l’attention sur les créances douteuses des banques moyennes et petites italiennes, sur les dettes privées portugaises ou grecques, et bien entendu sur les dettes publiques.
Un député français, répondant à nos sollicitations pour défendre notre « projet de loi pour la moralisation de la vie bancaire », nous a justement expliqué qu’il ne jugeait plus aujourd’hui nécessaire de séparer les banques de dépôts et les banques d’affaires (alors qu’il y était auparavant favorable) ; pour se justifier, il a repris le principal argument du lobby bancaire sur le fait que Lehman Brothers a fait faillite en 2008 alors qu’elle ne pratiquait pas le mélange des genres, oubliant ainsi que le Lehman Brothers avaient acheté des produits « titrisés » auprès des mégabanques « universelles ».
Macron pris au piège
Tout comme François Hollande avant lui, Emmanuel Macron se berce de l’illusion d’un retour magique de la croissance, et en fait le gage de la réussite de son mandat. Il est pris au piège de la pensée statistique, la croissance étant déduite par des modèles de projections ne prenant pas en compte – on ne s’en étonnera pas – le risque de krach systémique. De plus, les Français sont en train de s’apercevoir que le renouveau annoncé n’en avait que les apparences, et que Macron poursuit en réalité la logique d’austérité sociale de ses prédécesseurs, embauchant même certaines des têtes pensantes ayant pris part aux réformes, comme Pierre-André Imbert, son conseiller social à l’Élysée, qui était déjà Directeur du cabinet de la ministre du Travail Myriam El Khomri. La fin de l’état de grâce, précipitée par l’affaire du général de Villiers et par l’annonce inique (en plein été) de la baisse des aides au logement, est désormais actée ; elle coïncide ironiquement avec la réapparition publique de François Hollande, comme un nuage gris survenant dans le ciel bleu et lumineux de la macronite. La colère monte de partout, parmi les élus locaux suite à l’annonce de 3 Md€ supplémentaires de coupes, parmi les retraités touchés par la hausse de la CSG, au sein de l’armée bien sûr, et même dans le parti LREM.
Pour sortir de ce piège, Macron n’aura pas d’autre choix que de prendre le taureau de la finance par les cornes ; toutefois, on peut douter qu’il prenne de lui-même une telle initiative : seule un lobby citoyen peut provoquer l’étincelle. Aux États-Unis, le syndicat CWA (Communication Workers of America), qui a joué un rôle important dans le fait que le Parti démocrate ait introduit dans son programme de 2016 le rétablissement de la loi Glass-Steagall, lance un mouvement « Take On Wall Street » (A l’assaut de Wall Street). CWA est le principal syndicat du secteur de la communication et des médias, et il représente 700 000 employés.
En France, S&P va déposer cette semaine au Sénat le « projet de loi pour la moralisation de la vie bancaire » ; nos équipes d’appels ont fixés les premiers rendez-vous avec les élus, ainsi qu’avec tous ceux qui peuvent se constituer partenaires de cette mobilisation.



 COMMENTAIRES
COMMENTAIRES