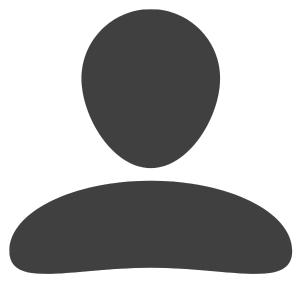Chronique stratégique du 9 septembre 2021 (pour s’abonner c’est PAR ICI)
Une tête sans corps nommée Tony Blair
Tel un poulet sans tête – ou plutôt un cerveau britannique privé de son muscle américain —, l’ancien Premier ministre britannique poursuit sa déambulation hystérique contre le retrait américain d’Afghanistan, et contre un Joe Biden désobéissant face aux élites impérialistes de l’Otan et de l’Empire anglo-américain. Comme nous l’avons rappelé dans notre chronique du 25 août, Blair joue le rôle de mauvais esprit de l’Amérique, depuis son appel lancé en faveur des guerres de « changement de régime », lors de son discours de 1999 devant le Chicago Council on Foreign Relations.
Il faut croire que la débâcle de la guerre d’occupation en Afghanistan, les centaines de milliers d’Afghans civils tués, les 2000 milliards de dollars du contribuable américain dépensés en pure perte, etc, n’ont pas entamé une seule seconde son enthousiasme pour les « guerres sans fin ». Le 6 septembre, dans le cadre du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, Blair a en effet prononcé un discours psychotique devant le Royal United Services Institute (RUSI) dans lequel il a exigé davantage d’interventions militaires et de « Nation Building » (construction de nations), dont tout le monde constate désormais le triste bilan.
Alors que selon lui la menace terroriste resterait une question de premier ordre, Blair s’est plaint du fait que « la pression des impératifs politiques à court terme donne à la fois aux alliés et aux opposants des sociétés libérales ouvertes la conviction que ’notre temps est révolu’ ». Il a dit qu’il trouvait profondément « déprimant » d’entendre l’opinion occidentale affirmer « que nous sommes stupides de croire que les notions occidentales de démocratie libérale et de liberté sont exportables ou prendront jamais racine sauf sur le terrain quelque peu décadent de la société occidentale ».
Pour l’ancien Premier ministre, la « très forte pression politique » qui s’exprime aux Etats-Unis en défaveur des « interventions militaires » pose un défi pour la Grande-Bretagne et pour l’Otan : « La perte de la volonté de se battre, combinée à une incapacité à penser stratégiquement, représente une véritable menace auto-infligée. (…) Pour moi, l’un des développements les plus alarmants de ces derniers temps a été le sentiment que l’Occident n’a plus la capacité de formuler une stratégie. Que ses impératifs politiques à court terme ont comprimé l’espace pour la réflexion à long terme. C’est ce sentiment plus que toute autre chose qui donne à nos alliés de l’anxiété et à nos adversaires la conviction que notre temps est révolu ».
Un nouveau paradigme
La réalité, qui met dans tous leurs états M. Blair et ses semblables, est que le retrait d’Afghanistan nous offre à la fois une opportunité et une responsabilité d’établir un nouveau paradigme de paix par le développement économique, comme le souligne la présidente internationale de l’Institut Schiller Helga Zepp-LaRouche dans sa déclaration du 5 septembre intitulée « L’Occident peut-il apprendre ? Ce dont l’Afghanistan a besoin maintenant ».
« Il faut dès maintenant mettre de l’avant l’alternative à la destruction et à la souffrance en Afghanistan », écrit-elle. Toutes les nations régionales entourant l’Afghanistan souhaitent voir ce pays intégrer l’Initiative « la Ceinture et la Route » et le corridor Nord-Sud de la Russie et de l’Inde. Ainsi, les États-Unis, qui réalisent dans la douleur que l’échec militaire doit laisser la place à la diplomatie, doivent se joindre à un effort collectif pour construire les infrastructures de base (eau, transport, énergie, hôpitaux, etc) qui manquent cruellement à l’Afghanistan, aux côtés de la Chine et la Russie, entre autres.
La première priorité doit être d’aider le peuple afghan, qui se trouve dans une situation catastrophique qu’il n’a pas provoquée lui-même ; et cela ne sera possible que si une base de confiance est établie avec le nouveau gouvernement, en laissant de côté toute idéologie, ajoute Mme Zepp-LaRouche. Le Comité pour la coïncidence des contraires propose donc que les gouvernements américain et européens proposent, pour la coordination d’un tel programme d’aide, la personne qui a prouvé par le passé qu’une telle politique pouvait réussir, à savoir Pino Arlacchi, l’ancien directeur de l’UNDCCP (bureau des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention des crimes). Il serait le garant du respect de la souveraineté de l’Afghanistan et de l’absence totale de tentative d’imposer des normes occidentales, car il a également gagné la confiance des talibans par le passé.
La France
Et la France dans tout ça ? Notre pays, qui est lié à la liberté du monde par un pacte vingt fois séculaire, comme le disait de Gaulle, a un rôle de premier plan à jouer dans ce nouveau paradigme. Et malgré le fait que le gouvernement Macron continue de patauger dans la géopolitique de l’Otan en jouant la carte de la prétendue résistance de la « société civile afghane » contre les talibans, l’ombre du général plane au-dessus des élites françaises, telle la statue du commandeur.
En témoigne l’intervention de Dominique de Villepin sur France inter, le 6 septembre. Faisant écho à Mme Zepp-LaRouche, l’ancien ministre des Affaires étrangères déplore le fait que l’Occident n’a pas su tirer les leçons de ses échecs répétés :
Les démocraties sont incapables de reconnaître publiquement leurs erreurs. George Bush et Tony Blair n’ont jamais eu à rendre compte des méfaits de leur politique, a-t-il martelé. (…) Ce qu’ont fait les Américains, ce qu’ont fait un certain nombre de pays européens, en reniant leurs valeurs démocratiques et en recourant au mensonge, ça conduit à des catastrophes.
« Les armées, non seulement n’ont pas réglé la question terroriste, mais elles ont aggravé les choses. On croit protéger nos pays en allant là-bas, on les expose encore plus et on empêche la mise en place de stratégies politiques », a-t-il poursuivi, ajoutant que les démocraties occidentales se sont engagées au Moyen-Orient avec une grande « méconnaissance » des différentes sociétés qui y vivent. Or, ces sociétés sont « complexes, il faut essayer de les comprendre. Le principe de la résistance nationale contre des troupes étrangères est aussi vieux que le monde. Il y a un rejet parmi les opinions publiques » dont il faut tenir compte.
Enfin, pour de Villepin, il est temps de refondre la politique étrangère française, ce en quoi nous ne pouvons que souscrire :
La politique étrangère est toute entièrement faite à l’Élysée. Mais ce n’est pas fait pour ça. On ne fait pas une politique étrangère avec 5 ou 6 conseillers.
Abondant dans le même sens, le journaliste Renaud Girard a appelé le 6 septembre, dans Le Figaro, à rouvrir l’ambassade française de Kaboul. Rappelant le « sain principe » gaulliste selon lequel la France reconnaît les Etats et non les régimes, le journaliste spécialiste de l’Afghanistan estime qu’il est temps pour nous de cesser de nous comporter comme un vassal aligné sur la politique extérieur américaine.
À Kaboul, les talibans ont appelé les ambassades étrangères à rouvrir. Incontestablement, les talibans sont des Afghans et, incontestablement, ils contrôlent tout le territoire de leur pays, écrit-il. On peut le regretter, mais ils sont là pour longtemps. Nous n’aimons pas l’idéologie du Parti communiste chinois, ni son retour au culte de la personnalité. Cependant, nous maintenons une très grande ambassade à Pékin. Car la Chine est un immense pays, avec lequel la France doit nourrir des relations approfondies, politiquement, commercialement, culturellement.
Rouvrir notre ambassade à Kaboul n’implique pas que la France doive pour autant « renoncer à défendre les droits de l’homme et son héritage de 1789 », souligne le journaliste. « Mais ce n’est pas en étant absents de Kaboul que nous brandirons le mieux, à la face de la population afghane, la bannière des droits de l’homme ».
Et au-delà des paroles verbales, il s’agit, en rupture avec l’ordre financier actuel, de mettre en place une politique de développement mutuel à l’échelle du monde.


 COMMENTAIRES
COMMENTAIRES